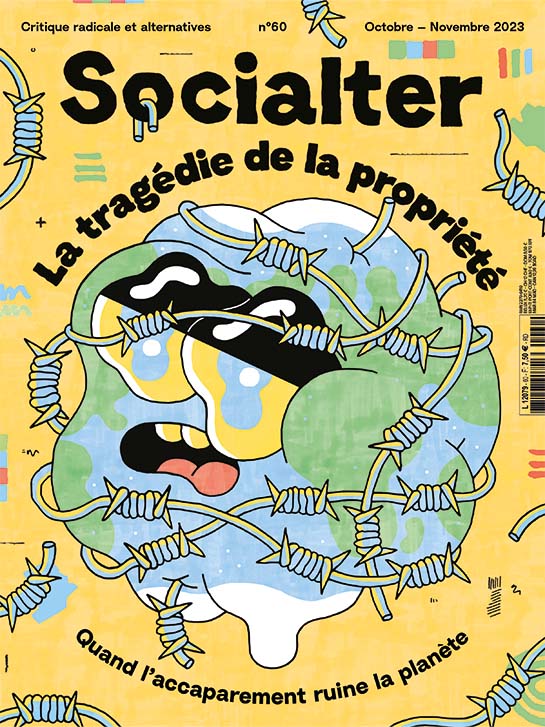« 3 750 hectares. Parcelle pour domaine agricole. 800 reais. » Des petites annonces de ce genre fleurissent sur Facebook dans les États brésiliens d’Amazonas, du Pará et du Mato Grosso. Problème : les terres mises ainsi en vente à la découpe pour l’équivalent de 150 euros l’hectare… sont prises en toute illégalité sur la forêt amazonienne. C’est ce que révèlent les journalistes de Forbidden Stories dans une enquête mise en ligne en juin dernier. Vendues à vil prix, ces parcelles destinées à devenir des pâturages pour l’élevage bovin sont ensuite déforestées par des incendies volontaires. Et les failles du système d’enregistrement brésilien, exploitées par d’habiles propriétaires terriens, permettent d’obtenir des documents légalisant l’accaparement rampant de l’Amazonie.
Article issu de notre numéro 60 « La tragédie de la propriété », en librairie et sur notre boutique.
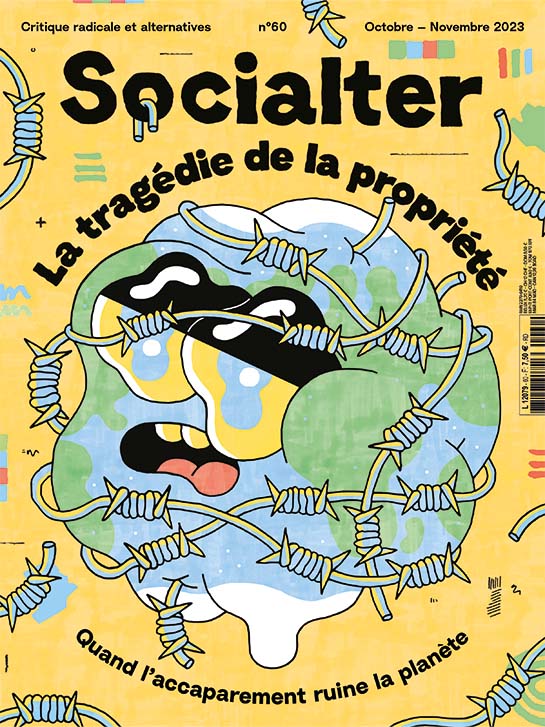
Ce pillage rappelle à bien des égards le processus des « enclosures », décrit par Marx dans le Capital comme un préalable à l’essor du capitalisme anglais. À ceci près que les terres communales clôturées par les seigneurs anglais entre le XVIe siècle et le XVIIIe siècle étaient destinées à l’élevage de moutons… Qu’il soit le fruit d’un accaparement ou d’une patiente épargne, le droit de propriété a toujours été au cœur du fonctionnement du capitalisme. Pour la bourgeoisie triomphante du XIXe siècle, c’est un droit absolu.
Et cette vision a inspiré la définition du Code civil de 1804, toujours en vigueur : « La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois et les règlements. » Ce droit confère de la sorte au propriétaire un droit total sur la chose possédée. Non seulement le droit d’usage (usus), mais le droit sur les fruits (fructus), c’est-à-dire la jouissance des récoltes ou des revenus tirés du bien possédé, et surtout le droit de disposer de la chose(abusus), en altérant sa substance, en la vendant… ou même en la détruisant.
Mines à ciel ouvert, coupes rases de forêts, artificialisation effrénée des sols : la propriété privée des terres donne ainsi – en l’absence de barrières légales – le droit exorbitant d’exploiter et de dévaster les écosystèmes et le vivant. « Le régime de la propriété privée a été ébranlé au XIXe siècle par la grande protestation socialiste, tant il peinait à justifier l’accaparement des fruits du travail des salariés. Il est exposé aujourd’hui à une autre critique, qui fait apparaître que la propriété n’est pas seulement ce dispositif bien fait pour tirer jouissance du travail collectif d’autrui, mais une menace sur les conditions de toute vie en commun », écrivaient ainsi Pierre Dardot et Christian Laval en 2014 dans leur ouvrage de référence Commun(La Découverte).
« Le désastre écologique a comme source majeure, sinon principale, un mode de relation à la nature qui permet son appropriation privative et exclusive. Qu’on le nomme naturalisme, capitalisme ou modernité, il se joue dans ce rapport des êtres humains à la terre et au vivant un déchaînement de la puissance d’agir du Prométhée moderne », analysent de leur côté la politiste Isabelle Bruno et le sociologue Paul Cary dans un dossier de la Revue française de socio-économie consacré aux rapports entre nature et propriété(2022). Face aux dynamiques voraces du capitalisme, une alternative irrigue les réflexions et les luttes écologistes : le commun.
Une autre voie : les communs
Dans les années 1980-1990, le marché et l’innovation technique ont été désignés par le courant de pensée néolibéral comme l’alpha et l’oméga des politiques environnementales. En plein backlash contre les réglementations protectrices nées dans les années 1960, l’heure est au free market environmentalism(« écologie de marché »). Une thèse fait florès à l’époque pour disqualifier toute tentative de gestion collective des ressources naturelles : la « tragédie des communs ». On la doit au biologiste Garrett Hardin qui montre en 1968, à partir de l’exemple fictif d’un pâturage partagé, que le comportement maximisateur des éleveurs conduit mécaniquement à la surexploitation du sol. Conclusion : la propriété commune mènerait à la ruine. Malgré les limites d’une modélisation peu crédible, le « mythe de la tragédie des communs » reste, selon l’historien Fabien Locher, longtemps populaire au sein des administrations américaines et des organisations internationales promouvant les privatisations.
Future prix Nobel, l’économiste Elinor Ostrom balaye pourtant en 1990 la thèse de Hardin dans son ouvrage Governing the commons. À partir de l’étude du fonctionnement collectif de pêcheries, de forêts, de systèmes d’irrigation traditionnels aux quatre coins du monde, elle fait la preuve que des institutions collectives peuvent gérer durablement des « communs ». Dans son analyse, la propriété n’est pas un bloc, mais un « faisceau de droits » (droit d’accès, de prélèvement), qui ne sont pas identiques pour toutes les parties prenantes. Et les instances participatives sont chargées, dans chaque cas, de définir les bénéficiaires et les conditions d’utilisation de la ressource commune.
Face à la vague de privatisations qui touche à l’époque tous les secteurs – de l’eau aux transports publics –, le « paradigme des communs » trouve alors un grand écho auprès de la mouvance altermondialiste, soulignent Pierre Dardot et Christian Laval. Certains y voient en effet une voie nouvelle à explorer, à distance du marché comme de l’État. Car l’émergence des communs coïncide avec une désillusion profonde, rappellent les auteurs deCommun : « Les solutions étatistes anciennes […] ne sont plus regardées de la même façon depuis que les gouvernements ont soldé un peu partout les entreprises publiques et formé une étroite alliance avec les multinationales. »
Acheter pour protéger ?
En France, la lutte contre les projets d’aménagement destructeurs a souvent pris ces dernières années la forme d’une contestation en acte de la propriété – privée ou publique – par le biais de l’occupation, comme sur l’emblématique ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Mais que faire une fois la victoire acquise ? Comment organiser l’usage collectif des terres ? Un précédent existe : le Larzac. Berceau d’une lutte victorieuse pour la préservation de l’agro-pastoralisme contre l’extension d’un camp militaire dans les années 1970, le plateau aveyronnais est devenu un cas unique en France de gestion commune du sol. Lors de l’abandon du projet après l’élection de François Mitterrand en 1981, l’État a en effet confié, à travers un bail emphytéotique, la gestion de 6 300 hectares à la Société civile des Terres du Larzac (SCTL), créée par des militants installés jusque-là illégalement. Depuis, les sociétaires de la SCTL (ils étaient 91 en 2020), en majorité paysans, choisissent les candidats à qui ils transmettent les fermes lors des départs en retraite. Et sans qu’une norme explicite ne l’impose, « l’esprit Larzac » favorise une agriculture paysanne, respectueuse du vivant.
Ce modèle collectif, les zadistes de Notre-Dame-des-Landes ont voulu s’en inspirer après l’abandon, en 2018, du projet d’aéroport. Mais le gouvernement a refusé de leur confier un bail emphytéotique, même expérimental. Sous peine d’expulsion, les occupants ont dû régulariser leur situation en signant des baux ruraux individuels. L’« assemblée des usages » de la ZAD a donc décidé de lancer un fonds de dotation appelé « La Terre en commun », pour collecter des dons et racheter collectivement les bâtiments et les terres. Un « recours à l’achat et au mécénat »qui a fait bondir certains anciens soutiens de la ZAD.
Pourtant, précisent les créateurs du fonds de dotation dans une tribune, « il s’agit d’une structure de propriété collective, sans part ni action, incompatible avec toute forme de plus-value, spéculation et recherche d’enrichissement personnel » (Reporterre, juillet 2019). La Terre en commun doit ainsi permettre à leurs yeux de sortir définitivement les terres de la ZAD du régime de la propriété privée. Si elle donne lieu à débat, l’idée d’utiliser l’acquisition collective comme outil de lutte fait son chemin. « Si la propriété privée permet d’exploiter, pourquoi ne permettrait-elle pas de protéger ? » interrogeait en 2019 le philosophe du vivant Baptiste Morizot, dans une tribune parue dans Le Monde. Il réaffirmait dans ce texte son appui à la stratégie de l’Association pour la protection des animaux sauvages (Aspas), destinée à créer, grâce à des dons, des réserves de vie sauvage, laissées en libre évolution.
En réalité, pointe le chercheur Lionel Maurel, ni l’Aspas, ni le fonds de dotation La Terre en commun n’ont recours à l’institution classique de la propriété privée. Par leur fonctionnement collectif, ces structures relèvent bien de la catégorie des « communs ». Leurs règles conduisent notamment à une neutralisation du droit d’aliénation (abusus), sortant de fait les terres acquises du marché. « Les terrains acquis par l’Aspas ne peuvent être revendus », précise le site de l’association. Et si celle-ci venait à disparaître, une clause prévoit que les terres soient transférées à une structure aux buts similaires. Pour Lionel Maurel, l’usage tactique du rachat de terres présente néanmoins des limites. « On ne peut se résigner simplement à créer des îlots de communs au sein d’un océan de propriété lucrative et il importe de continuer à agir politiquement pour que le commun s’impose à tous les propriétaires, ce qui passe par une réglementation environnementale exigeante, protégeant partout les conditions de la vie. »
Pour une propriété écologique
Faut-il pour cela transformer le droit de propriété ? Aux yeux de Gérard Mordillat et Christophe Clerc, auteurs d’une somme sur le sujet parue cette année, Propriété. Le sujet et sa chose(Seuil, 2023) (lire notre entretien page 24), la clef pour définir une « propriété écologique » serait bien de neutraliser l’abusus, c’est-à-dire le droit de vendre ou de détruire. Opposée à la propriété marchande, la propriété écologique constituerait ainsi « un rapport social dont l’essence est de préserver la chose appropriée ». La juriste Sarah Vanuxem appelle de son côté à relire le droit de propriété comme une faculté d’habiter, plutôt qu’un pouvoir sur des objets. « Dans cette vision, les choses ne sauraient jamais être à strictement parler appropriées », indique-t-elle dans La Propriété de la terre (Wildproject, 2018).
Quant au philosophe Pierre Crétois, il invite à voir le monde comme fondamentalement « copossédé ». Dans cette perspective, il propose de refonder les droits de propriété à partir d’exigences définies collectivement : « Il est essentiel d’affirmer un droit des tiers à être inclus dans l’usage des biens privés, contre le droit de propriété entendu comme droit absolu » (La Copossession du monde, Amsterdam, 2023). Les droits des riverains d’une usine ou d’un domaine agricole à bénéficier d’air pur et d’eau saine viendraient par exemple limiter les droits des propriétaires. « Il faut prendre au sérieux le caractère écosystémique de la propriété », insiste Pierre Crétois : les droits sur les ressources doivent être délimités pour respecter ceux de la communauté, du voisinage. Ainsi redéfinie et limitée, réintégrée dans les relations à ce qui lui est extérieur, la propriété privée n’apparaît en fin de compte que comme un ensemble de droits… résiduels.
Soutenez Socialter
Socialter est un média indépendant et engagé qui dépend de ses lecteurs pour continuer à informer, analyser, interroger et à se pencher sur les idées nouvelles qui peinent à émerger dans le débat public. Pour nous soutenir et découvrir nos prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner !
S'abonnerFaire un don