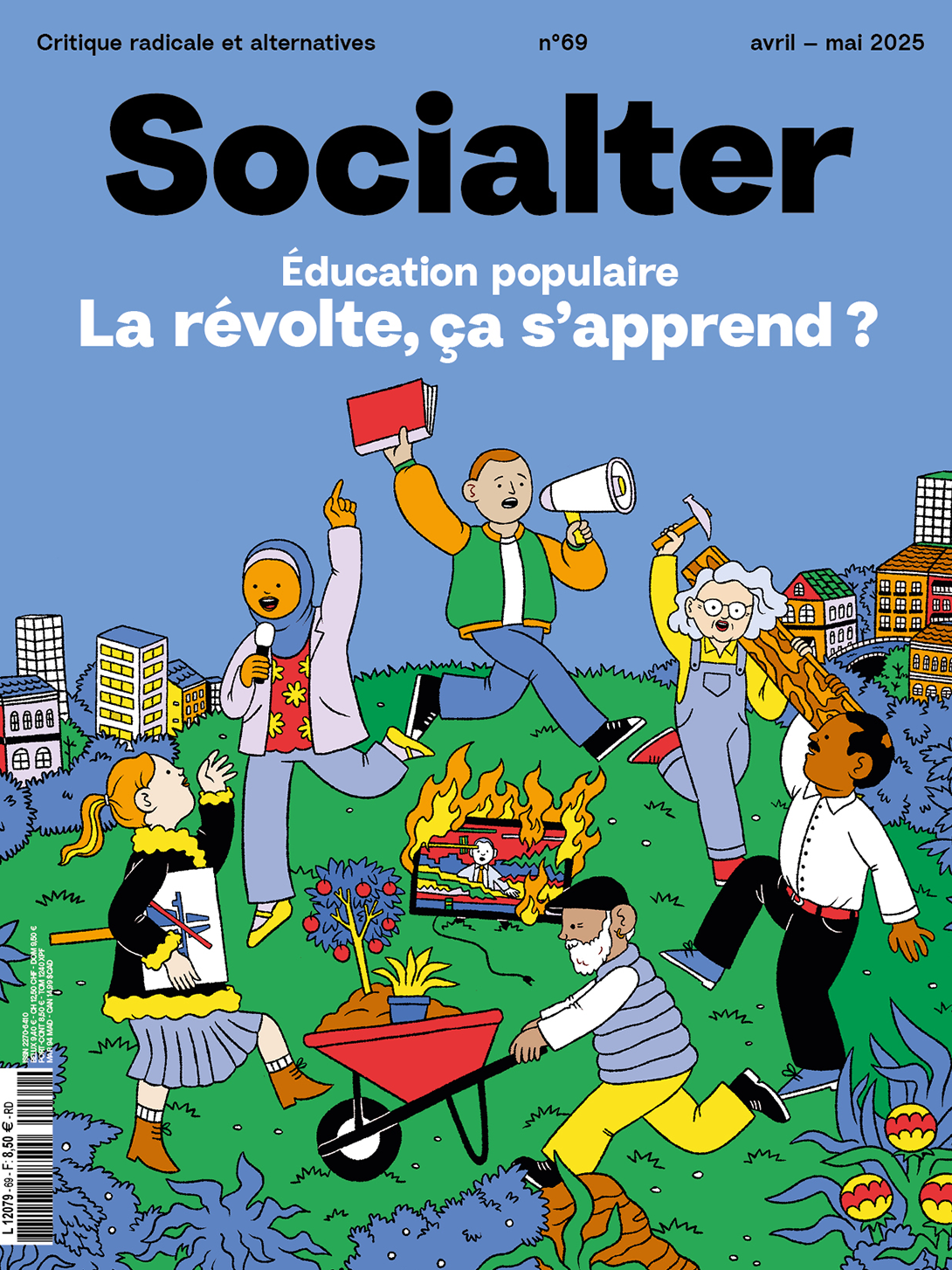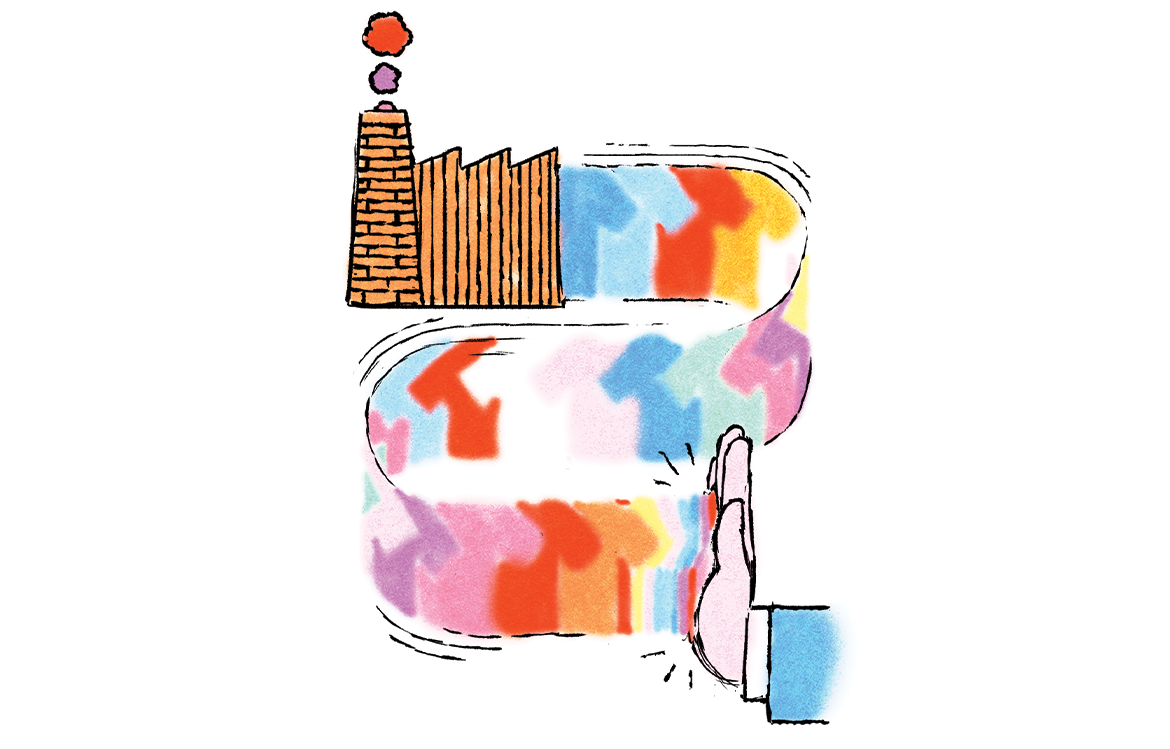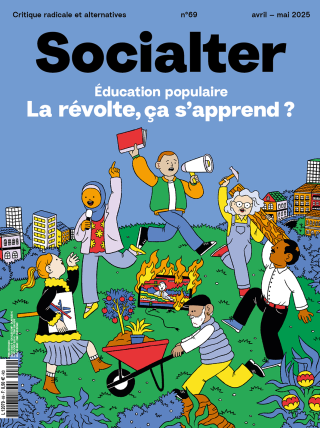Des centaines de sacs poubelles sont entassés sur le parking de la Ressourcerie du pays d’Arles (Bouches-du-Rhône). Des tas géants de plastiques transparents remplis de jeans, de vestes, de pulls ou de t-shirts. Ces vêtements proviennent de conteneurs textile – ces bennes installées dans la rue où nous glissons nos vieux habits en pensant faire un geste écologique ou caritatif. La structure en gère une vingtaine dans la communauté de communes Vallée des Baux-Alpilles. Sa mission : donner une deuxième vie à ces déchets.
Sauf qu’elle n’y arrive plus. Ces fripes, personne n’en veut. Elles ont commencé par s’accumuler dans les espaces de stockage intérieur. Elles s’abîment désormais à l’air libre. « Il va falloir les enfouir comme les ordures ménagères avant que la situation ne dégénère encore plus », explique Lisa Coinus, qui craint les invasions d’insectes, la nidification des oiseaux, l’insalubrité ou un incendie.
La jeune femme, couturière passionnée, traîne dans nos vieux habits depuis plus de dix ans. En 2012, elle a ouvert un atelier-boutique de vêtements recyclés à Arles. « Je voulais faire passer le message que c’était possible et cool. » Quelques années plus tard, elle a voulu aller plus loin en acceptant un poste à la Ressourcerie du Pays d’Arles. « Là je me suis retrouvée devant des montagnes de sacs toute la journée, c’est choquant, cela fait un truc physique. » Une folie devant les yeux au quotidien. Ce mois de janvier, elle vient de quitter son poste, dépitée par ce système complètement à bout de souffle.
Enquête de notre n°69 « Éducation populaire », disponible en kiosque, sur notre boutique et sur abonnement.
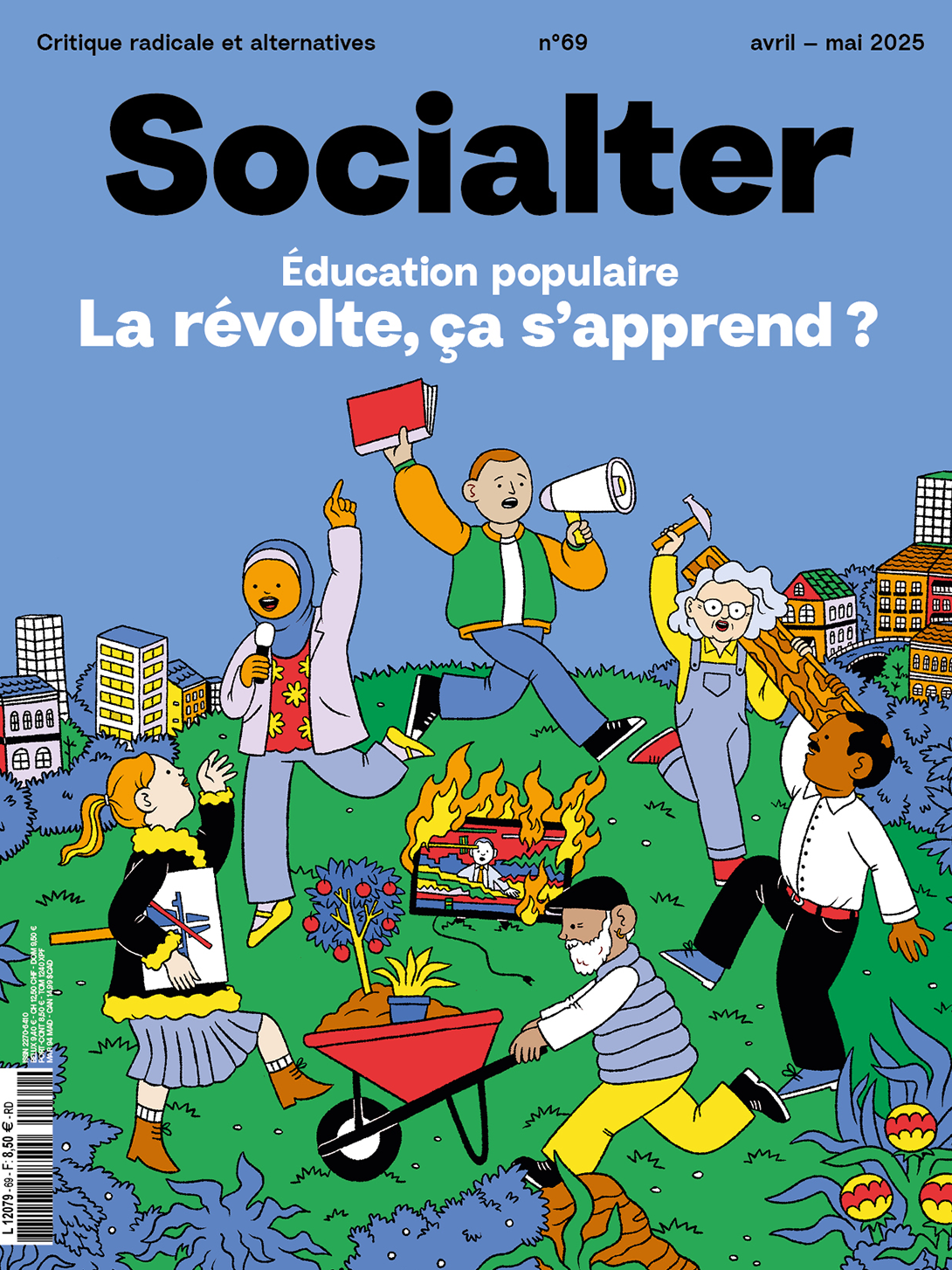
Chaque seconde, environ 100 vêtements, chaussures ou linge de maison sont mis sur le marché en France selon les données de l’Agence de la transition écologique (Ademe) – un chiffre qui a doublé en vingt ans. Chaque seconde, une quantité quasi équivalente est jetée. En un an, cela représente plus de 3 milliards de pièces abandonnées après avoir été portées un peu, beaucoup ou pas du tout. Les deux tiers de ces « déchets » ne sont ni abîmés ni usés, souligne un rapport parlementaire publié en mars dernier. De la production des matières à la fabrication des vêtements jusqu’à cette fin de vie de plus en plus précoce, l’industrie de la mode est devenue l’une des plus destructrices du monde.
En France, une filière de recyclage et réemploi des textiles usagés tente de maîtriser la casse écologique mais aussi financière. « L’élimination de ces déchets dans la filière générale des ordures ménagères est évaluée à plus de 200 euros par tonne collectée, à la charge du contribuable », indique un rapport de l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable (Igedd). La valorisation, elle, coûte deux fois moins cher, en plus de réduire l’impact climatique et environnemental.
Aujourd’hui, environ 30 % des déchets textiles sont collectés au lieu d’être détruits, principalement via les conteneurs installés dans les rues. Les acteurs de la solidarité – comme Emmaüs ou la Ressourcerie du pays d’Arles – utilisent ce gisement pour alimenter leurs étals, répondre aux besoins des plus précaires et fournir leurs chantiers d’insertion (la filière emploie 2 240 personnes dont 28 % en insertion). Mais une fois servis, il reste encore des milliers de tonnes de vêtements. « Par exemple, notre ressourcerie écoule 7 à 9 tonnes de vêtements de seconde main, mais on en collecte 100 tonnes à l’année », explique Lisa Coinus.
Près des trois quarts des vêtements sont en fait achetés par des usines de tri qui les commercialisent. Et c’est de là que le problème est arrivé. « Il y a environ un an, les usines de tri ont arrêté de nous payer les fripes et puis depuis plusieurs mois ils ont complètement arrêté de nous les prendre », poursuit la couturière arlésienne. Une situation généralisée dans toute la France : 73 % des membres du Réseau national des ressourceries et recycleries ont des difficultés à écouler les vêtements collectés, révèle une enquête interne de cette organisation. Chez Emmaüs, acteur central de la filière, « on doit pousser les murs, certains ont construit des chapiteaux pour stocker les vêtements sans exutoire », décrit Louana Lamer, la responsable du service Développement économique et réemploi solidaire.
La Françafripes ?
Paul-Antoine Bourgeois gère une usine de tri de vêtements usagés en Normandie, Gebetex. Ce mois de février, il y a 700 tonnes de vêtements sur sa liste d’attente et ses lignes de triage sont débordées. Entre 2014 et 2023, la collecte a augmenté de 53 % selon les données publiées par Refashion, un éco-organisme agréé par les pouvoirs publics(1) pour soutenir le réemploi via une micro-taxe prélevée sur les achats de vêtements. « Nos outils de tri ne suffisent plus pour absorber ce flot croissant et continu », décrit le patron normand. Il a lancé la construction d’une nouvelle usine avec des machines puissantes et un système automatisé. « On va trier plus », assure-t-il. Mais le secteur s’asphyxie aussi pour d’autres raisons.
« Il y a assez de vêtements produits pour habiller l’humanité entière pendant des décennies. On arrête et on fait circuler l’existant. »
Parmi les vêtements qui terminent dans les usines de tri, 40 % ne sont plus portables et seront recyclés en isolant, en chiffons ou transformés en combustibles. Quelques-uns, les meilleurs, trouveront peut-être une place sur le cintre d’une boutique vintage en France, mais la majorité part à l’autre bout du monde. Le marché de la fripe française est basé sur le grand export, principalement vers des pays africains. « Au lendemain du premier conflit mondial, les empires coloniaux ont commencé à organiser la livraison de vêtements usagés à destination de pays en situation de dépendance coloniale, raconte la chercheuse Emmanuelle Durand dans son livre L’Envers des fripes (Premier Parallèle, 2024). À partir des années 1980, cette activité de collecte et de recommercialisation des vêtements usagés s’industrialise et prend les atours d’une économie très lucrative, globalisée et fortement hiérarchisée. »
Un business qui répond à une demande locale mais qui exporte aussi des montagnes de déchets de pays riches dans les pays pauvres. Au Ghana, l’un des grands importateurs de vêtements de seconde main, 40 % des fripes finissent directement à la poubelle, martèle une ONG locale, la Fondation Or. La poubelle est généralement n’importe où et c’est souvent l’océan. Ce modèle, problématique, ne fonctionne plus comme avant.
« De nouveaux acteurs ont débarqué sur le marché africain des fripes au cours des dernières années, notamment des entreprises chinoises avec des conteneurs de vêtements beaucoup moins chers que nos produits, parfois ce sont des fripes, parfois des vêtements neufs ultra-discount, parfois un mélange des deux », décrit Paul-Antoine Bourgeois, le dirigeant de Gebetex. Face à la concurrence qui se durcit, l’export français est à la peine – moins 11 % entre janvier 2022 et novembre 2024 selon les données douanières. Alors que le gisement explose, les usines s’engorgent et se déséquilibrent. « Un tropical mix (un ballot de fripes triées à destination du continent africain, NDLR) est descendu à 50 centimes le kilo », détaille Gebetex. Moins 20 % en six mois. « À ce tarif, on n’est plus rentable et toujours pas concurrentiel. On arrive à lutter seulement avec les produits premium. »
Dans le jargon du secteur, on parle de la « crème ». Un vêtement de très bonne qualité ou d’une marque prestigieuse qui pourra se revendre à bon prix. « Cela peut permettre de financer la gestion de la totalité du gisement des vêtements usagés, explique Emmanuelle Ledoux, directrice générale de l’Institut National de l’Économie Circulaire (Inec). Or, ces dernières années, le gisement monte en quantité mais baisse en qualité, ce qui met gravement en danger les opérations de tri. » Une partie de la « crème » est détournée par les sites de revente entre particuliers, comme Vinted. Surtout, les vêtements jetés sont à l’image de notre shopping.
Selon une étude du cabinet Kantar, 70 % des vêtements achetés par les Français sont des entrées de gamme. En octobre dernier, le PDG de La Poste révélait une info choc : un quart des colis distribués en France provenaient de deux entreprises, les géants de l’ultra fast-fashion Shein et Temu.
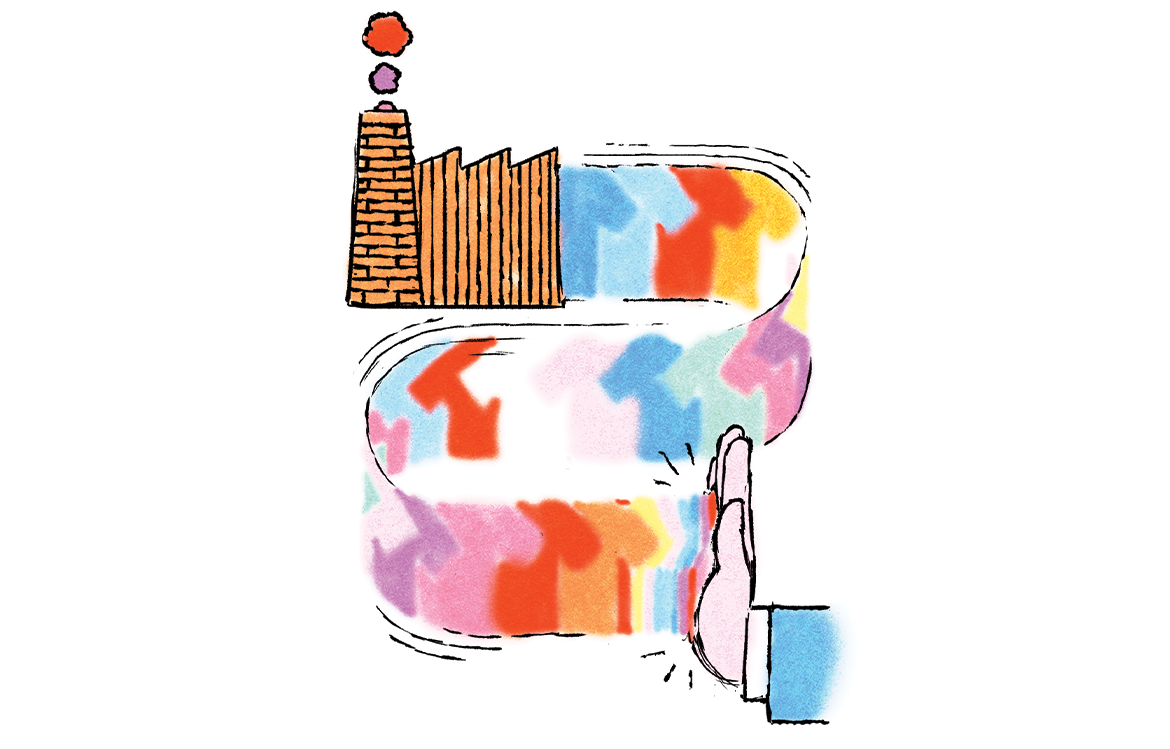
« On est inondé par leurs fringues et on ne trouve pas d’acheteurs en seconde main pour ces vêtements, résume le dirigeant de Gebetex. Ils ne sont pas recyclables non plus à cause des matières synthétiques utilisées. En fait, ce sont des fringues qu’on va brûler ! On les transforme en combustible. Et dans ce cas, cela ne nous rapporte rien, ça nous coûte même de l’argent ! »
En janvier, l’éco-organisme Refashion a débloqué une aide financière d’urgence – 31 euros par tonne triée pour l’année 2024, soit 6 millions au total – pour remettre à flot ce secteur du tri au bord de la faillite générale. Mais la crise a déjà des effets très concrets. Un centre de tri en Dordogne a déposé le bilan mi-février, laissant 200 associations de Nouvelle-Aquitaine sans solution. En Vendée, la Croix-Rouge a retiré tous ses conteneurs textile. Chez Gebetex, en Normandie, Paul-Antoine François s’attend à une collecte en baisse de 20 à 25 % cette année. « Écologiquement, c’est dramatique. »
Selon les objectifs fixés par l’État, le taux de collecte doit au contraire doubler d’ici trois ans d’après un arrêté de 2022. Ce mois de février, une directive cadre de l’Union européenne impose aussi de nouvelles règles pour valoriser encore davantage les textiles. « Un accord historique, se félicite François-Marie Grau, délégué général de la fédération française du prêt-à-porter féminin sur le réseau social LinkedIn. Mais la question reste de savoir ce que l’on va faire de tous ces déchets collectés ! En France, la question reste entière… »
Passer les fripes à la moulinette
« Le problème est fondamentalement structurel et semble irréversible », analyse Refashion dans un communiqué publié en novembre dernier. L’éco-organisme n’a pas souhaité répondre à nos questions. « Le modèle historique de gestion des déchets textiles, déjà malmené, sera très rapidement dépassé en raison des législations à l’échelle européenne, et du poids de la Chine sur le marché international de la fripe », écrit-il dans ce document. La sortie de crise serait, selon Refashion, dans « l’inéluctable transition vers un nouveau modèle » basé sur la création d’une industrie du recyclage en Europe en bonne et due et forme.
Aujourd’hui, 70 % des opérateurs de la collecte et du tri relèvent de l’économie sociale et solidaire (ESS) et priorisent le réemploi des vêtements en seconde main (c’est ainsi le premier poste de revenus pour les communautés Emmaüs). Refashion estime que « ce modèle hybride qui tente de concilier à la fois des objectifs sociaux et environnementaux a atteint ses limites ». Il préconise de passer toutes nos fripes à la moulinette dans des usines de recyclage pointues et gérées par des entreprises du secteur privé. Une entreprise de « casse sociale et associative », craint un responsable de la filière ESS qui souhaite rester anonyme.
La feuille de route est par ailleurs très périlleuse. Aujourd’hui, 0,1 % des vêtements sont recyclés pour refaire des vêtements. La technologie n’est pas au point, encore moins avec les matières synthétiques qui se généralisent. « Le moment où ce type de recyclage aura atteint la maturité et le stade industriel est encore incertain », précise un rapport de l’Ademe en 2023. « Mais pour le développement de ces filières en Europe, il y a encore beaucoup de freins à lever, décrit Louana Lamer, responsable chez Emmaüs. Techniquement, il faut encore nourrir des algorithmes pour parvenir à trier très finement par matière. »
Économiquement, les marchés ne sont pas encore là, souligne l’Ademe. Écologiquement, ce n’est pas non plus la solution à privilégier. Un constat documenté par l’éco-organisme Refashion lui-même dans une étude réalisée en 2022 : « La réutilisation en seconde main représente le plus grand bénéfice environnemental. (…) Cette conclusion reste valable en cas de réutilisation à l’export », indique-t-elle.
Selon les projections de l’Ademe, le recyclage n’est pas capable à une échelle de cinq à sept ans d’absorber les flots de vêtements usagés. Les capacités en France pourraient au mieux doubler d’ici 2030, permettant d’absorber 35 % de la collecte si les planètes s’alignent. Pour l’instant, les nuages s’amoncellent plutôt sur ce secteur émergent. « On observe un ralentissement des investissements dans le recyclage textile », rappelle l’Inec. L’une des expérimentations françaises les plus prometteuses et médiatisées, Carbios – qui tentait un process industriel de recyclage chimique des textiles pour fabriquer de nouveaux vêtements – a annoncé en décembre un plan de licenciement massif et le report de ses projets.
« La position de l’éco-organisme sur le tout-recyclage est délirante », lâche Catherine Mechkour, secrétaire nationale du Réseau National des Ressourceries et Recycleries. Selon elle, Refashion propose un mirage technologiste pour éviter de prôner l’autre alternative existante : la régulation de la production. En effet, un tel discours serait intenable pour le chef d’orchestre de la filière administré par les marques de vêtements elles-mêmes, comme Kiabi ou Décathlon. Une critique partagée par l’Inspection générale des finances qui pointe dans un rapport de juin dernier « une gouvernance de l’éco-organisme en conflit d’intérêts avec sa mission ».
« La sortie de crise est dans le rationnement de la production de vêtements, insiste la militante associative Catherine Mechkour. Il y a assez de vêtements produits pour habiller l’humanité entière pendant des décennies. On arrête et on fait circuler l’existant. » Le 14 mars 2024, une loi a été votée en première lecture à l’Assemblée nationale pour freiner, via un système de bonus-malus, le développement de la fast-fashion. Un premier pas. Un an plus tard, elle est toujours dans les limbes parlementaires, reportée sine die dans l’agenda du Sénat. Entre-temps, le lobbying de la fast-fashion se fortifie. En décembre, Shein a recruté en France un conseiller de taille : l’ancien ministre de l’intérieur, Christophe Castaner, qui n’a pas tardé à donner son avis sur cette loi en suspens : « Dégueulasse. »
1. Un éco-organisme chargé d’une filière Responsabilité élargie du producteur (REP) est une organisation agréée par les pouvoirs publics pour organiser et financer la collecte, le tri, la valorisation et le recyclage des produits en fin de vie de cette filière. Il est financé par les contributions des producteurs, une « éco-contribution ».
Soutenez Socialter
Socialter est un média indépendant et engagé qui dépend de ses lecteurs pour continuer à informer, analyser, interroger et à se pencher sur les idées nouvelles qui peinent à émerger dans le débat public. Pour nous soutenir et découvrir nos prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner !
S'abonnerFaire un don