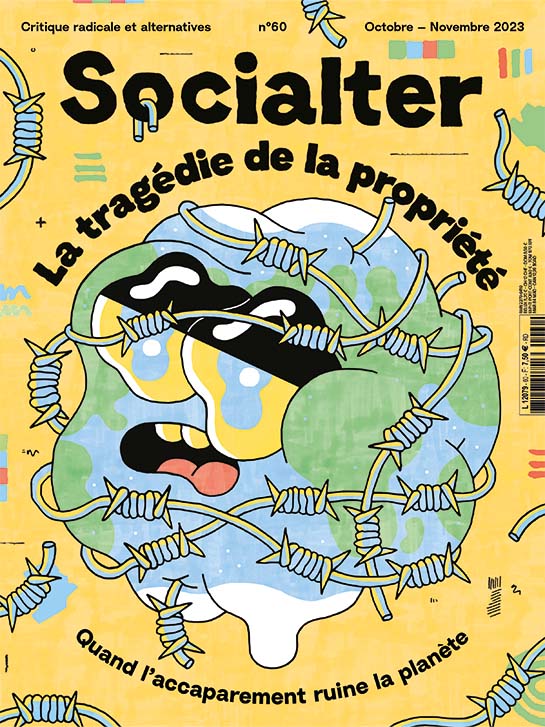« Un frigidaire, un joli scooter [...], des draps qui chauffent, un pistolet à gaufres, un avion pour deux, et nous serons heureux ! » En 1956, dans La Complainte du progrès, Boris Vian usait d’une figure de style fort à propos, l’accumulation, pour décrire cette société française qui se convertissait dans l’euphorie à la consommation de masse. Sur le même air, on pourrait sans mal prolonger ses paroles : « un casque de réalité virtuelle, une montre high-tech, une trottinette électrique, une enceinte Bluetooth… ».

Notre quotidien n’a en effet cessé, depuis les années 1960, de se consteller de nouveaux gadgets dont nous sommes sommés de faire l’acquisition pour avoir une chance d’accéder au bonheur. En parallèle, la surabondance d’objets plus banals s’est naturalisée : nos tiroirs débordent de vêtements que nous ne portons jamais ; nos placards, d’appareil à raclette, de perceuse, de taille-haie que nous utilisons au mieux une fois tous les six mois ; nos poches, de portables qui deviennent – obsolescence oblige – des objets antiques ou inutilisables en moins de deux ans ; nos étagères, de livres, de vinyles et de DVD que nous aurions très bien pu emprunter à la bibliothèque municipale, et qui ne servent que de pompeux décorums à nos intérieurs.
Article issu de notre numéro 60 « La tragédie de la propriété », en librairie et sur notre boutique. Cette thésaurisation matérielle procède d’une logique,
celle du productivisme et de son rejeton, le consumérisme. Équiper quantitativement chaque ménage en lui faisant acquérir une multitude d’objets a été considéré comme une amélioration qualitative du niveau de vie, quand bien même la satisfaction de la plupart de ces besoins était déjà assurée par des services collectifs.
Transports en commun, cinémas et laveries d’immeubles sont subitement devenus ringards ; aujourd’hui, 84 % des ménages possèdent une voiture, et plus de 95 % un téléviseur ou un lave-linge 1.
Allonger la durée de vie des produits

En substituant à chaque ressource collective une consommation individuelle, les
industriels et les marketeurs s’assuraient non seulement de nouveaux débouchés,
mais aussi du renouvellement perpétuel des produits qu’ils vendent à des consommateurs devenus captifs. L’obsolescence n’est plus seulement programmée : elle est devenue systémique, à l’origine de cette «
humanité massifiée et mutilée » 2 décrite par le philosophe
André Gorz (lire p. 20-23) qui, en étant mise au service de la production, n’est plus préoccupée que par le développement de son pouvoir d’achat et par la jouissance solitaire de biens privatisés. Mais la propriété et l’usage des biens de consommation peuvent aussi très bien être disjoints. Une idée qui n’a rien de neuf mais qui, à la lumière de l’impératif de sobriété porté par le discours écologique, prend une dimension inédite.
C’est ce que défendent les acteurs de l’économie de la fonctionnalité en proposant non plus de vendre des objets, mais de mutualiser leur utilisation.
La coopérative
Commown, fondée en 2018, met par exemple à disposition des appareils électroniques (smartphones, ordinateurs, casques audio) moyennant un abonnement pour leur location. Pour Adrien Montagut, son cofondateur,
l’idée est de lutter contre la gabegie de ressources que représente le numérique dans toutes ses formes d’obsolescence (technique, esthétique et logicielle) : « Nous voulions rompre avec le mécanisme de vente car, dès lors qu’il y a transfert de propriété, cela signifie qu’on se déleste de la responsabilité du produit. » La coopérative se distingue alors de toutes les offres de location avec option d’achat, aussi appelées leasing, dont certaines « proposent de renouveler votre
smartphone au bout de trois mois d’utilisation, c’est aberrant ! », s’agace Adrien Montagut. Le but de Commown est, au contraire, « d’offrir un service qui allonge la durée de vie du produit, explique-t-il, raison pour laquelle nous proposons des appareils éco-conçus, durables, facilement réparables et sous OS libre, afin de démocratiser l’électronique responsable et promouvoir une société où les gens parviennent à s’autonomiser et à diminuer leurs usages ». D’ailleurs, pour Adrien Montagut, « si l’on veut continuer à avoir accès au numérique, il faudra sans doute un jour renoncer à l’usage individualisé de terminaux ».
Mutualiser les objets

Mais comment inciter le maximum de personnes à consentir au partage en lieu et place de l’accès exclusif des objets du quotidien ? Pour Yann Lemoine, «
il est utopiste de penser que les gens vont changer radicalement leur manière d’être et de consommer, ou qu’ils vont choisir spontanément de se serrer la ceinture pour la seule raison environnementale ». Fondateur de la société
Les Biens en commun, il a conçu un service de mutualisation qui reproduit tous les avantages de la propriété traditionnelle, condition pour que les individus aient envie d’y renoncer. « Il faut que l’usager ait la garantie de trouver l’appareil qu’il cherche, qu’il soit à proximité et disponible au moment où il en a besoin, qu’il soit autonome pour s’en servir et, aussi, que l’appareil fonctionne », énumère cet ancien
ingénieur agronome. Son concept : des casiers connectés dans des halls d’immeuble avec, à l’intérieur, des objets dont on ne se sert qu’occasionnellement (crêpière, aspirateur, perceuse…). Chaque utilisateur paie alors pour avoir accès à l’appareil au moment où il en a besoin et peut déverrouiller le casier après avoir réservé son créneau d’utilisation.
Les Biens en commun se chargent alors de faire les tournées d’entretien et de réparer les équipements. « Le pari, c’est de faire en sorte que les gens aient accès à de meilleurs produits, plus résistants et plus réparables. Car en mutualisant des objets, on mutualise aussi le pouvoir d’achat, et on peut se payer un aspirateur à 250 euros. »
À terme, le but est aussi d’impliquer les usagers en les laissant décider de quels appareils ils veulent collectivement se doter. Le risque ? « Les effets rebonds, concède Yann Lemoine. Comment être sûr que les utilisateurs ne vont pas vouloir des objets “de luxe”, comme des trottinettes électriques ou des casques de réalité virtuelle, et continuer d’acheter individuellement leurs propres appareils domestiques… Il ne faut pas que les appareils mis à disposition dans les casiers se surajoutent à l’équipement des ménages. » Raison pour laquelle la société Les Biens en commun n’est, selon son fondateur, « qu’une étape » et que « c’est la société qui doit s’engager dans son ensemble vers plus de sobriété, en diminuant le temps de travail et en investissant massivement dans les services publics et les emplois “non productifs” ».
Le partage contre « l’absolutisme propriétaire »
« Il faut renouer avec l’idée selon laquelle le partage ne nous prive de rien mais, au contraire, est plutôt de nature à nous enrichir. » - Pierre Crétois
Autant d’initiatives qui tentent de faire dérailler la surproduction d’objets et opposent un contre-modèle à la propriété privée pour de nombreux objets du quotidien, prouvant par le fait qu’elle n’a rien d’un horizon indépassable. « Il existe de nombreuses choses dont on jouit mieux lorsqu’elles sont partagées que lorsqu’elles nous appartiennent exclusivement : les ressources socialisées comme les livres disponibles dans les bibliothèques, ou encore un concert, l’accès à la santé ou à l’éducation », indique le philosophe Pierre Crétois, auteur de
La Part commune (Amsterdam, 2020),
pour qui « l’absolutisme propriétaire » est l’une des causes des désastres écologiques, dans la mesure où il permet d’arracher une chose à la communauté et d’en devenir le maître absolu, sans jamais avoir à rendre de comptes. Selon ce dogme, on peut tout faire avec ce qui nous appartient et l’exploiter sans limite.
On peut, par exemple, posséder une voiture polluante ou faire usage de pesticides dans son champ, alors même que ces usages ont des effets destructeurs sur l’environnement et menacent l’avenir de l’humanité. Il faut donc redéfinir les bornes de nos droits sur les choses. Mieux : il faut renouer avec l’idée selon laquelle le partage ne nous prive de rien mais, au contraire, est plutôt de nature à nous enrichir. »
Un chambardement d’une telle ampleur qu’il ne pourra jaillir que par l’émergence d’un cadre réglementaire contraignant, imposé par la puissance du collectif – par exemple, en décidant que tel bien de consommation doit être mis à disposition des locataires pour les résidences dépassant un certain seuil d’habitants. Alors que, depuis quelques mois et sous l’effet de la pandémie de Covid-19, des pénuries à répétition de composants électroniques et de
matières premières provoquent le ralentissement de nombreuses industries, jouir en commun d’objets dont nous nous réservions habituellement l’usage et décider collectivement de ce que la société a vraiment besoin de produire apparaît de plus en plus comme nécessaire.
1. Tableaux de l’économie française, Insee, 27 février 2020.
2. André Gorz, Stratégie ouvrière et néocapitalisme, Le Seuil, 1964.
Sources : « Les appareils électriques dans les foyers français », étude commandée par la filière DEEE (Déchets d’équipements électriques et électroniques) à Ipsos/Ecologic, 2017 ; Ademe, 2018, 2019 et 2020 ; Les Biens en commun.
Soutenez Socialter
Socialter est un média indépendant et engagé qui dépend de ses lecteurs pour continuer à informer, analyser, interroger et à se pencher sur les idées nouvelles qui peinent à émerger dans le débat public. Pour nous soutenir et découvrir nos prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner !
S'abonnerFaire un don