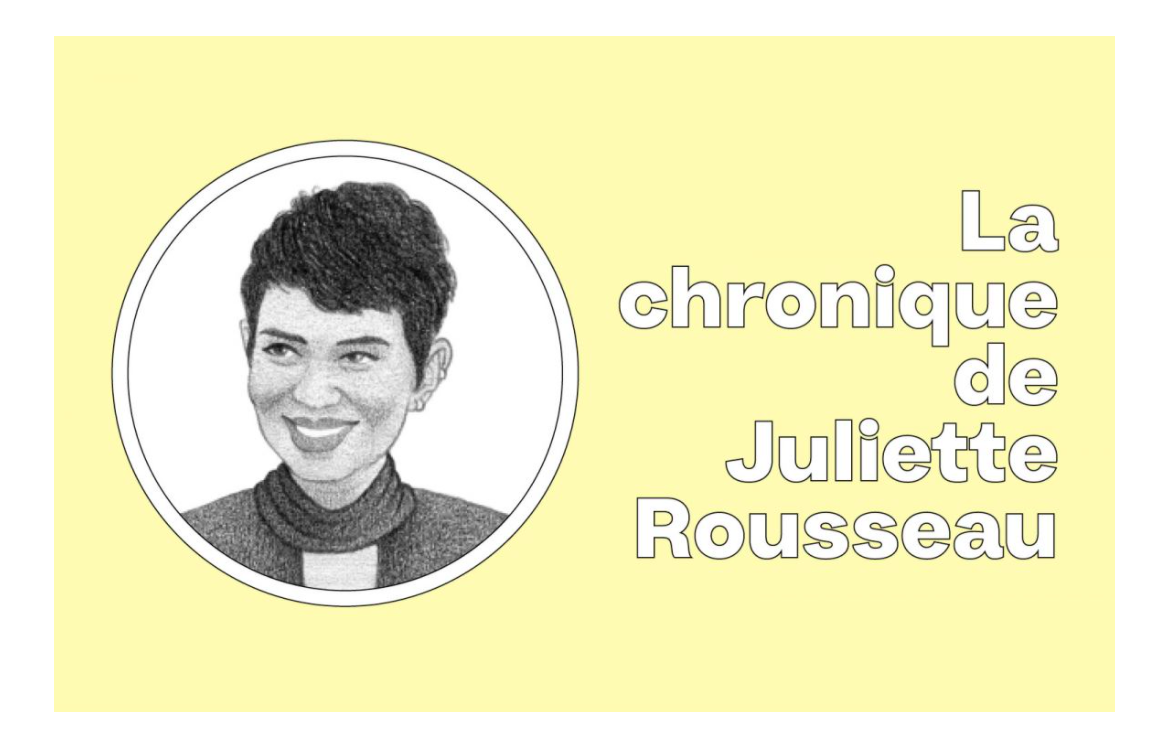Qu’y a-t-il à l’origine d’un mouvement de lutte ? Est-ce une combinaison particulière de désirs et de colères ? Une vision puissante et partagée de ce à quoi le monde pourrait ressembler ? Est-ce un certain degré de conscience politique ? Ou bien l’injustice qui franchit un seuil ? Lorsque l’on aspire au changement social dans le sens d’une plus grande justice pour toutes et tous, cette question peut devenir obsédante. Dans ce qui féconde une lutte, le renoncement peut être une tension fertile : il y a ce à quoi l’on doit renoncer, pour créer d’autres mondes plus habitables, y compris ici et maintenant, et ce à quoi l’on ne peut pas renoncer. Parfois, c’est cela qui constitue le point de départ d’une révolte. Quand il nous est imposé de renoncer à ce à quoi l’on tient. Et c’est la brutalité de cette imposition qui met en mouvement.
Retrouvez cette chronique dans notre numéro 50 « À quoi devons-nous renoncer ? »
La vie dans un monde en proie à l’exploitation, la domination et la destruction est un chemin pavé de renoncements : on renonce à habiter des mondes riches et abondants, à mener des vies profondément attachées à nos territoires, à ceux, humains et non humains, avec qui nous les partageons, à l’interdépendance de ces liens. Ce que le confort anesthésiant offert par le capitalisme vise à étouffer en nous, c’est précisément la capacité à ressentir ce à quoi nous devons renoncer pour que le système perdure.
C’est la barquette de viande qui dissimule la maltraitance animale à l’échelle industrielle ; ce sont les îlots verts qui cachent la bétonisation grandissante des terres et la disparition du vivant ; ce sont les institutions spécialisées qui camouflent l’abandon et l’enfermement des personnes âgées ou en situation de handicap. Le système capitaliste troque la justice et le partage contre le confort des plus privilégiés et tente de nous priver de la capacité à éprouver tristesse et colère face au deuil inhérent aux multiples pertes qu’il engendre. Et c’est aussi ce que produisent les dominations systémiques : patriarcat, racisme, validisme... construisent une société prompte à accepter que les plus grandes violences – jusqu’à la mort parfois – soient infligées par certains de ses membres.
Prospérer parmi les ruines
S’il peut être effrayant, le chemin qui consiste à se laisser plus profondément toucher par la dimension mortifère de notre société est aussi le plus sûr chemin vers la révolte. Il nous faut apprendre à nous départir de cette immunisation inhérente à la violence sociale et à habiter plus pleinement les décombres. Souvent, c’est là que se construisent des formes de vie audacieuses, généreuses. Dans une émission de radio consacrée à la lutte contre le sida, l’historien Philippe Artières déclarait au sujet des militantes et militants de l’époque de la pandémie de VIH : « [Avant eux] il n’y avait pas de pratiques collectives comme celle-là, il n’y avait pas cette sociabilité qu’ils ont été obligés d’inventer pour ne pas être seuls […]. C’est une vraie esthétique de l’existence, une esthétique contrainte. Ce n’est pas une question de courage, c’est une question de force collective, de surgissement, de subjectivation. […] Il y a toujours, et même face aux situations les plus insupportables qui soient, des possibles d’invention politique. Notre société est pleine de ces lieux où des personnes en situation d’immense détresse inventent des modes de résistance. »
Lutter avec et parmi les morts et la disparition, dans cette tension entre l’impossibilité d’accepter cet état de fait et la nécessité de composer avec lui. Lutter en portant en nous ce à quoi l’on est forcé de renoncer sans pour autant l’accepter, et tout ce qui, dans le chemin que l’on trace à partir de là, est également de l’ordre du renoncement et de son refus. Le militantisme des années sida a beaucoup à nous apprendre sur les façons d’habiter et de résister dans un monde en déclin. Notamment dans notre capacité à ne plus fuir le deuil, à embrasser ce qu’il implique dans l’élaboration collective d’une subjectivité en prise réelle avec notre monde.
Ce à quoi il n’est pas possible de renoncer peut donc mettre en mouvement. Et dans ce mouvement peuvent alors apparaître d’autres manières de vivre, qui viennent renforcer la détermination à protéger ce qui a été construit collectivement. Le refus de renoncer ne porte plus seulement sur ce qui a initié la lutte mais également sur ce que la lutte a fait de nos vies, notre capacité à créer un autre monde, ici et maintenant. C’est ce que les anglophones appellent « politiques de préfiguration ». C’est, par exemple, ce qu’Occupy Wall Street a tenté (et largement « publicisé »), à savoir la capacité à abolir, dans un temps et un espace donnés, une partie de ce qui conditionne nos vies dans le capitalisme : l’hyper-individualisation des modes de vie, les échanges marchands, le recours à la police pour encadrer les conflits... La brèche ainsi créée ouvre un espace de respiration auquel il n’est dès lors plus concevable de renoncer.
Ne pas craindre d’être vulnérable
Derrière la question du renoncement, ce qui se joue, c’est aussi la question de la vulnérabilité. Mettre en jeu et investir des attachements menacés par le système existant, c’est s’exposer. C’est ce qui m’a souvent marquée dans les occupations, comme sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes : comment, dans les moments où la menace d’expulsion se faisait la plus forte, des centaines de personnes pouvaient mettre toute leur énergie à construire des cabanes solides, splendides, résolument faites pour durer. Et s’exposer ainsi à des pertes qui n’en seraient que plus difficiles à vivre. Je me souviens en particulier d’une scène, lors des expulsions du printemps 2018, lorsque les gendarmes sont venus détruire le lieu-dit des « 100 Noms ».
À quelques centaines de mètres de moi, une habitante errait, en larmes, appelant désespérément son chat. Elle a fini par tomber à genoux dans l’herbe, abattue face au spectacle de sa maison en train d’être détruite. Le temps, l’énergie, les amitiés, tout ce que nous investissons face aux bulldozers nous expose à ressentir plus cruellement la perte. Or c’est un choix qui nous est particulièrement difficile, car notre éducation nous incite à craindre toute situation de vulnérabilité, à croire qu’une vie réussie est une vie de confort garanti. Carrière, salaire, propriété, mariage sont autant d’outils qui visent à nous prémunir contre un sentiment de vulnérabilité. Pourtant, plus nous mettons de nous dans ce qui dépérit, ce qui disparaît, ce qui se meurt, plus nous sommes déterminés à le défendre. C’est ce que les opposants au projet d’aéroport avaient très bien compris : plus nous étions nombreux à nous attacher à cette lutte à travers le lieu qu’elle visait à défendre, à y nouer des liens, plus nous serions déterminés et mobilisés.
Dans l’échange morbide qui nous est imposé entre confort personnel et justice collective, c’est sans doute là que se joue, véritablement, la question du renoncement. Dès lors, habiter les lignes de front de ce monde, y forger nos attachements et nouer là ce à quoi il n’est pas possible de renoncer est peut-être la meilleure façon de lutter contre la destruction en cours.
Soutenez Socialter
Socialter est un média indépendant et engagé qui dépend de ses lecteurs pour continuer à informer, analyser, interroger et à se pencher sur les idées nouvelles qui peinent à émerger dans le débat public. Pour nous soutenir et découvrir nos prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner !
S'abonnerFaire un don