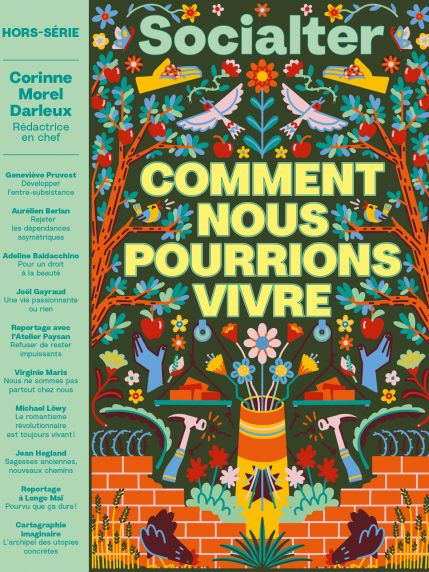L’expansion accélérée de l’habitat humain se fait au détriment d’espaces existant sans nous. Quelle est cette « part sauvage » que vous appelez à préserver ?
Elle désigne les milieux que nous n’avons pas créés et qui existent par eux-mêmes, indépendamment des projets humains. Cette notion est l’héritière lointaine du courant américain de la wilderness, concevant le sauvage comme ce qui est vierge de tout geste humain. Mais cette approche est doublement problématique. D’abord, la wilderness est empêtrée dans le mythe colonial qu’elle colporte, effaçant la présence autochtone antérieure. Mais elle ne correspond pas non plus à l’époque actuelle, l’Anthropocène, car l’influence des activités humaines est perceptible à un niveau global : le changement climatique affecte la biosphère dans son ensemble, y compris là où personne ne vit.
Retrouvez cet article dans notre hors-série « Comment nous pourrions vivre » sous la rédaction en chef de Corinne Morel Darleux. Disponible sur notre boutique en ligne.
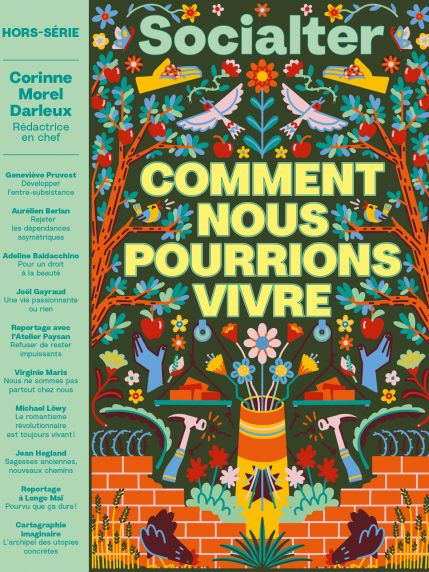
Conserver une définition maximaliste du « sauvage » en l’associant à ce qui est vierge conduirait à la conclusion absurde que le sauvage n’existe plus. J’essaie donc de penser cette « part sauvage » non pas comme une absence totale d’influence humaine, mais plutôt comme la capacité propre de certains êtres et de certains milieux à se développer par eux-mêmes. En débarrassant le sauvage de cette idée de pureté, on peut à nouveau le trouver dans la capacité d’un milieu à retrouver spontanément son fonctionnement, même après avoir été touché par les activités anthropiques. Cette définition ouvre aussi la possibilité pour les humains de réimpulser une autonomisation des milieux pour recréer du sauvage.
En quoi cette part sauvage est-elle actuellement en danger ?
Aujourd’hui, l’anthropisation des milieux est d’une puissance incomparable. L’intensification agricole et le développement urbain sont deux facettes d’un même régime d’accaparement capitaliste et productiviste. Cette suroccupation du monde conduit à une crise du vivant sauvage, avec un déclin de la biodiversité qui s’apparente à une sixième extinction de masse. Une estimation vertigineuse souligne que la biomasse des mammifères terrestres était composée il y a 10 000 ans, soit au seuil de la naissance de l’expansion de l’agriculture, de 97 % d’animaux sauvages contre 3 % d’êtres humains.
À présent ce rapport s’est inversé : les animaux sauvages représenteraient 3 % de la biomasse totale des mammifères terrestres, les humains 37 % et les animaux domestiques 60 %. Enfin, la dégradation des milieux naturels atteint un rythme catastrophique, avec l’équivalent d’un département artificialisé tous les dix ans en France et, à l’échelle mondiale, l’équivalent en superficie de la Grande-Bretagne de forêts tropicales détruites.
Cela doit-il remettre en question nos façons d’habiter à l’heure de l’Anthropocène ?
Nous vivons une époque charnière. Sans effort conscient, concerté et coordonné d’autolimitation, nous allons probablement voir disparaître de façon irréversible l’héritage de l’évolution. Il s’agit donc d’un momentum qui doit interroger notre façon d’occuper la Terre. Cela doit notamment nous inciter à penser des formes de retrait : il est urgent que l’humain cesse de se sentir partout chez lui. Pour lutter contre l’habitation totale et hégémonique du modèle occidental et de ses formes postcoloniales contemporaines, il faut mettre en œuvre des politiques ambitieuses de protection des milieux naturels.
Comment une telle vision peut-elle s’incarner ?
De nombreuses pistes sont à explorer. Une de celles qui m’intéressent porte sur la notion de déshabitation, avec l’idée d’autolimiter l’expansion des sociétés industrielles et d’engager un repli stratégique afin de laisser place à la nature, notamment via des politiques de réensauvagement. Je défends l’importance de la protection forte, comme dans les cœurs de certains parcs nationaux, avec des surfaces importantes au sein desquelles les activités humaines sont fortement limitées et réglementées. Au-delà, je pense qu’il serait bon de multiplier et de pluraliser les formes de protection à toutes les échelles, comme autant d’espaces de répit, de respiration pour le monde sauvage : des forêts en libre évolution sans coupes ni chasse, des friches laissées à elles-mêmes pour que s’expriment des dynamiques inédites de recolonisation, des cours d’eau moins contraints par nos digues et nos ouvrages hydrauliques…
Cela peut prendre la forme d’acquisitions foncières, telles que les Réserves de vie sauvage de l’Association pour la protection des animaux sauvages (Aspas), ou encore passer par des initiatives privées via des réseaux de propriétaires fonciers engagés pour la libre évolution dans leurs forêts. De telles démarches peuvent avoir un bénéfice écologique significatif, mais il me semble qu’elles présentent une carence politique importante : elles ne contribuent pas directement à transformer les relations entre sociétés et nature ; pire, elles peuvent être vécues localement comme des formes de privatisation de la nature, qui seraient tour à tour portées par l’État, une aristocratie de grands propriétaires ou encore des bobos urbains.
Comment éviter cet écueil ?
Il n’y a pas de réponse facile. Il me semble que la préservation du monde sauvage ne doit pas fonctionner en vase clos : il s’agit d’articuler ces initiatives avec l’invention de formes politiques stimulantes, afin d’initier une réelle transformation sociale. C’est l’objet d’un axe de travail du collectif Reprise de terres, au sein duquel nous réfléchissons à la façon d’introduire cet enjeu de protection du monde sauvage dans une dynamique plus large de luttes foncières et de défense de la paysannerie. L’idée serait probablement d’inventer des formes locales et participatives de sanctuarisation. Quelque chose de cet ordre a été expérimenté dans le parc naturel régional des Vosges.
Il a été proposé que chaque commune choisisse, de façon participative, un site dédié à la libre évolution. Le modèle du parc national, avec un « cœur de parc » très protégé, une zone d’adhésion qui l’entoure avec des activités humaines douces, et, à l’extérieur, une succession de zones d’agriculture intensive, de site industriels et logistiques et de métropoles tentaculaires complètement bétonnées offre une image tristement caractéristique de notre situation : quelques îlots préservés au milieu d’une mer suranthropisée. C’est absolument insatisfaisant, tant sur le plan écologique que sur le plan humain, car quels que soient la taille et le nombre d’îlots, l’essentiel du problème demeure. Pour cette raison, la préservation du monde sauvage ne peut faire sens que si elle s’articule sur des transformations systémiques radicales de notre société, en s’inscrivant au sein d’une matrice plus conviviale.
Comment envisager l’avenir des espaces urbains et leur interface avec le reste ?
Il est urgent de repenser les villes et les dynamiques de densification de l’habitat en sortant de régimes de contrôle ou d’éradication du monde sauvage. Cela implique des aménagements propices à la faune et à la flore dans nos villes grâce à un maillage de corridors – des « trames vertes et bleues » – permettant une circulation plus fluide des plantes et des animaux. L’objectif de la préservation n’exige pas nécessairement une exclusion totale de la présence humaine, mais seulement la mise en sourdine de l’accaparement des milieux et de ses potentialités par les activités humaines. Dans l’interface entre zones fortement anthropisées et espaces sauvages doivent ainsi s’intercaler des espaces où il serait possible de cultiver un rapport au monde sauvage autre que l’instrumentalisation ou l’appropriation, mais où l’on apprendrait aussi à se faire discret, à observer, à reconnaître l’altérité des autres qu’humains.
Notre monde est petit à petit amputé d’une immense partie de ses habitants. On s’habitue ainsi à ne plus croiser de lapins en Camargue, à ne plus observer de lucioles la nuit ou à ne trouver que des poissons ridiculement petits sur les étals du marché.
Ces interfaces seraient-elles le moyen d’éviter un « syndrome de la référence glissante » à grande échelle ?
Le syndrome de la référence glissante est énoncé par le biologiste marin Daniel Pauly à partir d’une observation : ses collègues tendaient à considérer que le bon état de conservation des espèces sur lesquelles ils travaillaient était celui qu’ils avaient observé au début de leur carrière. Génération après génération, on en vient à considérer comme acceptable une situation qui est en fait très dégradée, mais comme il s’agit d’une dégradation lente et progressive, on ne s’en rend pas compte. Cela nous concerne directement, car notre monde est petit à petit amputé d’une immense partie de ses habitants. On s’habitue ainsi à ne plus croiser de lapins en Camargue, à ne plus observer de lucioles la nuit ou à ne trouver que des poissons ridiculement petits sur les étals du marché : on finit par y voir une situation normale, et donc ne même plus souhaiter de restauration. Cette amnésie environnementale réduit les ambitions ; il est urgent de conjurer cet oubli de la richesse du monde sauvage et de déverrouiller nos horizons.
Pour autant, une migration à trop grande échelle des urbains vers les campagnes ne serait-elle pas un problème ?
La néoruralité me semble plutôt salvatrice et signale finalement le caractère pathologique de la façon dont nous avons conçu une vie en ville totalement déconnectée des systèmes de subsistance qui la rendent possible. Bien entendu, cela ne doit pas conduire à reproduire un mode de vie hyperconsumériste dans ces espaces ruraux, puisqu’on serait dans le pire des deux mondes. Dédensifier à mode de vie constant ne peut être que catastrophique, par exemple si chacun veut son chalet, son SUV et sa 5G. Mais si ce report s’effectue vers les villages et villes moyennes et qu’il s’accompagne d’une reprise en main de nos conditions de subsistance, ce serait un moyen de commencer à transformer en profondeur notre matrice économique. Et pourquoi pas en imaginant des unités biogéographiques qui fassent sens, comme des biorégions cohérentes avec l’espace écologique et géographique – bassins versants, vallées, deltas… Elles permettraient de repenser les schémas de production ajustés aux potentialités du territoire en même temps que l’ancrage politique des individus.
La possibilité de limiter l’occupation spatiale des humains renvoie à l’épineuse question démographique. Comment l’aborder sainement, en évitant toute stigmatisation d’un excès de population ?
Le sujet est en effet gênant. J’aborde cette question avec un esprit pragmatique. La taille de la planète est un paramètre, pas un problème. De la même façon, la taille de la population humaine est un paramètre dont il faut tenir compte, et pas le problème qu’il faut régler. C’est de ma part un choix éthique de prendre des distances avec de nombreux discours environnementalistes néomalthusiens qui relèvent in fine d’une vision du monde souvent patriarcale et coloniale, puisque c’est la consommation par personnedans les pays riches bien plus que la taille de la population mondiale qui est aujourd’hui insoutenable. L’enjeu est de penser la persistance d’une part sauvage dans un monde aussi densément peuplé que le nôtre.
Biographie
Virginie Maris est philosophe de l’environnement au CNRS et travaille au Centre d’écologie fonctionnelle et évolutive (CEFE) à Montpellier. Elle est l’autrice de Philosophie de la biodiversité. Petite éthique pour une nature en péril (Buchet-Chastel, 2010), Nature à vendre. Les limites des services écosystémiques (Quæ, 2014) et La Part sauvage du monde. Penser la nature dans l’Anthropocène (Seuil, 2018).
Soutenez Socialter
Socialter est un média indépendant et engagé qui dépend de ses lecteurs pour continuer à informer, analyser, interroger et à se pencher sur les idées nouvelles qui peinent à émerger dans le débat public. Pour nous soutenir et découvrir nos prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner !
S'abonnerFaire un don