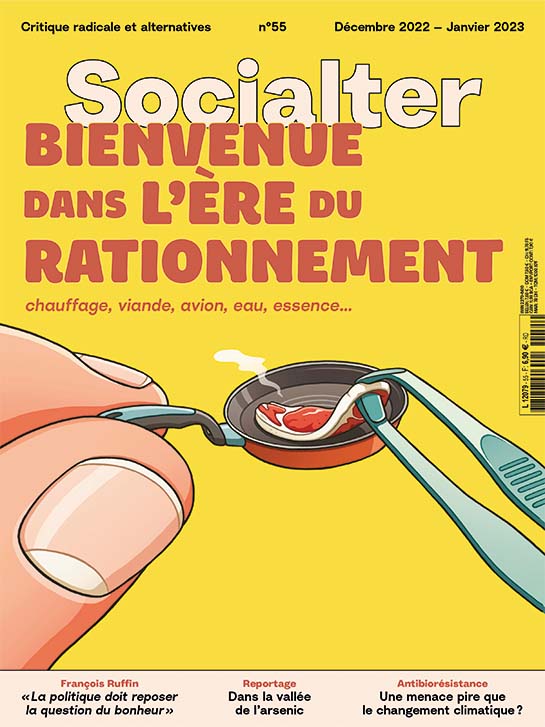Vous qualifiez dans votre livre à paraître, Le Temps d’apprendre à vivre, la réforme des retraites voulue par Emmanuel Macron de « folie ». Pourquoi ?
Dans quel état se trouve notre société ? On sort de deux années de crise Covid, la France est déprimée, usée. Et les scrutins du printemps ont donné quoi ? Une réélection du président sans élan, sans enthousiasme, sans projet. Derrière, un pays fracturé en trois blocs : le bloc national autoritaire, le bloc progressiste de gauche et le bloc libéral. Il faudrait ajouter un quatrième bloc, composé de tous ceux qui sont en réalité nulle part, le bloc le plus important, hétérogène, uni par la seule indifférence. Ajoutez que les salaires sont rognés par l’inflation, que les Français ignorent comment ils vont payer leurs factures…
Entretien à retrouver dans notre numéro 55 « Bienvenue dans l'ère du rationnement », en librairie et sur notre boutique.
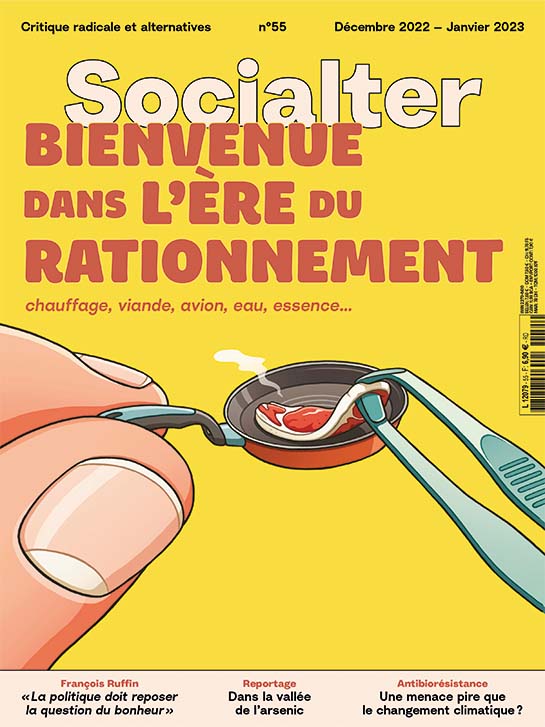
Et c’est dans cette ambiance, sur ce socle extrêmement rétréci, qu’Emmanuel Macron s’imagine pouvoir mener cette réforme ? Contre, d’après les sondages, sept Français sur dix ? C’est une folie. Je ne parie pas sur une explosion sociale, je ne sais pas. En revanche, une certitude : on installe du ressentiment. Les gens se disent : « Si c’est ça la démocratie, à quoi bon la démocratie ? »
C’est un nouvel épisode, après le traité constitutionnel européen de 2005 (lire ci-contre), 55 % des Français avaient voté non, 81 % des ouvriers, et les partis s’étaient assis dessus. Idem avec le mouvement des Gilets jaunes, un million de personnes sur les ronds-points, des dizaines de millions en accord sur l’essentiel, mais qui ne débouche sur aucun compromis : rien sur le référendum d’initiative citoyenne, rien sur la TVA à 0 % pour les produits de première nécessité, rien sur le retour de l’impôt de solidarité sur la fortune, etc. Tout cela installe du ressentiment. Et ça ne glissera pas naturellement vers nous, vers la gauche, sans une espèce d’alchimie qui transforme le ressentiment en espérance.
L’état du pays doit nous mener à un autre constat, modeste, modéré : même si nous étions au pouvoir, nous n’aurions pas le droit de faire des réformes contre les gens, sans avoir (en gros) deux Français sur trois avec nous. Nous ne pourrons pas imposer tout notre programme sous prétexte que nous avons fait 28 % au premier tour. La société est blessée, il faudra du doigté. Néanmoins, je pense qu’une vaste majorité peut exister, je ne considère pas qu’on soit dans un « pays de droite » où « tout est foutu ». Pour un vrai ISF, pour l’indexation des salaires sur l’inflation, etc., on peut avoir 80 % avec nous.
Pourquoi un tel acharnement du chef de l’État spécifiquement sur cette question des retraites ?
Il nous dit que c’est par « ambition réformatrice » ! C’est ça, son ambition, une mesure de comptable ? Qui imite Balladur, Sarkozy, Fillon ? Alors qu’affronter le choc climatique réclamerait une ambition, et des réformes, d’une toute autre ampleur ! Mais leurs « réformes », leur « courage », depuis quarante ans, c’est toujours d’aller contre les gens, contre le peuple. Jamais contre les marchés, contre les financiers. Depuis 2005 au moins, c’est une démocratie sans demos, contre le demos. Ils poursuivent dans la même direction, « concurrence, croissance, mondialisation », mais si ces trois mots ne sont plus porteurs d’enthousiasme ou d’envie, comme dans les années 1980. Désormais, ils dégoûtent. Nos dirigeants le savent.
« Une société écologique, c’est une société qui décide, qui choisit ensemble de se passer de productions. »
Il y a des signes politiques forts qui en témoignent, je l’ai dit (référendum de 2005, la crise des Gilets jaunes). Mais il y a aussi des signes plus infra-politiques : par exemple, quand on demande aux Français s’ils préfèrent accélérer ou ralentir, les deux tiers disent vouloir ralentir, qu’on manque de temps. Or, le maître mot de la macronie, c’est quoi ? « Accélération », tout doit accélérer. J’ai d’ailleurs noté une chose, sans vouloir trop donner dans la sémiologie : sur la photo présidentielle, Emmanuel Macron pose devant une horloge, il se veut « le maître du temps ». On dit que l’ère industrielle, c’était la machine à vapeur, ce qui est vrai, mais qu’on n’oublie pas l’horloge. Les ouvriers passaient sous les horloges quand ils entraient dans l’usine, et plus tard ils n’avaient pas le droit d’avoir de montre : la seule heure, c’était celle du patron. Et c’est un enjeu du mouvement ouvrier : redevenir maître de son temps, se libérer un peu. Macron veut nous enfermer, pas seulement dans l’usine, mais dans la roue du Capital : travailler plus pour produire plus, pour gagner plus, pour consommer plus… mais pour quoi faire ? C’est presque ce qui m’inquiète le plus, chez lui : une vision fonctionnaliste de l’humain, presque comme un robot.
On a un peu trop tendance à ramener la question du temps de travail aux 35 heures. En quoi est-ce aussi un choix de civilisation que de repousser l’âge légal de départ à la retraite ?
Il faut d’abord dire le miracle des retraites. Pendant des millénaires, vieillir dans les classes populaires, quand on avait la chance de vieillir, c’était vieillir dans la misère. En 1945, deux choses sont mises en œuvre : le minimum vieillesse et les retraites. Et là, en une génération, dans le milieu des années 1970, le taux de pauvreté des personnes âgées est divisé par quatre ! Il passe même sous la moyenne nationale ! Une fatalité millénaire est vaincue. Il faut dire l’efficacité de certaines décisions politiques, parfois ! À l’inverse, les relèvements successifs de l’âge de la retraite, les allongements de cotisations, produisent des contre-effets, déjà visibles : sur ces dix dernières années, le nombre de « séniors au RSA » a plus que dou
Pourquoi ? Parce que, passé 60 ans, et souvent même avant, dans plein de métiers, les corps sont usés, « inaptes ». La semaine dernière, on a organisé une rencontre à l’Assemblée nationale entre des caristes de Géodis à Gennevilliers et les auxiliaires de vie sociale de Domidom à Caen, les deux sont en grève depuis maintenant trois semaines. À un moment, les échanges ont tourné autour de ça : « D’où tu t’es fait opérer, toi ? » ou encore « Ah tu veux que je te montre ma cicatrice dans le dos ? » Voilà des corps marqués par le travail et par les charges à soulever. Pour eux, comme pour des millions de Français et de Françaises, deux années supplémentaires, c’est juste intenable.
Comment on arrive à proposer un discours de réduction du temps de travail, une diminution de la part du travail productif dans la vie et au cours de la vie, mais qui ne se fasse pas au prix de toujours plus de robotisation ou de délocalisation du travail pénible ?
En fait, j’aurais voulu prendre le débat par un autre bout. Dans son livre, Prospérité sans croissance (publié en 2009, traduit chez De Boeck en 2010, ndlr), l’économiste britannique Tim Jackson montre, par une simple courbe, une déconnexion entre les indices de bien-être et la course à l’abondance : au-delà de 15 000 dollars de PIB par tête de pipe, les indices de bien-être stagnent dans tous les pays qui dépassent ce seuil. En France, ça ne progresse d’ailleurs plus depuis le milieu des années 1970. Les États-Unis, qui ont l’un des plus hauts PIB par habitant au monde, sont aussi les champions de l’obésité, du taux d’incarcération… Dès lors, pour les pays développés, le « plus » ne signifie plus le « mieux ». C’est une rupture majeure dans notre histoire. Comme le note le philosophe Dominique Bourg, quand on a déjà mangé à sa faim, on n’a pas besoin de manger une seconde fois, et quand on a un frigo, ce n’est pas un second frigo qui apporte un supplément de bien-être. Ça devrait donc poser, logiquement, la question de savoir de quoi on a besoin – et donc du travail.
Que veut-on produire aujourd’hui ? Que ne veut-on plus produire ? Quand j’étais avec les salariés de chez Whirlpool sur leur piquet de grève, je leur disais : « Bon, après tout, franchement, des sèche-linges… Est ce qu’on en a besoin ? Le vent fait très bien son boulot depuis des siècles. » Les gars me répondaient : « Bah oui, nous non plus on n’en a pas des sèche-linges ! » À l’époque, j’étais considéré comme un « Amish » par la macronie, pour avoir dit ça, mais maintenant c’est Gilles Le Gendre qui nous dit qu’on peut s’en passer du sèche-linge ! En revanche, on a besoin de lave-linges ! Je ne me vois pas refaire la lessive à la main. On peut en avoir un usage plus collectif, peut-être, pour ne pas en produire des dizaines de millions, et aussi les produire en France.
Une société écologique, c’est une société qui décide, qui choisit ensemble, de se passer de productions. On pourrait aller vers une économie à deux vitesses : une économie des besoins et une économie des désirs. D’une part, s’assurer que les besoins sont remplis pour la totalité de la population – pour se soigner, pour s’éduquer, pour s’habiller, pour se loger, pour se nourrir – ; d’autre part, garantir des revenus suffisants pour que chacun puisse faire son « marché » dans l’économie des désirs selon ses goûts, ses appétences, sa sensibilité, son individualité…
Mais une société écologique réclame aussi beaucoup de travail. Une agriculture avec moins d’intrants chimiques, c’est un paquet de personnes qui vont avoir mal au dos à la fin de la journée, parce que biner les betteraves, c’est quand même quelque chose. Si on veut avoir dans chaque quartier des ateliers de réparation, de mécanique, d’informatique et d’électronique, c’est du travail ! Si on veut une véritable rénovation thermique des bâtiments, c’est des centaines de milliers de personnes qui doivent avoir envie de sauver la planète et d’aider leur pays en devenant maçon, couvreur, zingueur. Et c’est du travail ! Par ailleurs, faire basculer la société vers « moins de biens mais plus de liens », ça veut aussi dire des assistantes maternelles, des auxiliaires de vie sociale, etc.
Donc vous ne vous reconnaissez pas dans les discours qui parlent de la « fin du travail » ?
Non, et d’abord pour une raison morale. J’étais au bistrot avec un copain philosophe qui me vantait le revenu universel et la « fin du travail ». Il me tenait ce discours-là, à table, alors que quelqu’un lui servait le café, que la rue était bien propre, parce qu’un autre avait ramassé les poubelles à l’aube… Chacun doit prendre sa part dans les tâches à remplir. Moins de travail, du meilleur travail : oui. Mais la « fin du travail » : non. Et c’est un mensonge : ce sera peut-être une nouvelle classe d’aristocrates, qui se donneront l’impression que c’est la « fin du travail » pour eux, mais l’eau arrivera dans leur robinet sans travail ? Les pâtes dans leur assiette ? Juste, leurs serviteurs seront invisibles. Je refuse cette société-là. Il faudra toujours des gens pour ramasser les poubelles. Et si l’on veut que les déchets soient triés, il faudra des gens pour les trier. Je suis même partisan que chacun consacre quelques années à ces boulots-là, un « service écologique ».
Quant aux robots, s’il y a des tâches qui peuvent être remplies parfois par des robots… pourquoi pas ? Mais attention. Par exemple, quand on remplace les caissières par des caisses électroniques, on peut se dire que c’est bien pour elles, quand même, parce que « quel travail de merde, là, à biper tout le temps… » Mais en fait, quand on interroge les caissières, elles aiment leur métier, les relations avec les collègues, la mamie. Elles n’aiment pas comment on leur fait faire leur métier : la consigne « SBAM » – Sourire, Bonjour, Au revoir, Merci –, puis « SBAM+ » – Sourire, Bonjour, Au revoir, Merci, Avez-vous une carte de fidélité ? Elles ont détesté ce management, avec un langage stéréotypé. La caisse automatique marque d’ailleurs une transformation anthropologique.
Le mot « commerce » a deux sens : l’achat et la vente d’objets, certes, mais aussi le parole, l’échange, le propos. Désormais, pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, le commerce des objets va être détaché du commerce des paroles. On peut faire ce choix, mais il faut le poser démocratiquement. Ce n’est pas à Casino, Carrefour, Géant, Auchan de décider seuls de quelle société on veut. Si on dit que ça soit automatisé, c’est d’abord aux travailleuses d’en décider !
Comme vous le suggérez, le tournant écologique nécessite des sommes colossales de travail. Vous n’hésitez pas à faire le parallèle avec l’économie de guerre, et c’est aussi le sens que veulent donner au Green New Deal ses partisans… Pensez-vous que ça peut être un récit fédérateur, liant travail et écologie, notamment vis-à-vis des classes populaires ?
Oui, il nous faut passer du « vivre ensemble », un peu passif, sans projet, au « faire ensemble ». Pour moi, on devrait être dans la même situation que l’Amérique de Roosevelt en 1942, à essayer de canaliser toutes les énergies du pays, tous les savoir-faire, les capitaux, la main-d’œuvre en une direction. On devrait œuvrer de même. Ça ne veut pas dire que l’État fait tout, mais il canalise. Il nous faut des embauches dans chaque département pour replanter des haies, créer des ateliers de réparation, etc. Et le fait de le présenter comme étant la promesse de travail et d’emplois, ça peut rattacher les classes populaires à un projet écologique, qui leur apparaît généralement comme assez hostile.
Moins de pétrole équivaut à moins de raffineurs, par exemple… Comment parle-t-on à ces métiers qui devront, d’un point de vue écologique, disparaître ou se raréfier ?
Le capital détruit déjà les raffineries en France, détruit des emplois depuis quarante ans sans se soucier des gens. Et même au présent, c’est délirant : des fonderies d’aluminium ferment, alors que les véhicules électriques et hybrides réclament de l’aluminium ! Alors, il faut montrer aux gens, le plus concrètement possible, comment on va évoluer : il y aura besoin de moins de chauffeurs routiers, mais il y en aura toujours besoin pour les derniers kilomètres. La longue distance doit être assurée par du rail, donc on va former vos enfants à ça. Ça veut dire un plan d’embauche sur vingt ans… Rendez-vous compte : la Somme, c’est le premier département de France pour les éoliennes installées… mais on n’a même pas une usine de production de pales ! Il n’y a eu aucune vision industrielle de la filière. On plante des trucs là, et on se fout que ce soit importé ou d’où ça vient.
L’État doit-il décider seul de cette réorientation ? Y a-t-il de la place pour une autonomie ouvrière ? Les ouvriers savent aussi comment faire bifurquer d’une certaine façon leur outil de travail, employer différemment leur savoir-faire…
Quand bien même la gauche arriverait au pouvoir, s’il n’y a pas une ébullition venant du bas, des initiatives, une société en mouvement, on n’arrivera pas à grand-chose. Les associations, les travailleurs dans leur boîte et les syndicats doivent jouer un rôle, évidemment, mais les entrepreneurs aussi. Et je dirais même les grandes firmes : elles sont trop puissantes pour qu’on s’en passe, de bon gré ou de mauvais gré, elles doivent devenir des outils dans cette transformation. Il faut allier un mouvement d’en haut, l’État, avec un autre d’en bas, dépasser la contradiction entre « jacobinisme » et « colibrisme ».
Je donne un exemple : celui de la Sécurité sociale. En 1945, Ambroise Croizat, ministre communiste des Travailleurs, met en œuvre son « vaste plan de sécurité sociale ». Mais s’il n’y avait pas eu, en amont, depuis des décennies, les caisses de solidarité dans les usines, les mutuelles, les sociétés d’entraide, alors jamais la Sécu n’aurait pu se faire. Ça serait resté, pour les gens, une « utopie », là ça devenait une utopie concrète, une utopie réalisable. Croizat ne l’aurait pas imaginé, n’aurait pas osé le proposer. Il nous faut la même chose aujourd’hui : rouvrir l’imaginaire par le « faire », par les gens qui font, sans attendre la loi, l’État. On doit mettre en lumière les initiatives locales, à l’échelon de la commune, voire individuel, pour que ça se propage. Ensuite, on pourra le généraliser. Le rôle de l’État, pour moi, c’est d’être un stimulant, d’activer les bonnes volontés, de les faire coopérer plutôt que les mettre en concurrence.
L’exemple de la Sécu montre qu’une mesure politique peut avoir une portée révolutionnaire, et qu’elle véhicule un grand récit avec elle, un imaginaire. De telles mesures sont-elles encore imaginables aujourd’hui ? À Socialter, on s’est pas mal intéressés par exemple à la sécurité sociale de l’alimentation...
Je trouve la proposition d’une sécurité sociale de l’alimentation intéressante. Mais en l’occurrence, si je suis mon raisonnement d’avant, il faut l’expérimenter à plein d’endroits, pour que les gens y croient. On peut mettre en place une grande mesure nationale uniquement lorsque le fruit a mûri dans la société. Où le fruit est-il mûr ? Sur la rénovation thermique des bâtiments, oui, les esprits sont prêts. Sur un grand plan ferroviaire aussi… Même si tout ça ne fait pas forcément « rêver ».
Notre peuple connaît une dépression politique depuis quarante ans. Je me sens solidaire, moi, des classes populaires. Si dans ma région je parle de mesures révolutionnaires, pas grand monde ne va me suivre. Plutôt que « changer la vie », je fais le pari du « changer la vie, un peu, en mieux ». Vous allez me traiter d’affreux modéré, vous ne vous attendiez pas à rencontrer un social-traître ! Mais je crois plutôt à repolitiser par ce concret, par ce possible : avec la rénovation par exemple, il y aura un peu moins de factures à payer, un meilleur confort, moins d’humidité, moins de soucis de santé, et du boulot. Ça ne sera peut-être pas une révolution dans le pays, mais on aura apporté du mieux aux gens et surtout : nous aurons regagné leur confiance. C’est un double gain : immédiat parce qu’on améliore le quotidien, et à long terme parce qu’on renoue le lien, on ouvre la possibilité d’aller ensuite plus loin dans des politiques de rupture. Voilà mon pari.
Nous avons aussi parlé dans nos pages des réflexions du collectif Pensons l’aéronautique pour demain, qui suggère dans un rapport que demain une partie du temps de travail pourrait être consacrée à d’autres activités d’intérêt général – la polyactivité –, comme aller donner un coup de main aux champs… Ingénieur le matin et paysan l’après-midi en somme ! Qu’en pensez-vous ?
Ça me paraît être une chimère à ce stade : pour rendre l’utopie concrète, il faudrait rencontrer des gens qui le font… Quel bonheur ou quelle souffrance cela engendrerait-il ? Est-ce que ce serait une chose choisie ou bien subie, façon programme maoïste de retour aux champs… Et qui pour décider lorsqu’on a besoin de gens pour aller faire les vendanges, pour aller faire la récolte des betteraves, etc. ? En revanche, ça dit une chose que nous ressentons tous : notre incomplétude. Je suis un être spécialisé dans la lecture et l’écriture, qui ne sait pas trop cuisiner, bricoler, jardiner, coudre… Une société écologique réclame des êtres plus complets, plus autonomes.
Plus généralement, quel discours doit-on tenir vis-à-vis des classes supérieures pour embarquer au moins une partie d’entre elles dans un projet social et écologique ? Pour beaucoup d’entre elles, la rupture se fait sur un niveau très individuel ou anecdotique, en « bifurquant » vers des métiers plus épanouissants ou en faisant des ateliers zéro déchet à la cantine de l’entreprise…
Je ne fais pas le pari que les classes supérieures sont égoïstes par nature. Quand on parle de la situation précaire des auxiliaires de vie sociale, 90 % des Français sont d’accord pour reconnaître l’importance de leur métier et qu’elles méritent d’être minimum à 1 500 euros mensuels… Ceci dit, quand on a conscience que la société ne va pas bien, on en arrive vite à la question : est-ce qu’on fuit ou est-ce qu’on se soumet ? Et il y en a qui ont les moyens de fuir, tandis que d’autres ne les ont pas.
Quand je vois les gens d’AgroParisTech qui, dans leur lettre, justifient leur désertion, qui refusent de collaborer avec le système de l’agro-industrie, je me dis que ce sont les meilleurs, qu’ils ne doivent pas partir dans la nature à élever des moutons ou faire le tour de l’Amérique du Sud : « Vous êtes formés, vous êtes intelligents, vous êtes conscients… Quels débouchés on vous propose ? » Moi je dirais : il nous faut une École normale de la transition, dont ils deviendraient des maîtres, et qui formerait tous les enseignants à la mise en œuvre de la transition dans le pays pour la transmettre aux élèves. On doit utiliser ces cerveaux, canaliser leur énergie. Si on avait un vrai projet de transition écologique, ils en seraient l’avant-garde éclairée.
C’est une vraie proposition ?
On peut être verbomoteur ! Sérieusement, je le disais : je ne sais rien réparer – à part mes toilettes ! –, ni cuisiner – à part une recette de risotto en 25 minutes dénichée sur Marmiton.org… Or, la crise écologique va réclamer plus d’autonomie des individus, qu’ils soient moins dépendants du système industriel. Il faut éduquer à cette autonomie-là. Je suis pour qu’il y ait une épreuve de cuisine au baccalauréat ! Toute la société doit être revisitée à l’aune de la crise climatique, et l’enseignement parmi d’autres choses.
Vos réflexions sur l’écologie qui parcourent vos ouvrages comme Il est où, le bonheur ou Leur Progrèset le Nôtre croisent souvent la critique de la technique, et sont enchâssées dans une critique plus large du « Progrès ». Pas facile à défendre politiquement…
Attention, je distingue le progrès humain – et je souhaite qu’on le poursuive – et les avancées technologiques – dont on doit choisir, démocratiquement, lesquelles sont utiles, lesquelles nuisibles. Aujourd’hui, et depuis un paquet d’années maintenant, il n’y a plus de lien automatique entre les deux, entre avancées technologiques et progrès humains. Au contraire, dans bien des cas, l’avancée technologique signifie l’écrasement de l’humain. En revanche, il y a un champ immense qui reste en jachère et sur lequel on peut avoir du progrès humain : la manière dont on s’occupe de nos enfants, par exemple, de nos aînés, des personnes en situation de handicap, des animaux aussi, et de la nature.
Vous vous référez souvent à l’idée de bonheur, aussi. C’est votre boussole ?
La politique doit pouvoir reposer la question du bonheur. Pourquoi ? Parce que nous est posée, en permanence, la question des moyens, mais jamais la question des finalités. Il y a une occultation des buts poursuivis. C’est particulièrement vrai sur le terrain du travail : on nous dit qu’il faut de l’emploi, mais pour quoi faire ? Il faut être compétitif, mais pour quoi faire ?
Puisqu’on parle des finalités : à quoi elle ressemblerait votre société idéale ?
Je ne suis pas l’homme de l’idéal, et je me méfie de ce mot. Je ne suis pas l’homme du meilleur des mondes, mais je suis l’homme d’un monde meilleur. Avant d’avoir la société idéale, j’aimerais que les gens puissent partir en vacances et aller respirer l’air de la mer. Je pense que je suis l’homme du mieux.
Comment en êtes-vous venu à vous intéresser à la technocritique, l’écologie et la décroissance ?
C’est très ancien en réalité. Je suis hostile à la croissance depuis 2000 – j’ai même contribué à la revue Casseurs de pub. Je suis né à la politique en étant « acroissant ». D’un point de vue « rouge », le gâteau est assez gros dans le pays, et la question n’est plus de le faire grossir encore mais de mieux le répartir. Le « produire plus pour consommer plus », c’était aussi, pour moi, une désespérance humaniste : c’est l’écrasement de l’homme dans l’homme. Et c’est, enfin, foncer dans le ravin. Mais tout cela restait en arrière-plan. Pourquoi ? Parce que se confronter à la crise écologique, c’est comme affronter un soleil noir, affronter la mort.
Tu ne te lèves pas tous les matins en pensant à la mort. Par ailleurs, je ne savais pas quoi en faire journalistiquement à l’époque. J’étais reporter et j’aimais le récit : aller parler aux ouvriers de Goodyear, parler au patron, me faire claquer la porte au nez… C’est plus difficile de parler avec des fourmis et des cochons – même si j’ai fait un papier où je faisais parler les fourmis, on appelle ça une prosopopée ! Et puis, maintenant, surtout, j’ai des enfants. Je les ai entraînés dans cette histoire d’une humanité au bord du gouffre alors qu’ils n’avaient rien demandé. Ça pose un devoir.
Pour aller plus loin
Traité constitutionnel européen
En 2005, le traité censé établir une constitution pour les pays membres de l’Union européenne est soumis à référendum. Près de 55 % des Français votent contre. En 2007, un nouveau texte est élaboré en catimini : le traité de Lisbonne sera ratifié sans consultation populaire, et verrouille l’orientation néolibérale de l’Union européenne.
Fin du travail.
L’idée d’un futur libéré du travail est tenace à gauche, même si elle relève d’arguments assez hétéroclites. Tantôt fondée sur l’idée d’un « grand remplacement technologique » permettant de confier toutes les tâches pénibles à des robots, tantôt sur la nécessité de développer des activités autonomes dégagées de la domination salariale, elle a trouvé des relais chez le socialiste Paul Lafargue et son fameux Droit à la paresse (1880), chez le philosophe André Gorz (Métamorphoses du travail, Galilée, 1988), ou encore chez l’essayiste Jeremy Rifkin (La Fin du travail, La Découverte, 1995).
Sécurité Sociale alimentaire
Cette proposition consiste à intégrer l’alimentation dans le régime général de la Sécurité sociale. Sur le modèle du système de santé, une carte Vitale de l’alimentation permettrait à chacun de se fournir en produits conventionnés pour un montant de 150 euros par mois. L’initiative repose sur trois piliers : l’universalité, le conventionnement organisé démocratiquement et le financement basé sur la cotisation sociale.
Biographie
Né en 1975 à Calais, François Ruffin est député de la Somme depuis 2017, et siège dans le groupe de La France insoumise. Il a fondé le journal Fakir en 1999 à Amiens, et a aussi contribué au Monde diplomatique et à l’émission Là-bas si j’y suis sur France Inter. En 2016, il est l’un des principaux initiateurs du mouvement Nuit debout. L’année suivante, il remporte avec Merci Patron ! le César du meilleur film documentaire. Il a publié une vingtaine de livres dont Les Petits Soldats du journalisme (Les Arènes, 2003),Il est où, le bonheur (Les Liens qui libèrent, 2019) et Leur Progrès et le Nôtre (Seuil, 2021). Son dernier livre,Le Temps d’apprendre à vivre (Les Liens qui libèrent, 2022), est consacré à la bataille des retraites.
Soutenez Socialter
Socialter est un média indépendant et engagé qui dépend de ses lecteurs pour continuer à informer, analyser, interroger et à se pencher sur les idées nouvelles qui peinent à émerger dans le débat public. Pour nous soutenir et découvrir nos prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner !
S'abonnerFaire un don