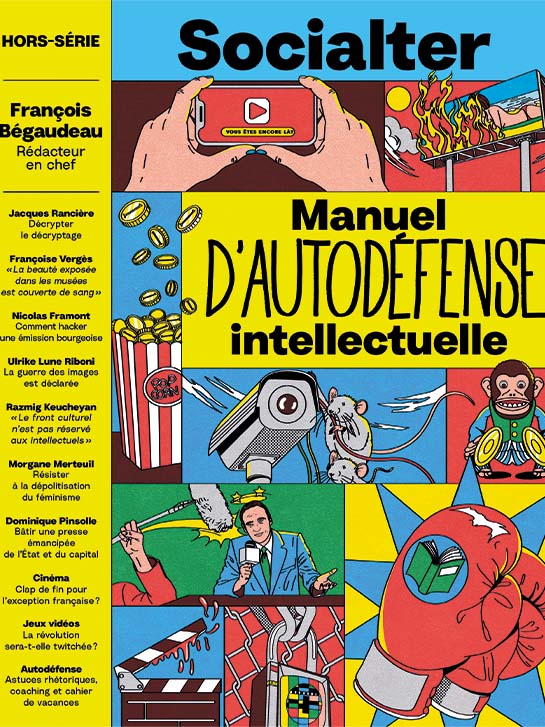Je te sollicite d’abord en tant que très bon connaisseur de l’œuvre de Gramsci, penseur marxiste auquel il arrive une chose étrange depuis une vingtaine d’années : il est souvent cité à droite. On imagine que ces gens ne se sont pas embêtés à lire tous les Cahiers de prison, et d’ailleurs dans 99 % des cas, il est cité pour avoir censément dit qu’une victoire politique commence par la victoire dans la « bataille culturelle », alors que, me semble-t-il, cette notion est absente des écrits de Gramsci, lequel parle plutôt de « front culturel »… Peux-tu préciser ce qu’il entend par là ?
On cite souvent Gramsci pour dire une chose banale : les idées comptent en politique. Mais affirmer que c’est Gramsci qui l’a dit permet de se donner un air de mystère et de profondeur... Il y a des auteurs comme ça dans l’histoire des idées, Machiavel en est un autre. Cela tient souvent au fait que leur œuvre est difficile d’accès et aussi qu’ils ont pratiqué ce que Leo Strauss appelle l’« art d’écrire » : compte tenu de la persécution dont ils ont fait l’objet – Gramsci a passé les dix dernières années de sa vie dans les prisons de Mussolini – le texte comporte une part ésotérique, il est parfois écrit dans un langage qui doit être décodé, ce qui fait des décodeurs des initiés. L’expression « bataille culturelle » n’existe en effet pas chez Gramsci.
Article à retrouver dans notre hors-série « Manuel d'autodéfense intellectuel », en librairie et sur notre boutique.
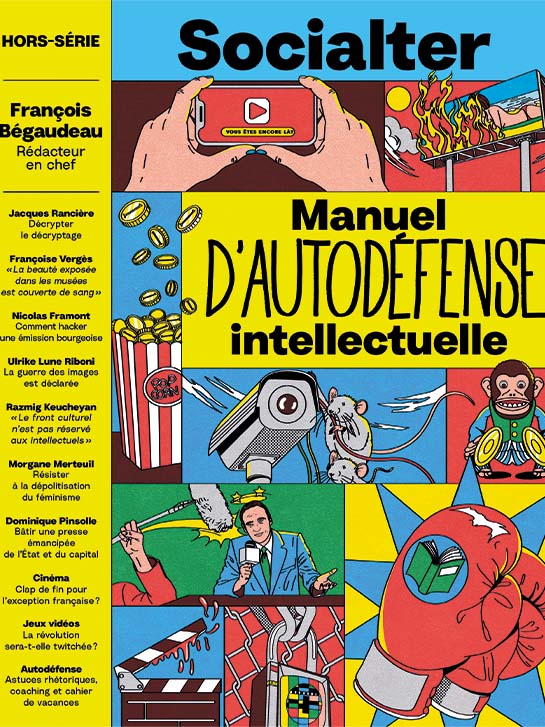
Il distingue dans la pratique révolutionnaire trois « fronts » : le « front politique », le « front économique » et le « front culturel ». Il n’y a aucune priorité de ce dernier sur les deux autres. Il ne s’agit pas d’abord d’imposer ses idées dans le débat public pour ensuite pouvoir mettre en œuvre une politique. La bataille doit être menée sur les trois fronts simultanément, avec bien sûr des rythmes qui selon la conjoncture peuvent être discordants. En bon léniniste, Gramsci considère que le « front politique » est le plus important : il revient au parti révolutionnaire – en l’occurrence le Parti communiste italien dont il est l’un des fondateurs en 1921 – de mettre en cohérence l’intervention dans ces trois domaines.
Enfin, élément crucial, le « front culturel » n’est pas réservé aux intellectuels étroitement définis. Un syndicaliste peut mener la lutte sur ce front aussi bien qu’un universitaire. Dans la bataille contre la réforme des retraites, pour prendre un exemple qui nous occupe en ce moment, l’intersyndicale mène une lutte économique, concernant la répartition des richesses, mais aussi une lutte culturelle, lorsqu’elle défend la légitimité du régime par répartition contre la capitalisation, et la vision de la société qui le sous-tend.
Dans un article livré au Monde diplomatique, tu prenais pour exemple de cette intrication entre front politique et front culturel la victoire des salariés d’Onet, un sous-traitant de la SNCF. Victoire syndicale qui est inextricablement une victoire « culturelle ». Au fond, il semble que ce que les autoproclamés « gramscistes de droite » entendent par « bataille culturelle », c’est la « bataille des idées » qu’ils brandissent également à l’envi. C’est par exemple le mantra de Zemmour. En somme, ils disjoignent ce que le marxiste Gramsci imbrique, à savoir les situations proprement politiques et les idées. Ne peut-on pas dire, alors, qu’ils pêchent avant tout par idéalisme ?
Oui mais dans le cas de la droite cet idéalisme est sans grande importance, car les structures de l’ordre établi travaillent pour l’essentiel pour elle. L’un des concepts importants de Gramsci est celui d’« appareils d’hégémonie ». Il désigne les institutions publiques et privées qui sous-tendent l’hégémonie d’une classe sociale dans une société, à un moment de son histoire. Un appareil d’hégémonie peut être public – pense à la force de frappe de Bercy, le ministère où sont conçues et mises en œuvre les politiques néolibérales depuis quarante ans. Il peut aussi être privé, c’est par exemple le système médiatique audiovisuel et écrit détenu en France par une dizaine de milliardaires, qui diffuse en continu un mélange de néolibéralisme et de conservatisme radical.
« Dans le capitalisme, tout est toujours affaire de propriété des moyens de production, en l’occurrence intellectuels »
Résultat, ce n’est pas comme s’il y avait un marché des idées libre et non faussé sur lequel des idées en concurrence cherchent à convaincre les citoyens de la justesse de leur point de vue. Il y a un quasi-monopole des moyens de production et de diffusion intellectuels par les forces néo-libérales et conservatrices. C’est pour ça que nous, la gauche, allons droit dans le mur quand nous formulons le problème en termes de « bataille des idées » : faire porter le conflit sur les « signifiants », comme le fait un certain « populisme de gauche », sur la communication, faire de l’intervention sur les réseaux sociaux le cœur de l’activité politique, etc. En dernière instance, dans le capitalisme, tout est toujours affaire de propriété des moyens de production, en l’occurrence intellectuels. Or pour changer la structure de la propriété dans nos sociétés, une intervention coordonnée sur les trois « fronts » est nécessaire.
Lisant ta mise au point très claire, je me dis que, dans « hégémonie culturelle », le deuxième terme est particulièrement confusionnant pour nous autres contemporains. Il y a d’abord cet amalgame entre « culturelle » et « intellectuelle », qui fait perdre de vue l’assise matérielle des productions sociales. Il y a ensuite, évidemment, la complexification du mot « culture » postérieure aux années où Gramsci écrit. Il me semble que pour Gramsci, « culture » désigne un ensemble de convictions, de croyances, de représentations, qui imprègnent un corps collectif – faut-il inclure là-dedans ce qu’il appelle le « sens commun » ? Pour nous autres, gens de 2023, « culture » s’entend dans un sens approchant (un ensemble de mœurs et de convictions plus ou moins liées à une appartenance géographique (la culture basque), mais aussi dans un sens éloigné : la culture comme ensemble de productions relevant du champ esthétique, qu’en France prend en charge le ministère de la Culture. Au croisement des deux, il y a des choses comme « la culture Manga », ou « la culture Harley-Davidson ». Or, autant le premier sens est largement investi par Gramsci ; qui comme on sait s’est beaucoup intéressé aux cultures locales (exemplairement la culture sarde) et à la langue ; autant il me semble qu’il parle assez peu du champ esthétique. En tout cas, dans tes diverses interventions sur le sujet, tu ne l’évoques pas. Qu’en est-il du champ esthétique dans l’hégémonie culturelle ? Pour le dire autrement : et l’art dans tout ça ?
Je ne suis pas un spécialiste des conceptions de l’art de Gramsci, il faudrait en interroger un pour avoir une réponse précise. Mon sentiment est que l’on ne trouve pas chez lui d’esthétique générale du type de celle qui est développée par d’autres marxistes classiques, par exemple Lukacs avec sa théorie du roman, ou des marxistes contemporains, comme Fredric Jameson, qui a élevé la critique marxiste de l’art à des niveaux de sophistication vertigineux, et qui reste soit dit en passant en France un auteur largement méconnu, malgré une vague de traductions au cours de la dernière décennie.
Pourtant, les Cahiers de prison regorgent de considérations sur l’art, par exemple sur la littérature. L’un de mes passages favoris se trouve au « Cahier 21 » et porte sur Dostoïevski. Gramsci se demande pourquoi l’Italie n’a pas produit de Dostoïevski, à savoir non seulement un « grand écrivain » – l’Italie en a évidemment connu – mais un grand écrivain doué d’un sentiment « national-populaire » (un concept central chez Gramsci), c’est-à-dire d’un lien profond avec le peuple, et qui est lu par lui. Pour Gramsci, l’œuvre de Dostoïevski réconcilie la « haute » culture et la culture populaire. Or ce type d’écrivain n’est possible que dans certains contextes nationaux : là où le peuple participe par ses luttes à la définition du « national », intégrant ainsi sa culture dans la « haute » culture, ce qui déclenche un dépassement de l’opposition entre le « haut » et le « bas ».
D’une certaine manière, on peut dire que s’il n’y a pas d’esthétique générale chez Gramsci, au sens d’une théorie abstraite des formes, il développe bien une sociologie politique de l’art qui annonce des approches de l’art qui apparaîtront lors de la seconde moitié du XXe siècle, par exemple chez Lucien Goldmann ou Pierre Bourdieu, chacun à leur manière. Ses réflexions sur la culture populaire, sur la subversion de la « haute » culture, ne sont par ailleurs pas sans rappeler Mikhaïl Bakhtine.
Si on quitte un peu Gramsci, quelle part ferais-tu à l’art, ou disons aux biens symboliques, qui relèvent de la culture dans notre sens moderne, dans la lutte pour l’hégémonie culturelle ? Le poids des structures est évident, le poids des médias aussi ; même si, comme tu l’as dit, il n’y a pas de vie propre des médias. Mais qu’en est-il des romans, des films, des BD, éventuellement de la musique ? Pour ma part, et bien qu’étant concerné au premier chef, j’ai tendance à minimiser le poids de ces objets dans la donne générale. Les œuvres sont éventuellement des symptômes – c’est d’ailleurs ainsi que les traitent les grands théoriciens marxistes du roman, dont ceux que tu cites – mais surement pas des causes, ni des agents. La visibilité d’un Houellebecq n’est pas la cause mais l’effet de l’hégémonie libérale-autoritaire. J’aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Et sur une question subsidiaire : le camp social doit-il porter une attention particulière à ce domaine, comme cela a été le cas du PCF à son apogée ?
L’œuvre d’Annie Ernaux participe-t-elle à la construction d’une hégémonie de gauche ? Elle comporte des aspects émancipateurs, aucun doute là-dessus. Mais la conception de la domination qu’elle renferme, comme d’ailleurs celle de Pierre Bourdieu dont elle s’inspire en partie, contient un élément pessimiste irréductible, dont il n’est pas évident qu’il soit un encouragement à l’action collective. La littérature a certainement des effets politiques, la lecture symptômale des biens symboliques ne suffit pas. Mais ces effets sont trop complexes pour être prédits et contrôlés. Dans le cas d’Ernaux, c’est un exemple assez classique où un·e écrivain·e transfère le capital symbolique acquis dans le champ littéraire dans le champ politique, en apparaissant par exemple à la même tribune que Jean-Luc Mélenchon. C’est extrêmement courageux et j’ai la plus grande admiration pour ses livres, mais ça ne dit rien des effets politiques de long terme qu’ils produisent.
Les choses se présentent peut-être différemment pour la science-fiction. Je pense à Kim Stanley Robinson et à sa « trilogie climatique ». Il s’agit de romans de science-fiction « écologistes », qui décrivent une planète où les catastrophes naturelles se multiplient. On y trouve à la fois une dimension d’alerte aux générations actuelles – voici ce qui va vous arriver si vous ne vous mobilisez pas pour changer de système – et comme il n’est pas sûr que son alerte soit suivie d’effets, de description de ce que sera la gamme des comportements humains dans ce monde futur désastreux. Ce n’est pas de la « littérature engagée » à l’ancienne, mais je me suis dit en le lisant qu’il avait peut-être hésité entre écrire un livre de théorie critique et un roman de science-fiction.

Là on ne parle que de littérature, mais il faudrait s’interroger sur les effets politiques de l’art contemporain plus en général. Or l’art contemporain – il faudrait parler des arts contemporains au pluriel – subit un processus de remise en question des catégories esthétiques modernes. Par exemple la question de ses rapports avec la politique doit être posée au cas par cas, il est probablement absurde de la poser en général. Je suis loin d’être un spécialiste, là encore.
Rien de ce que je dis ne doit conduire notre camp à négliger ces questions, évidemment. Mais il me semble qu’elles sont bien présentes dans les mouvements sociaux et politiques contemporains, aussi bien que dans les théories critiques. Bien sûr, elles le sont différemment que par le passé au PCF. À ma connaissance, la France insoumise n’a pas prévu de consacrer une prochaine séance de son organe de direction à une question esthétique, comme le PCF à Argenteuil en 1966…
Effectivement. Et je suis plutôt frappé par une sorte d’indifférence globale de la gauche radicale aux choses de l’art, et par l’actuelle séparation entre questions esthétiques et questionspolitiques. Ce n’est pas une déploration, c’est un constat. Dans le genre de la science-fiction, ou de l’anticipation, on pourrait quand même citer le cas de Damasio, qui est beaucoup lu dans les sphères militantes, même si son influence réelle est, comme tu le dis de l’œuvre d’Annie Ernaux, tout aussi difficile à quantifier que la concrétisation politique de cette influence. Ce qui m’amène à une autre question. Il semble entendu que l’hégémonie soit du côté néolibéral. C’est presque une lapalissade que de le dire. Cependant, un autre concept gramscien vient percuter cette évidence : la « crise d’hégémonie ». Pour la faire simple : le pouvoir est bien là mais le consentement à ce pouvoir s’est sérieusement étiolé. Cette intuition rejoint beaucoup d’analyses radicales : ce pouvoir plus personne n’y croit, les masses sont globalement incrédules à la douce propagande épandue par les conservateurs, etc. On parlera alors de « délégitimation ». Je me demande s’il n’y a pas là quelque chose de l’ordre de l’autopersuasion militante. Oui les incarnations contingentes du pouvoir néolibéral bénéficient du soutien d’une frange très minoritaire de la population, mais il ne me semble pas que les valeurs néolibérales, les valeurs marchandes, etc., aient cessé d’infuser dans la population. Dirais-tu, toi, que nous vivons une phase de crise hégémonique ?
Comme l’a montré l’historienne du néolibéralisme Melinda Cooper, les valeurs marchandes et les valeurs familiales conservatrices se nourrissent les unes des autres. Dans la phrase de Margaret Thatcher souvent citée, « Il n’y a pas de société, il n’y a que des individus », on oublie souvent la dernière partie. Thatcher ajoute en effet : « ... et des familles. » Le néolibéralisme compte sur la famille, car il sait que si les solidarités publiques, la protection sociale, sont détruites, il faut que l’individu puisse compter sur des solidarités privées pour le soutenir dans l’univers concurrentiel, autrement dit sur sa famille. D’où la montée concomitante du néolibéralisme et du conservatisme au cours des dernières décennies.
C’est anecdotique mais je suis tombé l’autre soir sur un épisode de Top Chef, qui illustre l’argument de Melinda Cooper à merveille. C’est la concurrence de tous contre tous, devenir quelqu’un en battant son prochain, même dans une activité en apparence paisible comme faire la cuisine. En même temps, la vie familiale de chaque candidat est mise en scène, son bonheur d’être en famille, ce qui permet de montrer que s’il est si compétitif c’est grâce au soutien de son conjoint et de ses enfants.
Ceci étant, sur le plan économique, le néolibéralisme traverse une période de sérieuses turbulences. La difficulté analytique est celle-ci : le néolibéralisme se définit par la marchandisation, la régulation par le marché, mais avec un État actif. Or la nature de l’activité de l’État n’est pas la même selon les secteurs de l’économie et selon les périodes historiques. Parfois, l’État demeure en arrière-fond et se contente de garantir des droits de propriété. Dans d’autres, il intervient davantage, par exemple lorsque le marché est défaillant (les défaillances de marché sont prévues dans la théorie néolibérale), ou en subventionnant un secteur stratégique. Pour moi, on est clairement encore aujourd’hui sous l’hégémonie du néolibéralisme, même s’il est affaibli depuis la crise de 2008. Mais l’interventionnisme croissant des États dans l’économie nous fera peut-être basculer dans autre chose dans les années qui viennent, qui ne sera sans doute pas préférable.
Biographie : Professeur de sociologie à l’université Paris Cité et membre du Centre de philosophie, d’épistémologie et de politique, Razmig Keucheyan inscrit son travail dans la tradition marxiste classique et contemporaine. Ses ouvrages portent à la fois sur les nouvelles pensées critiques et sur les questions écologiques. Militant de gauche et ancien membre du NPA, il a récemment apporté son soutien à Jean-Luc Mélenchon, tout en étant membre du comité de rédaction de la revue Actuel Marx.
Soutenez Socialter
Socialter est un média indépendant et engagé qui dépend de ses lecteurs pour continuer à informer, analyser, interroger et à se pencher sur les idées nouvelles qui peinent à émerger dans le débat public. Pour nous soutenir et découvrir nos prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner !
S'abonnerFaire un don