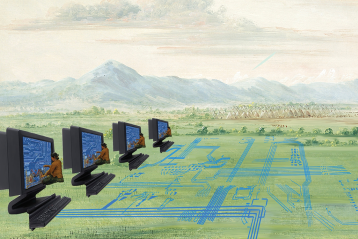Automne 1974. Le bateau de bois tangue lorsqu’il quitte le port de Fukue, l’île principale de l’archipel de Goto dans la préfecture de Nagasaki, aux confins du Japon. Tant bien que mal, il s’élance dans la mer de Chine orientale. Comme pour toutes les traversées qui assurent les liaisons entre les îles Goto, les passagers s’entassent, pressés de retrouver la chaleur de leur foyer. L’odeur de tabac mêlée à celle des moteurs donne la nausée ; le bruit du rafiot, la migraine.
Assise dans un coin, Sadako Iwamura serre son nouveau-né contre elle. À tout juste 24 ans, elle vient de donner naissance à son premier enfant, un 5 août, le jour même de son propre anniversaire. Terrorisée, elle rentre chez elle, à Narushima, l’île où elle est née, où elle s’est mariée, et où l’attend sa famille. Plus de cinquante ans se sont écoulés depuis ces quelques heures de bateau, mais le souvenir est resté intact dans la mémoire de Sadako Iwamura. Ce fut « le moment le plus douloureux de ma vie ».
Article issu de notre numéro 39 « Tout le pouvoir au local », disponible sur notre boutique. Abonnez-vous pour nous soutenir !
Emmitouflé, le bébé de la jeune femme ne pleura pas, ce jour-là, malgré le vacarme qui régnait sur l’embarcation. Elle se souvient avoir lancé des regards affolés à la cantonade, s’efforçant de cacher son enfant. La honte l’étreignait. Comme 221 autres bébés nés à Goto dans ces années-là, son enfant est arrivé au monde lourdement handicapé. Il a de gros problèmes cardiaques, il n’entend pas, n’a pas d’anus et devra vivre avec une poche, lui a-t-on expliqué à l’hôpital. Quelques jours après sa naissance, sa peau a commencé à noircir.
Les médecins lâcheront le mot qui fait peur à l’époque : l’enfant est un kuro-akatchan (littéralement « un bébé à la peau noire »), terme désignant ce mal mystérieux qui frappe les nouveau-nés de la région les uns après les autres. Elle apprendra bien plus tard que l’état de santé de son enfant est la conséquence d’une contamination alimentaire, qui a eu lieu entre février et avril 1968, dans cette région reculée du Japon, dont elle a été l’une des victimes.
12 000 personnes contaminées
L’affaire Kanemi éclate publiquement le 10 octobre 1968 et fait les gros titres du Asahi Shimbun, l’un des plus grands quotidiens japonais. Une huile de riz alimentaire, contaminée aux polychlorobiphényles (PCB) et aux polychlorodibenzofuranes (PCDF) du fait d’un accident technique survenu lors du processus de fabrication, a été commercialisée dans le sud du pays, soit au nord de l’île de Kyushu, dans les villes de Kita-Kyushu, Fukuoka et Nagasaki dont dépend l’archipel de Goto.
Consommée par la population, l’huile de cuisine a entraîné des maux différents selon les conditions physiques des personnes, les fréquences d’ingestion et les quantités absorbées. Les malades ont commencé à souffrir d’intenses douleurs musculaires, d’états de fatigue invalidants, de problèmes cardiaques. Puis les symptômes se sont aggravés. Des pustules noires ont recouvert le corps des plus atteints. Des cas de cancers, de perte de la vue, de l’odorat ou des dents se sont multipliés. Les effets de la maladie ont été sans pitié sur les femmes enceintes et se sont répercutés sur plusieurs générations d’enfants. Près de 12 000 personnes ont été reconnues contaminées par cette huile et plus de 2 000 dans le seul archipel de Goto. On a baptisé ce mal « Yusho » , littéralement maladie des symptômes de l’huile.
Aujourd’hui âgée de 69 ans, Sadako Iwamura conserve comme une relique l’unique photo de ce bébé, qui n’aura survécu que quatre mois. Il lui est difficile d’en parler. Et pour cause : elle avait gardé le secret de l’existence de ce petit être durant presque toute sa vie, s’interdisant d’évoquer ce bébé devant ses amis et ses autres enfants, qui naîtront quelques années plus tard tous en bonne santé. La peur de la discrimination aura scellé sa parole et cette dernière ne s’est libérée qu’il y a une petite dizaine d’années. « J’avais 19 ans lorsque j’ai commencé à consommer l’huile de Kanemi. » Très rapidement, « j’ai souffert de vertiges, de maux de tête, de douleurs dans le dos. Il m’arrivait de m’évanouir et j’avais tout le temps envie de dormir ». Commercialisée en bidons d’environ deux litres, l’huile était vendue dans l’un des magasins alimentaires de l’île de Narushima.
Durement frappée par la dépopulation, elle ne compte plus que 2 000 habitants contre 19 000 à l’époque. La gourmandise de ce port de pêche aux foyers modestes restait le poisson, pilier de l’économie locale, « que l’on mangeait très souvent frit. Nous utilisions aussi l’huile pour le tamagoyaki [omelette japonaise] ou encore pour la cuisson de la viande ». Partout, tout le temps. Amère, elle se souvient qu’autrefois « la réclame de Kanemi vantait les mérites de cette huile bon marché et bonne pour la santé »… Mariée à 23 ans, Sadako tombe enceinte. « Durant toute ma grossesse, je ne le sentais pas bouger dans mon ventre. Quand il est né, je n’ai pas pu voir son visage, les médecins l’ont emporté immédiatement, sans explications. Quand je l’ai vu la première fois, je ne pouvais pas le croire. Je me disais : “C’est ce bébé que j’ai mis au monde ?” » Mère et enfant sont hospitalisés cinquante jours. Une fois rentrée avec lui, « je ne le sortais jamais, je ne voulais pas que les gens le voient ». Quand il est mort, « nous n’étions que tous les deux. Ce fut le plus pénible je pense. »

Villages fantômes
Coquette, Fujie Yaguchi a les cheveux teints et porte le chignon haut. Elle vit chez son fils, Shinji, qui s’occupe d’elle. La dame, désormais âgée de 88 ans, tenait l’un des bouis-bouis de l’île dans lequel se rendait Sadako Iwamura. Un lieu de partage essentiel pour la vie sociale de la communauté. « On recevait beaucoup de clients. L’affaire prospérait », se rappelle l’ancienne gérante. Rongée par le remords et la culpabilité, Fujie Yaguchi se tord les doigts lorsqu’elle entreprend de parler des bidons d’huile de Kanemi qu’elle a achetés pour son restaurant. « On a commencé à entendredire que nos clients tombaient malades… Ils étaient recouverts de taches noires. Personne ne savait ce qui leur arrivait. Et puis certains sont morts. » Cinq ans après l’ouverture de son restaurant, Fujie Yaguchi ferme son établissement, tombe elle-même malade et entame à son tour le début d’une longue série d’allers-retours entre l’hôpital et son domicile.
Contrairement au drame de Minamata – la pollution au mercure qui a eu lieu dans les années 1950 également dans le sud du Japon –, l’accident de Kanemi n’a jamais été reconnu comme pollution industrielle. Qualifiée de « contamination alimentaire », l’affaire a eu pour conséquence de générer beaucoup d’inégalités en termes de reconnaissance des victimes.
Au lieu d’être indemnisées de la même manière, elles devaient être reconnues au cas par cas et sur examen médical. « Il y avait un barème sur 12 niveaux, explique Hideomi Asahikajiyama, responsable d’une association locale de victimes de Kanemi, lui-même reconnu niveau 5. Chaque personne reconnue victime se voyait attribuer un classement et recevait des indemnités et des accès aux soins différents selon son échelon. Cela a suscité d’énormes jalousies entre les villageois… On ne comprenait pas pourquoi untel touchait plus alors qu’il avait l’air moins malade. » Hideomi Asahikajiyama a beau affirmer qu’il a été peu touché par la contamination, sa toux bruyante reste impressionnante. Une forte odeur de tabac froid lui colle à la peau. Vêtu d’une chemise à carreaux, d’un vieux jean et chaussé de claquettes de plage, il vit, à 65 ans, sur les restes du port de pêche de Tamanoura, aujourd’hui déserté.
Difficile d’imaginer qu’autrefois, le port grouillait de bateaux. « Lorsque les pêcheurs rentraient au village, c’était la fête : les commerces, les bars étaient pleins. » Le village comptait 4 500 âmes contre à peine 500 aujourd’hui. Une grande majorité des habitations sont abandonnées, les devantures fermées. Tamanoura, qui avait « une boutique entièrement spécialisée dans la vente de cette huile, l’a commercialisée de février à mai ». Hideomi Asahikajiyama fait partie des rares victimes qui se sont mobilisées très tôt pour dénoncer le scandale et l’injustice dans le traitement des personnes contaminées. Avec une petite délégation, il se rend à Tokyo, tous les ans, pour manifester et assister à une réunion gouvernementale annuelle où une poignée de fonctionnaires écoutent leurs doléances sans broncher. Il aimerait voir enfin les responsables de ce drame faire face à leurs responsabilités. « Tant de gens ont souffert… »
Les femmes, premières victimes
Le village de Tamanoura comptabilise à lui seul 1 037 victimes, Narushima 1 186. Sept points de vente ont commercialisé l’huile à Fukue en mars 1968, 12 à Narushima en février et mars. Infirmière à la retraite, Takiko Hashimoto a vécu la contamination depuis l’intérieur des foyers qu’elle visitait. « Vous auriez dû voir l’état des gens…, raconte-t-elle une main posée sur la bouche. J’ai fait ce que j’ai pu mais personne ne savait ce que les gens avaient, alors je passais d’un patient à un autre, impuissante. » Le souffle court, à 80 ans, elle éprouve des difficultés à marcher.
Lorsqu’elle évoque l’état de santé des habitants de Tamanoura et Narushima, Takiko Hashimoto croise les bras sur sa poitrine avant d’enfouir régulièrement son visage entre ses mains. « Le plus pénible, c’étaient les enfants. Cloués par des maux de ventre et la fatigue, ils ne pouvaient plus aller à l’école. » L’été qui suivra la consommation de l’huile, elle soignera aussi les « pustules noires qui s’étaient emparées du dos, du visage, du ventre. Certains en avaient le corps entièrement recouvert… Il fallait les percer et l’odeur était atroce ».
Takiko Hashimoto montre la photo d’une femme qui n’a plus de cheveux et cache son visage. « Elle avait tellement honte de son apparence qu’elle ne voulait plus sortir. La maladie faisait peur, d’autant plus que les symptômes étaient visibles. La rumeur a très vite couru qu’elle pouvait être contagieuse. » À l’hiver 1968, lorsque les premiers kuro-akatchan naissent, Takiko Hashimoto s’occupe de 13 d’entre eux. « C’est la pire chose que j’ai vue au cours de ma carrière. » L’infirmière a soigné les blessures physiques et psychologiques. Les cas de désespoir et de suicides se sont multipliés. « Les jeunes femmes étaient en première ligne : les reconnaître malades, c’était les condamner à ne jamais fonder de famille. On avait peur qu’elles ne puissent mener à bien une grossesse, alors elles étaient systématiquement ostracisées. »

Briser le mur du silence
Miyoko Yaguchi fait partie de ces femmes célibataires. L’institutrice de 52 ans, au style austère, raconte son histoire la mâchoire serrée, contrôlant la moindre de ses émotions. Elle était une fillette de 2 ans lors de la vente de l’huile. « J’étais trop petite pour manger des aliments frits, alors j’ai été peu touchée, mais mon petit frère, lui, était dans le ventre de ma mère. » Il est né kuro-akatchan, l’année de la contamination. « Il avait la peau sombre et de gros problèmes d’articulations. Il marchait les jambes arquées, alors on l’appelait le singe à l’école. » Il décédera à 17 ans, à l’hôpital universitaire de Nagasaki.
Née dans le village de Yagami Chiku, à Narushima, Miyoko Yaguchi a vécu à Nagasaki avant de se réinstaller à Goto pour se rapprocher de sa mère, âgée de 77 ans, qui vivait seule : victime de l’huile, le père de la famille est mort d’un cancer depuis longtemps. « Mon père était pêcheur. Il passait son temps en mer et ne rentrait à la maison que deux fois par an. Les femmes élevaient les enfants seules. » Malgré ses très courtes présences au port, la quantité de nourriture frite consommée par l’homme aura suffi à le rendre fatalement malade.
Lorsque Miyoko Yaguchi entame de raconter le calvaire de son frère, son cœur se brise définitivement. Elle veut parler « des sacrifices financiers des familles qui se sont endettées pour payer les trajets vers l’hôpital, les deuils, l’autopsie pratiquée sur [s]on frère sans [...] consentement », enfin la culpabilité de ces mères qui ont nourri leurs enfants avec du poison. « Je veux que le monde sache. Je dois le faire pour mon frère. » Pour Miyoko Yaguchi comme pour Sadako Iwamura, il faut briser le mur de silence qui a empoisonné la vie des victimes presque tout autant que l’huile de Kanemi.
À Goto, les examens médicaux réservés aux victimes de l’huile se poursuivent à Fukue, Tamanoura et Narushima, alors que le scandale ne dépasse pas vraiment les frontières de l’île de Kyushu. Une travailleuse sociale explique : « Ce 5 août 1974, sur le ferry qui ramenait Sadako Iwamura à Narushima, ce n’est pas uniquement Kanemi, c’est également l’indifférence de tous qui a tué un peu plus son bébé. »
Soutenez Socialter
Socialter est un média indépendant et engagé qui dépend de ses lecteurs pour continuer à informer, analyser, interroger et à se pencher sur les idées nouvelles qui peinent à émerger dans le débat public. Pour nous soutenir et découvrir nos prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner !
S'abonnerFaire un don