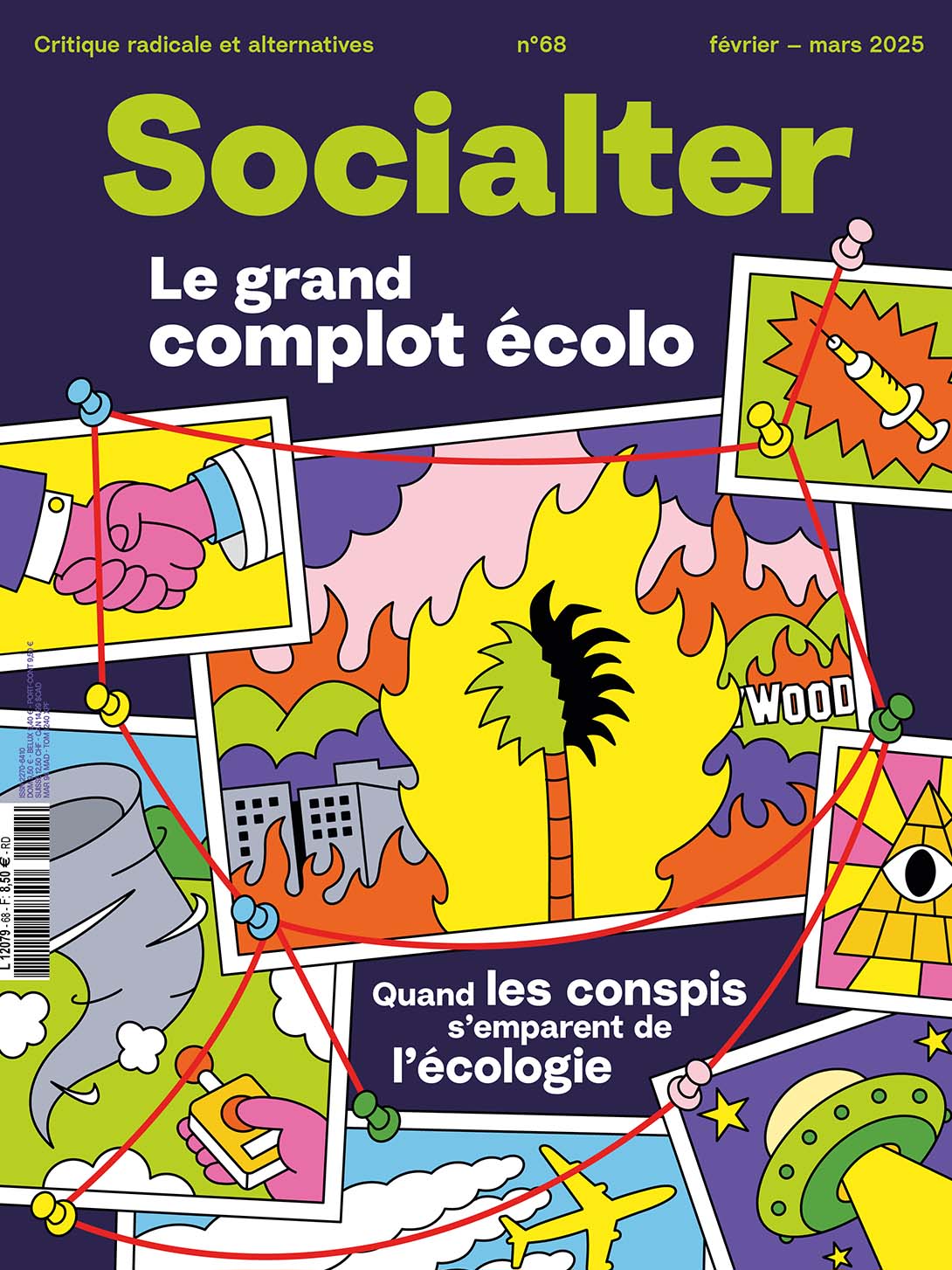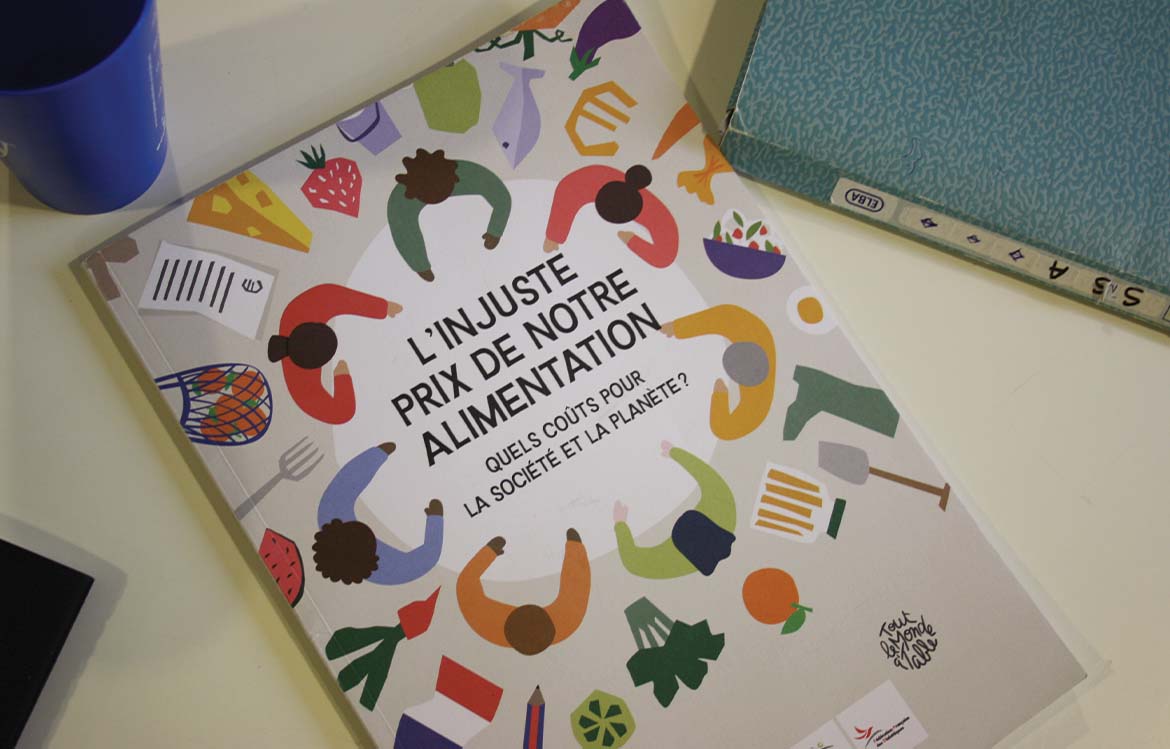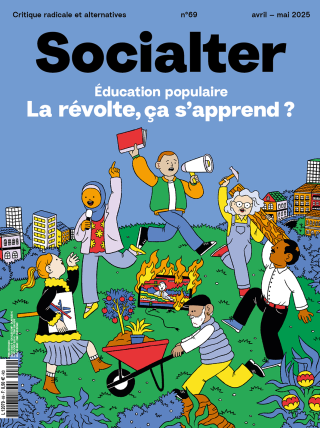Il est presque 18 heures. Concepcion, Muriel et Cynthia discutent à l’intérieur de la Maison du paysage et de l’alimentation, un tiers-lieu qui a ouvert ses portes à Sainte-Foy-la-Grande (Gironde) en 2023 pour accueillir la Scop Saluterre et l’association locale les Râteleurs, qui défend une éducation populaire à l'alimentation durable. Un canapé vert foncé en velours et plusieurs chaises métalliques sont disposés en cercle autour d’une table basse, près d’une cuisine où plusieurs mets et boissons, apportés par les habitants, attendent d’être consommés.
Article de notre n°68 « Le grand complot écolo », disponible en librairies et sur notre boutique.
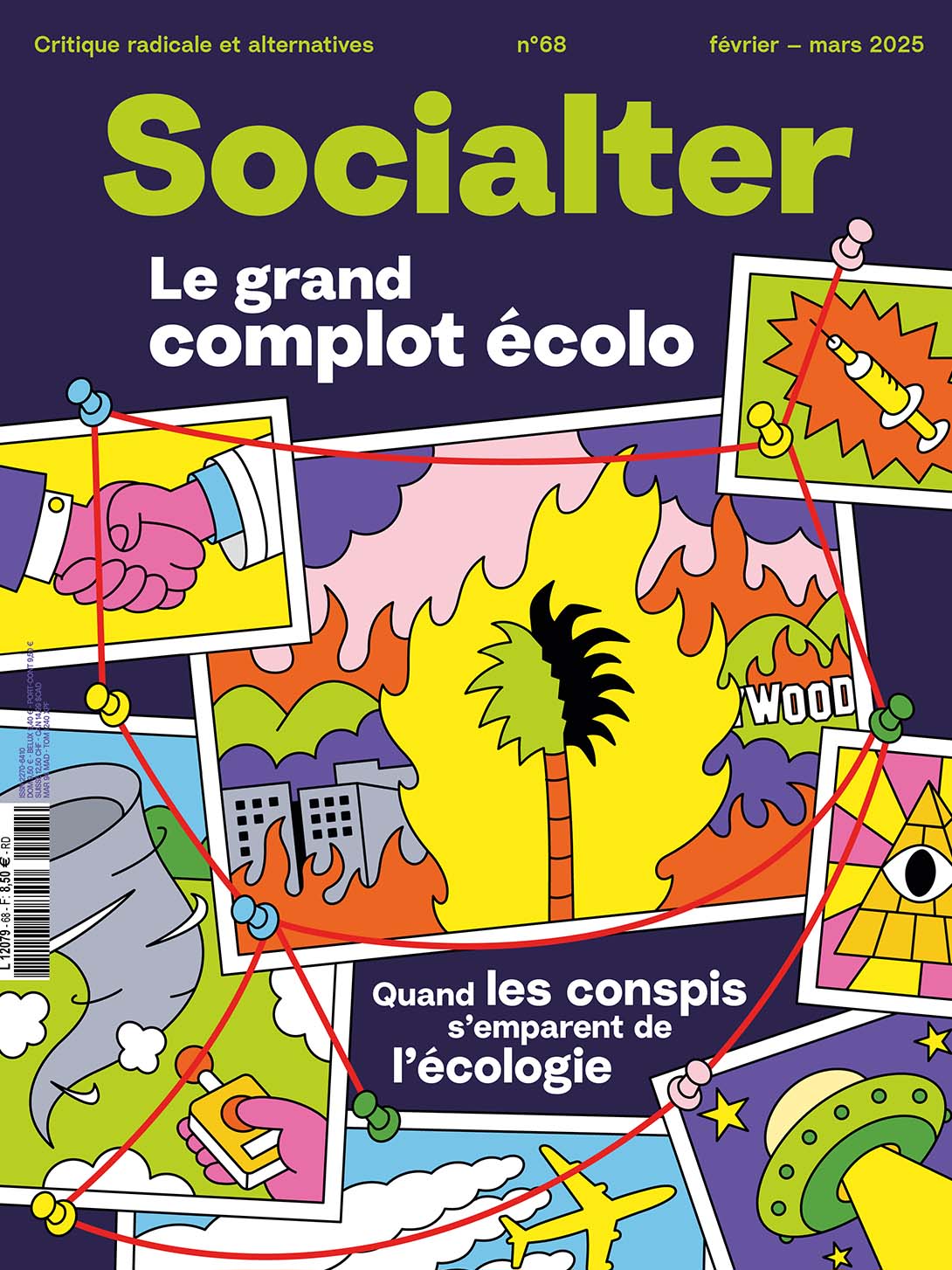
Ils sont une quinzaine à se retrouver, parmi les 2 500 habitants de cette petite commune située à une heure de Bordeaux en train. Ce soir, un motif précis les réunit : leur caisse commune d’alimentation. Lancée huit mois plus tôt par l’association Acclimat’action et le département de Gironde, cette expérimentation convie près de 400 citoyens, certains volontaires, d’autres tirés au sort, à mettre en pratique pendant un an une caisse commune alimentaire, inspirée de l’esprit mutualiste de la Sécurité sociale.
Le principe ? Chaque participant verse une cotisation mensuelle et reçoit en retour un montant d’une valeur de 150 euros à utiliser chaque mois sous forme de MonA(1) qu’il peut dépenser chez des producteurs locaux ou des épiceries bio partenaires. Le montant de cette contribution est autodéterminé, guidé par une grille qui permet de se situer par rapport à ses revenus, son budget alimentaire et son reste à vivre.
Pour Concepcion, ancienne technicienne à l’Assedic (remplacé par Pôle emploi) et bénévole pour Emmaüs, aujourd’hui retraitée et arrivée à Sainte-Foy en février 2024, « participer à la caisse est un geste citoyen et politique qui permet de tourner le dos aux grandes surfaces et de se rapprocher des producteurs ». Convaincue que ces rencontres entre bénévoles et producteurs locaux permettent de se confronter aux difficultés des uns et des autres, Concepcion assiste à toutes les réunions de la caisse et a progressivement augmenté le montant de sa cotisation. « Ici, je peux donner de mon temps ; c’est essentiel de penser aux autres et de s’assurer que les producteurs soient rémunérés justement. »

Depuis mars 2024, 193 foyers en Gironde, quel que soit leur niveau de revenus, prennent part à ce projet prévu sur un an – dont 30 % de foyers précaires. « Pas facile de sortir du système des supermarchés, confie Cynthia, responsable d’un magasin de matériel médical, qui a rejoint la caisse en juin 2024. Surtout qu’à mon arrivée, j’étais encore au chômage. Sans ce système, je n’aurais pas pu découvrir tous ces lieux ni bénéficier d’autant de diversité et de qualité dans mon alimentation. »
Remettre les citoyens au centre
Cette initiative locale s’inspire d’une idée qui gagne du terrain, popularisée par le sociologue et économiste Bernard Friot2 : la Sécurité sociale de l’alimentation. « Ce travail de réflexion a commencé après 2010 et a réuni des chercheurs qui s’intéressent au système alimentaire, des militants, des paysans, des syndicats agricoles, comme la Confédération paysanne, et des ingénieurs. C’est le fruit de cette émulation collective qui a permis l’émergence du concept d’une Sécurité sociale de l’alimentation », précise Tanguy Martin, membre d’Ingénieurs sans frontières, une des organisations à l’origine du collectif national de la Sécurité sociale de l’alimentation.
En Gironde, le projet de caisse commune alimentaire remonte à 2019. Inspirée de la Convention citoyenne pour le climat, l’association girondine Acclimat’action a d’abord organisé plusieurs temps d’échanges, avec l’ambition de laisser en priorité la parole aux personnes précaires. Des groupes de 40 volontaires, répartis dans deux quartiers populaires de Bordeaux, à Bègles et dans deux territoires ruraux – Sainte-Foy-la-Grande et le sud Gironde – se sont ainsi donné rendez-vous toutes les deux semaines, et ce, durant six mois.
« En créant une homogénéité avec les autres, les bénéficiaires précaires ne sont pas stigmatisés dans des lieux stigmatisants »
« Le but de ces rencontres régulières était d’apprendre à se connaître et partager ses expériences autour de l’alimentation dans un premier temps », résume Lucile Lucas, salariée d’Acclimat’action et responsable de l’animation des caisses. « L’idée, c’était de créer une culture commune avant de se lancer dans l’expérimentation », ajoute David Glory, ethnologue membre du bureau d’Acclimat’action et chargé du suivi scientifique de l’expérimentation en cours.
À l’issue de ce premier temps, les citoyens se sont mis d’accord sur une liste de critères déterminants – « l’accessibilité et l’inclusivité, le bien-être au travail, la transparence et la juste rémunération des producteurs, et des pratiques agricoles durables et locales » – pour choisir les lieux de distribution alimentaire et les producteurs locaux à conventionner dans le cadre de leur caisse commune.
Solidarité et « démocratie alimentaire »
Contrairement au système d’aide alimentaire, qui repose en grande partie sur le don de la grande distribution aux associations, les caisses alimentaires mettent tous leurs participants sur un pied d’égalité : « En créant une homogénéité avec les autres, les bénéficiaires précaires ne sont pas stigmatisés dans des lieux stigmatisants », assure David Glory. « On pense souvent que les caisses alimentaires répondent seulement à la précarité alimentaire, poursuit le chercheur. Mais c’est bien plus que ça. »
Dans son ouvrage La France qui a faim (Seuil, 2023), l’anthropologue Bénédicte Bonzi rappelle que l’accès à l’alimentation est un droit inscrit dans la Déclaration universelle des droits de l’homme. Or, celui-ci est mis en péril « par un système aux mains de l’agro-industrie, du productivisme, qui prend en otage les agriculteurs, à la consommation, qui exclut des millions de personnes et leur réserve une nourriture indigne – en particulier les produits ultratransformés dont la toxicité pour la santé est connue »(3).
Pour l’association Acclimat’action, il s’agit également de remettre les citoyens au centre du système alimentaire : « Nous avons constaté que plus les gens participent à la vie démocratique, plus ils augmentent leurs cotisations », souligne David Glory. Même si les personnes présentes à ces temps démocratiques restent pour le moment peu nombreux par rapport à l’ensemble. Pour les participants, le projet de caisse ne représente pas qu’un simple chèque alimentaire. « Je me sens plus légitime à m’exprimer lors des réunions, même si nous ne partageons pas tous la même vision », déclare Cynthia.
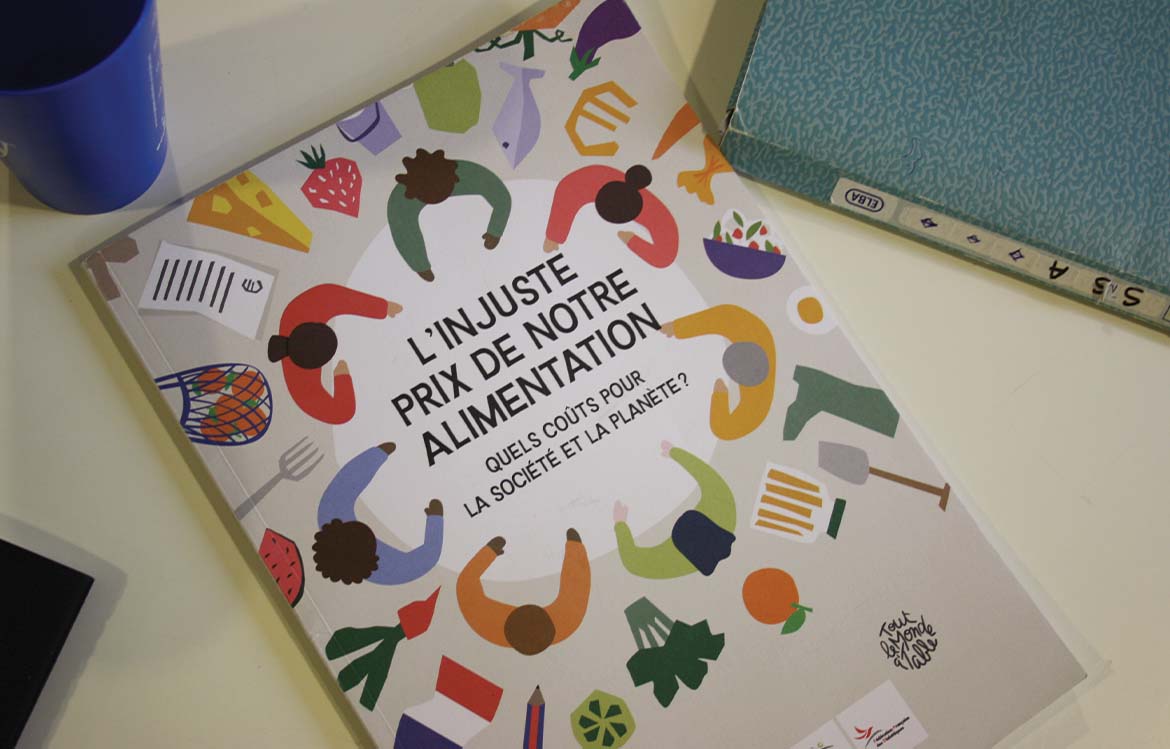
Dans son quartier, classé quartier prioritaire de la politique de la ville, les cotisants sont en effet aux commandes : le fonctionnement des caisses repose sur la prise de décision collective par un accord de tous les membres du groupe. Et pour la caisse du pays foyen en particulier, le réseau de producteurs se tisse grâce aux relations des habitants. « Avant de rejoindre la caisse de Sainte-Foy, j’étais déjà dans une Amap. J’ai donc proposé à une agricultrice qui fait du fromage de chèvre, avec qui j’étais en contact, de nous rejoindre », témoigne Muriel, peintre verrière et résidente de Sainte-Foy.
Pour maintenir cette dynamique, l’association Acclimat’action organise une réunion mensuelle et une autre plus informelle « pour continuer à faire du lien et échanger sur des sujets politiques ». Sans oublier les réunion qui rassemblent les quatre caisses de Gironde. « Dans tous les cas, ce sont les foyers cotisants qui prennent les décisions concernant leur caisse », rappelle l’animatrice.
Vers une extension de la Sécu ?
« Aujourd’hui, on compte cinq caisses en place à Montpellier, Lyon, Toulouse et Cadenet, en plus de la Gironde, et au moins une quarantaine en cours de construction en France », déclare David Fimat, coordinateur du projet des caisses au sein d’Acclimat’action. Malgré des modalités parfois différentes, ces initiatives locales ont en commun une volonté de mettre en place une nouvelle forme de protection sociale. « Créer une nouvelle branche de la Sécu, pourquoi pas, mais pas pour que la Sécu soit gérée de la manière dont elle l’est maintenant », nuance toutefois David Glory de l’association Acclimat’action.
Car la Sécurité sociale n’a plus grand-chose à voir, selon lui, avec l’esprit mutualiste de ses débuts. Si à partir de 1946 « les ouvriers contrôlent l’institution »(4) écrit l’historien Nicolas Da Silva, et représentent alors 75 % des sièges à toutes les échelles du pays, en 1967, l’ordonnance Pompidou introduit la parité entre employeurs et salariés à la Sécurité sociale. Elle supprime les élections directes par les assurés sociaux pour les remplacer par une désignation par les organisations syndicales et patronales – à laquelle seuls les syndicats reconnus par l’État peuvent prétendre. Avec cette réappropriation par l’État, « le régime général devient étranger aux intéressés » rappelle le chercheur.
« Créer une nouvelle branche de la Sécu, pourquoi pas, mais pas pour que la Sécu soit gérée de la manière dont elle l’est maintenant »
Pour l’instant, la caisse de Gironde fonctionne avec 25 % de contributions volontaires et 75 % de subventions publiques, dont 150 000 euros du Département, présidé par l’élu socialiste Jean-Luc Gleyze, et un apport de certaines communes comme Bordeaux et Bègles. À plus long terme, « l’ambition est de lancer des dynamiques qui permettent de s’approcher de ce que pourrait être une Sécurité sociale de l’alimentation, avec une augmentation progressive du nombre de gens et l’atteinte d’un équilibre financier grâce à une cotisation sociale prélevée sur les salaires et non via une contribution volontaire », argumente David Glory.
Un horizon partagé par onze caisses locales qui se sont réunies à Arcachon durant un week-end début décembre. Si toutes ces initiatives sont « un moyen de requestionner le modèle de Sécu actuel », d’après Lucile Lucas d’Acclimat’action, arrivée à un certain seuil, cette offre, pour l’instant marginale, ne sera plus suffisante. « Tout l’enjeu des caisses sera donc de s’impliquer petit à petit dans un rôle transformatif du modèle agricole pour que ce système puisse bénéficier à tout le monde », poursuit David Glory.
En attendant, les habitants ont jusqu’à mars pour réfléchir ensemble aux futurs contours de leur caisse avant l’arrêt des subventions, sur lequel leur modèle économique repose en grande partie. Faut-il rendre la cotisation obligatoire pour les membres ? S’engager sur un montant pour avoir un budget prévisionnel ? Ou bien baisser le montant des MonA ?
Autant de questions qui animent la réunion du petit groupe de citoyens réunis, ce soir, à Sainte-Foy. Le prochain défi : réunir le plus grand nombre de participants, sur les 193 foyers, pour réussir à trancher. Avec l’espoir d’ancrer cette aventure collective durablement dans le temps.
1. Pour « monnaie alimentaire », bien que ce système ne repose pas sur une monnaie en tant que telle (1 MonA est égale à 1 euro).
2. Pour aller plus loin : Bernard Friot, Frédéric Lordon, En travail. Conversations sur le communisme, La Dispute, 2021.
3. « Le don de nourriture est devenu la béquille d’un système alimentaire prédateur », propos recueillis par Youness Bousenna, Le Monde, 22 mai 2023.
4. Nicolas Da Silva, La Bataille de la Sécu. Une histoire du système de santé, La Fabrique, 2022.
Soutenez Socialter
Socialter est un média indépendant et engagé qui dépend de ses lecteurs pour continuer à informer, analyser, interroger et à se pencher sur les idées nouvelles qui peinent à émerger dans le débat public. Pour nous soutenir et découvrir nos prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner !
S'abonnerFaire un don