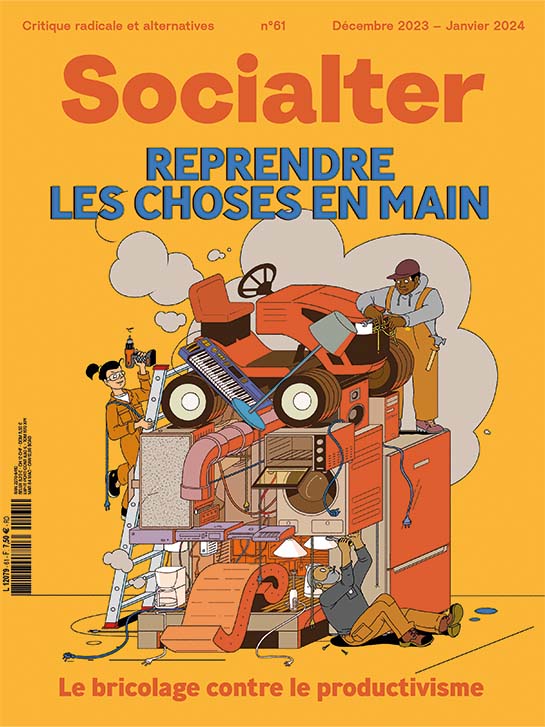Le titre de votre ouvrage Le monde est une vallée (édition Buchet Chastel) fait référence à la vallée de la Seille, en Moselle, polluée sans que les habitants ne s’expliquent pourquoi…
Cette histoire m’a été racontée par l’archéologue qui a fouillé ce site, que j’ai visité à une époque où l’on suivait beaucoup moins les questions environnementales. Ce que montre l’histoire de cette vallée, c’est que l’exploitation des sources salées aux âges du bronze et du fer a engendré des dégâts tels que, dans les cahiers de doléances de la Révolution française, les habitants de ce territoire se plaignent de leur situation sanitaire dégradée sans en comprendre l’origine.
Entretien à retrouver dans notre numéro 61 « Reprendre les choses en main » en librairie et sur notre boutique.
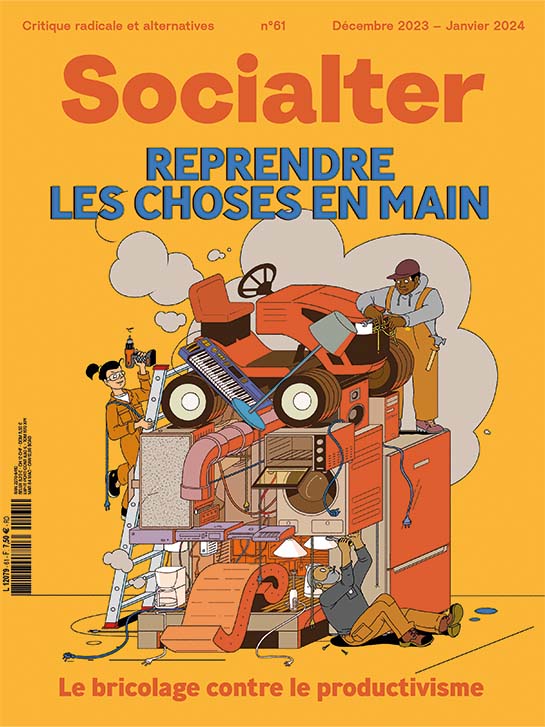
Au XIXe siècle, une enquête menée par un médecin révèle que la population de cette vallée meurt dix ans plus tôt que ses voisins, sans qu’il ne puisse établir les liens de causes à effets. On sait aujourd’hui que tout cela était lié à l’incroyable intensité de l’exploitation des salines, plusieurs millénaires auparavant.
Cette histoire résonne avec l’actualité, à une autre échelle de dégâts bien évidemment. L’ignorance des causes, l’ignorance de ce qui fait souffrir les gens, est terriblement actuelle. Cette question de la causalité – qui traverse les dix années de textes rassemblés dans le livre – est majeure. On ne relie pas suffisamment les grandes questions sociales et politiques aux questions environnementales. Quand on parle de « migrants », pour ne prendre que cet exemple : qu’est-ce qui pousse les gens à aller sur des radeaux, à risquer leur vie comme des désespérés ? Les bouleversements écologiques fragilisent et mettent sur la route de l’exil de nombreuses populations. Les tensions sur les ressources – l’eau, les matières premières, etc. – engendrent de la crispation, des conflits et des migrations. C’est pareil chez nous. Quand maintenir nos systèmes agricoles devient un défi parce que l’environnement change, cela crée nécessairement du mécontentement et de l’amertume. Et cela a forcément un effet politique. Nous restons trop souvent aveugles à ces liens de causalité aujourd’hui, alors qu’ils nous apparaîtront clairement dans quelques décennies.
L’histoire de la petite vallée de la Seille me fait aussi penser à Barbara Cohn, cette chercheuse de Berkeley qui a analysé des milliers de prélèvements sanguins effectués sur des femmes enceintes il y a cinquante ans et conservés en chambre froide depuis. Elle a mesuré le DDT* présent dans lesdits échantillons et a comparé avec la santé des filles de ces femmes. Soudainement, elle a réalisé que les cancers du sein chez les jeunes femmes les plus exposées in utero étaient multipliés par quatre, par rapport aux moins exposées, une véritable épidémie ! C’est probablement des centaines de milliers de morts. Quand on se replonge dans ce qu’on lisait sur le DDT dans la presse, il y a à peine plus de soixante ans, le propos se résumait à « on peut en manger ! ». C’est complètement fou rétrospectivement. Nous savions pourtant que le DDT tue les insectes, les oiseaux, mais nous avons en nous cette hubris, nous nous croyons au-dessus du vivant.
En octobre, une étude de l’Inserm pointait le lien entre des leucémies et la proximité avec des vignobles traités aux pesticides. Comment expliquer que la causalité faite, les choses ne bougent pas ?
Parce qu’on se mithridatise* contre ces infos-là. Il y a vingt ans, cette enquête aurait fait les grands titres, aujourd’hui ça n’affole plus. Le pire étant sans doute que ce que la science est capable de détecter aujourd’hui est la partie émergée de l’iceberg. Il faut bien comprendre que si on peut détecter quelque chose sur la leucémie, des choses nous échappent sur le développement de la cognition, l’immunité, le métabolisme, sur des tas de troubles et de pathologies qu’on ne découvrira que dans des années, voire des décennies. Le décalage est immense entre l’épidémiologie qui commence à mesurer, avec difficulté, une petite part des dégâts causés par la chimie et un grand public qui est sous-informé sur ces sujets.
Vos chroniques sont organisées en trois grands champs de bataille : « guerre contre le vivant », « climat » et « pouvoir », pourquoi cette arborescence ?
C’est le choix de Jil Silberstein, qui a choisi et ordonné ces chroniques ! Mais c’est une très bonne grille d’entrée car cela souligne une chose : lorsque l’on traite d’une question purement environnementale (comme la gestion de l’eau, la biodiversité) ou de la démocratie, on sait que le climat joue un rôle central, d’où sa place dans le livre.
La guerre au vivant, c’est l’étage immédiatement au-dessous, c’est ce qui va renforcer encore les impacts du dérèglement climatique. En essayant de regarder les choses de façon panoptique, on voit que le changement climatique est ce qu’on a de plus en plus de mal à arrêter. Alors, nous devrions au moins tenter d’atténuer ses effets en maintenant au mieux les conditions du développement de la vie. Mais c’est l’inverse qui se produit : la guerre que nous menons au vivant aujourd’hui rendra encore plus insupportables les conséquences du changement climatique demain.

Concernant le pouvoir, il me semble que le caractère très technique du monde dans lequel nous sommes en brouille l’intelligibilité. Nous ne déléguons plus le pouvoir en pleine connaissance de cause. Nous devrions avoir une idée précise de ce que la technique fait au monde. Or, nous ne l’avons pas, car on ne promeut pas cette connaissance. Tous les mécanismes démocratiques actuels partent du principe que la technique est neutre. Pas étonnant, dès lors, que nos délibérations collectives soient hackées par la technique qui dépolitise tout. Limiter la question technologique à de l’évaluation des risques, c’est dissimuler de la politique derrière un jargon technique que personne, ou presque, ne comprend.
Comme dans le cas de la 5G ?
Totalement ! En réalité, quand on pose la question aux gens, on sent bien qu’il y a une forme de décence commune, d’interrogation salutaire : « est-ce qu’il faut vraiment mettre nos efforts pour rajouter du débit dans le téléphone portable ? ». Mais comme trop souvent, cela ne fait pas débat publiquement. Comme la relance du nucléaire, comme tant d’autres choses. Le seul contre-exemple que je pourrais citer, ce sont les OGM : les controverses avec des scientifiques, des éclairages de juristes et de philosophes, avaient amené à une sorte de moratoire en Europe. Nous revenons dessus aujourd’hui avec des OGM nouvelle génération, non traçables et dérégulés… C’est là que s’exerce le pouvoir. Ce que j’essaie de raconter, c’est que parmi les lieux de pouvoir en Europe, il y a ces comités d’experts qui ont la main sur les seuils de risque, les conditions d’usage des technologies, les modalités d’autorisation des pesticides, etc. Leur rôle est, en réalité, éminemment politique. Personne ne sait qui siège dans ces comités, au nom de quoi ou de qui, ni ce qui s’y décide. C’est un énorme problème démocratique.
À propos de ces seuils, justement, les deux analogies qui reviennent le plus souvent sous votre plume sont « pour ne pas voir la fièvre, il suffit de décider que le thermomètre affiche 37 degrés » et « on fixe des seuils ineptes comme quinze paquets de cigarettes quotidiens sont très dangereux pour laisser croire que cinq paquets quotidiens sont sans danger ». Nous leurrer sur les dangers est-il aussi simple que cela ?
Nous sommes dans une forme d’ignorance volontaire. Vis-à-vis de la dangerosité des polluants et de la chimie, nous naviguons dans beaucoup d’ignorance, dont la fixation des seuils fait partie. Le souci étant que ces derniers sont fixés sur la foi de procédures extrêmement fragiles, pour ne pas dire plus. Un exemple, avec le bisphénol A : entre ce qu’ils estimaientcomme sûr en 2014 et ce qu’ils proposent fin 2022, les experts de l’EFSA [Autorité européenne de sécurité des aliments, ndlr] ont divisé le seuil de sécurité par 1 250 000 (oui oui, 1,25 million !). Au Monde, nous avons écrit des centaines d’articles sur le bisphénol A pour en pointer les risques sanitaires. Nous avons été traités d’obscurantistes, de Khmers verts... On nous opposait que l’exposition de la population se situait des milliers de fois sous les seuils de dangerosité et que nous affolions la population pour rien. En quelques années, les autorités sanitaires ont tant abaissé les seuils qu’en définitive, elles nous ont donné raison !
Encore un mot sur les seuils. Un récent mail du directeur de l’ARS Occitanie conseille de boire de l’eau en bouteille car les cours d’eau sont contaminés et cette info n’est pas rendue publique. Et l’on tente, encore une fois, de rassurer par les seuils…
Il faut bien comprendre que le seuil a une valeur politique. Établir un seuil, c’est permettre la mise en circulation d’une substance, c’est donner un espace à une activité industrielle au prix d’un risque. C’est donc précisément faire de la politique parce que cela fixe un ordre des priorités : produire toute une variété d’objets est considéré comme plus important que d’éviter tout risque sur la santé et l’environnement. Le résultat est qu’aujourd’hui, nous comprenons que le prix à payer pour avoir la chance d’utiliser des poêles en Téflon ou des textiles imperméabilisés, grâce à des poly- et perfluoroalkylés (ou PFAS, encore appelé « polluants éternels »), est que l’ensemble de la population et de la faune du monde entier est imprégné par ces substances, à des niveaux qui suffisent à nous mettre en danger.
Mettre les mains dans le cambouis des seuils, c’est voir que des milliards de gens peuvent être exposés à des polluants et c’est véritablement effrayant. D’autant que les procédures sanitaires sont d’une négligence incroyable : il arrive qu’on déclasse des métabolites1 de pesticides sur la base d’études faites sur quatre chiens et ça finit repris dans certains médias comme « des études scientifiques »… Ce que cela nous dit c’est que la technique telle qu’on la pratique dans les agences est mise au service de la promotion de l’industrie. Pour reprendre les très bons mots du sociologue Emmanuel Henry, il faudrait renverser la logique dominante et dire que les agences sanitaires autorisent ces produits à aller sur les marchés plutôt qu’elles ne les empêchent. Et cette différence est évidemment très politique.
Même au summum de la noirceur, vous conservez une forme d’humour à froid… Est-ce un mécanisme de défense ?
Il faut toujours un peu d’ironie pour survivre à tout cela. J’essaie de trouver des motifs de ne pas être furieux en permanence et c’est compliqué. Donc il reste l’ironie. L’autre sorte de réconfort que je trouve, c’est de me dire « finalement, les gens votent pour ce qui est en train de leur arriver ». J’essaie de participer au débat démocratique en mettant des informations sur la place publique, et les gens votent ensuite en conscience. Bien sûr, l’information n’est pas parfaite pour employer une litote ; il y a toute une diversité de mécanismes par lesquels les pouvoirs économiques pèsent sur l’accès et la hiérarchie de l’information, mais je me raccroche à cette idée que nous avons ce que nous méritons, en quelque sorte. C’est un raisonnement cynique et politiquement très faible mais, par moments, j’ai besoin de me raccrocher à ça.
Justement, quid de la place de l’écologie dans les médias ? Il y a désormais une Charte pour un journalisme à la hauteur de l’urgence écologique, nombre de titres (dont Le Monde) se prennent au jeu. Mais dans les grands débats politiques, l’écologie reste cantonnée à la portion congrue…
Le journalisme politique français est en échec de ce point de vue. Le pouvoir majeur des journalistes reste de poser des questions : en fonction du nombre de fois et de la manière dont on pose les questions, cela structure le débat public. Par conséquent, ne pas poser les questions les fait disparaître du débat et c’est ce qui arrive à l’environnement.
On parle encore trop de l’environnement comme d’un ensemble de phénomènes naturels. Quand vous êtes journaliste et que vous parlez des retraites, du pouvoir d’achat ou de l’immigration, vous mettez de côté la question environnementale, qui n’est traitée que par les confrères spécialisés. Or, la question environnementale – c’est-à-dire les altérations anthropiques de l’environnement à toutes les échelles – joue un rôle dans tous les compartiments de la vie sociale. On a beaucoup débattu des retraites récemment. Or, ces retraites seront prises dans quinze ou vingt ans. À aucun moment, il n’est question du climat alors que ce paramètre a une importance majeure ! Vous imaginez les gens qui travaillent en extérieur continuer à bosser à 64 ans sous des canicules à 50 °C ? Et ce n’est qu’un exemple !
La disparition de la thématique environnementale dans la plupart des débats de société relève d’une forme de naturalisation des dégâts que nous produisons sur l’environnement. C’est une façon de dire qu’il n’y a rien à faire à part essayer de s’adapter. On le voit quand Christophe Béchu dit lors de questions au gouvernement2 en parlant du réchauffement : « Vous instrumentalisez un phénomène naturel à des fins politiques. » C’est magnifique, quand l’inconscient s’exprime aussi clairement ! Voilà comment on éloigne la question environnementale de la conversation publique. Sans parler de tous les papiers qui naturalisent les travers de nos sociétés. Ce serait « notre cerveau » qui nous pousse à détruire notre environnement ? Mais, à ce compte-là, les femmes s’occupent des tâches ménagères car elles ont été biologiquement sélectionnées pour le faire, les pauvres sont pauvres parce qu’ils sont idiots, etc. Tous ces discours permettent de nous dédouaner de nos actions et de ne pas faire entrer dans le débat public des problèmes que l’on classe à tort comme naturels.
Vous avez récemment signé une chronique sur les « 50 nuances du climatoscepticisme ». Que vous inspire le fait qu’un certain nombre de médias servent de caisse de résonance à ces discours ? Faut-il une extension de la loi Gayssot3 aux causes environnementales ?
C’est un échec majeur du journalisme scientifique. À titre personnel, j’y ai investi beaucoup d’énergie en consacrant des centaines d’articles et un livre aux climatosceptiques, avec la certitude que montrer la vérité serait performatif. Or, non seulement cela n’a rien changé, mais il est possible que cela ait même été contre-productif. Pendant des années, j’ai mis un point d’honneur à couvrir les sciences du climat, à vulgariser la mécanique du réchauffement anthropique et le travail des chercheurs. Au risque de donner l’impression que si les chercheurs cherchent, c’est qu’ils ne sont peut-être pas si sûrs d’eux… Les climatosceptiques se sont engouffrés là-dedans. Avec le recul, je me dis qu’il n’aurait peut-être pas fallu prendre frontalement les sceptiques en essayant de les « débunker ». Aujourd’hui, il semble que le climatoscepticisme est plus haut qu’il y a dix ans. Quand on voit comment se déploient les effets du réchauffement, on se dit que c’est fou… Toute une partie de la population semble vivre dans un monde parallèle. On l’a vu pendant le Covid, quand la science s’est montrée en train de fonctionner, de réfléchir publiquement : ouvrir le capot de la disputatio savante ne produit pas les effets escomptés.
Le caractère très technique du monde dans lequel nous sommes en brouille l’intelligibilité. Nous ne déléguons plus le pouvoir en pleine connaissance de cause.
De même, on a longtemps eu l’idée que la culture scientifique permettrait d’améliorer le fonctionnement général du système. Je n’en suis pas sûr. Ceux qui ont propagé les discours les plus orthogonaux à la véracité étaient des grands scientifiques. Hors de leur champ de compétence, certes, mais Allègre4 hier, comme Raoult et Montagnier (l’un des découvreurs du VIH) se sont servis des lieux de science et de leur reconnaissance scientifique pour orchestrer la controverse. Or, pour le grand public, il est difficile de voir des scientifiques s’empoigner. Les gens prennent parti selon des affects qui n’ont rien de scientifique. Pour éviter ce genre de dérives, il ne faut pas une extension de la loi Gayssot. Les médias sont co-responsables dans la mesure où ils ne doivent pas les inviter et s’auto-discipliner. En revanche, il devrait y avoir un ordre des savants capable d’exclure ses membres quand ils manquent à la déontologie la plus élémentaire.
Dans une de vos chroniques de 2018, vous montrez qu’un triple risque pèse sur Bayer-Monsanto : juridique, avec des centaines de procès pouvant causer leur perte, sanitaire, avec l’accumulation des soupçons sur les effets de leurs produits, et technique, avec le développement de résistances à leurs nouveaux herbicides. Cinq ans plus tard, les défaites au tribunal se comptent sur les doigts d’une main et l’UE n’a pas renoncé à prolonger l’autorisation du glyphosate pour dix ans. Que vous inspire la résistance de « Bayanto » ?
Je nuancerais : ils ont quand même provisionné plus de dix milliards de dollars pour indemniser les plaignants avec des règlements à l’amiable. Leurs déboires judiciaires s’accumulent. Bayer a perdu un nouveau procès le 27 octobre et a été condamné à verser 175 millions de dollars à un utilisateur de glyphosate frappé par un lymphome. Pour autant, vous avez raison, ils sont toujours là et rappellent que le vrai pouvoir n’est plus au politique, que les États se sont mis dans la main de ces conglomérats qui concentrent un pouvoir économique et politique inouï. Nous n’étions pas obligés d’autoriser une telle concentration des secteurs semenciers et agrochimiques, mais nous l’avons fait. Il y a plus d’États faillis que de grandes firmes multinationales en faillite, cela devrait nous interroger…
Votre question me renvoie à un reportage de Cash Investigation sur France 2 où l’on voyait des viticulteurs en tenue de scaphandriers épandre des pesticides à 50 mètres d’une école. Face à cela, Stéphane Le Foll, ministre de l’Agriculture, avait dit que la France allait diviser par deux le recours aux pesticides. L’un des plans suivants montrait Jean-Charles Bocquet, le patron du lobby européen des pesticides, dire en substance : « bah non, on ne va pas faire ça ». Imaginez la même scène avec un ministre de la Défense disant « on ne va pas prendre ces frégates » et un industriel de l’armement lui rétorquant : « bah si ». Il y aurait un tollé national. En l’espèce, la séquence est passée comme une lettre à la poste.
Le report de la révision du règlement Reach (qui devait permettre d’interdire l’usage d’une multitude de produits chimiques néfastes à l’horizon 2030) et son absence au programme de la Commission européenne jusqu’en juin 2024 marque-t-elle une faillite politique ou une victoire des lobbys ?
C’est évidemment une victoire écrasante des lobbys, doublée d’une faillite morale et politique inouïe. La Commission a investi des millions d’euros en études de biosurveillance pour tester la présence de milliers de produits dans le sang des Européens. Nous avons désormais une vision bien plus précise qu’auparavant du fardeau sanitaire que représente la chimie de synthèse pour nos sociétés. Dans son étude d’impact, la Commission reconnaît que les maladies causées par la chimie vont des cancers aux troubles de la fertilité en passant par le métabolisme et les maladies neurologiques et qu’elles pèsent au moins pour 31 milliards d’euros par an à l’échelle de l’Europe !
Derrière les chiffres, ce sont des malades et des morts par milliers, sans doute bien plus. Même l’argument économique ne tient pas : le coût pour les entreprises qui seraient visées par des mesures de retraits drastiques est dix fois inférieur à ce que cela coûte à la collectivité. Le vieil adage « privatisation des bénéfices et collectivisation des pertes » trouve sa traduction la plus assumée. Dans Le Suicide de l’espèce (Denoël, 2023), le docteur Jean-David Zeitoun démontre avec justesse que nous vivons toujours dans l’idée que l’activité économique produit plus de bénéfices que de dommages alors qu’aujourd’hui, nombre d’activités économiques produisent désormais l’inverse. On en revient sans cesse à notre vision magique du monde où le bonheur et le bien-être sont indexés sur la croissance… Juste un fait : aux États-Unis, le modèle prétendument à suivre, l’espérance de vie est aujourd’hui retombée au niveau de 1994 et se situe désormais en dessous de celle de Cuba. Cela devrait nous réveiller face à nos schémas de développement : ils ne marchent pas !
« Amish », « écoterroristes », « Khmers verts »… les néolibéraux ne se contentent pas de mener une guerre de mots aux militants écologistes, ils les surveillent activement, les violentent. Nous ne sommes pas encore le Brésil où les défenseurs du vivant sont assassinés, mais tout de même, quelle pente mortifère. Comment vous l’expliquez-vous et voyez-vous poindre un retournement de l’opinion ?
Je n’aime pas jouer les futurologues, mais je ne pense pas qu’il y aura un retournement de la majorité de l’opinion. Il me semble que cette dernière est très légitimiste, avec un attachement à ce que les gens perçoivent comme le fonctionnement de la démocratie locale : une autoroute ou un aéroport sont voulus par les élus et doivent pouvoir être menés à bien. En revanche, je crois que de plus en plus de nos concitoyens prennent conscience du fait que notre débat public ne fonctionne pas correctement. On ne peut pas continuer à mettre en chantier ces grands projets sans être dans une forme de déni sur ce qui se passe. Le hiatus entre les bénéfices et les inconvénients de projets comme l’A69 se niche dans une forme de déni de la réalité et de la gravité des dommages environnementaux que nous produisons, et de l’effet boomerang que cela aura sur la génération de nos enfants.
Idem sur la criminalisation des militants écologistes, c’est une pente très inquiétante. L’Adversaire avec une majuscule, c’est le mouvement écologiste. L’exemple de la cellule Déméter5 est lourd de sens : on voit le ministère de l’Intérieur signer des conventions avec des syndicats agricoles. C’est une forme de privatisation des forces de l’ordre très inquiétante pour l’avenir car il y a un un poid, deux mesures dans ce que l’État accepte d’un côté et refuse de l’autre.
L’agriculture productiviste peut se permettre des choses en termes de menaces, dégradations ou violences qui ne seront jamais acceptées pour les militants écolos. Avec les bassines, l’A69 et autres projets d’artificialisation, l’État semble là pour permettre la privatisation des communs à n’importe quel prix, y compris violenter les militants écolos. La même chose se produit avec les mouvements sociaux et c’est très angoissant.
Le peu d’écho qu’a eu la grande enquête sur les polluants éternels « Forever Pollution Project* », à laquelle Le Monde a participé, n’illustre-t-elle pas l’absence de discussion sur les grandes questions écolos ?
Le problème, c’est qu’on continue à traiter ces sujets par le prisme de la naturalisation de la technique. Ces dégâts seraient irrévocables et il n’y aurait rien à faire pour les empêcher. On ne sait pas trop d’où viennent ces polluants, on découvre un désagrément que la nature nous a légué, et forcément le sujet ne percole pas dans le débat politique. A contrario, la meilleure manière de remettre de la politique, c’est de faire des conventions citoyennes. Macron n’a pas tenu parole, il n’est pas allé au bout de la démarche avec la convention citoyenne sur le climat, mais c’est le seul moyen de contourner la caste médiatique des éditorialistes de plateaux, encalminée dans la petite vie politicienne et électorale. Ce type de convention peut les obliger à s’en saisir. La première chose que la convention climat a démontré, c’est le déficit d’information : les membres de la convention n’étaient pas écolos, mais on leur a expliqué clairement la situation, avec des experts, avec des parties prenantes, etc. Il en est sorti des propositions d’actions plus radicales que tout ce qui est produit dans la sphère politique – y compris en provenance d’EELV. Le problème de départ, c’est que les citoyens ne sont pas assez informés.
Avez-vous un regret en relisant ces dix années de chroniques ?
Sans conteste, d’avoir toujours été trop optimiste. En me relisant, je vois que ma crainte d’exagérer, de survendre le péril, d’apparaître comme militant, m’a souvent poussé à pécher par excès d’optimisme. Cette réticence à verser dans le journalisme militant n’est pas un refus de l’engagement : je crois simplement que cette place n’est pas la mienne. Je pense que les sciences de la nature suffisent largement à montrer le caractère injuste et non durable du fonctionnement de notre monde.
Le DDT
Le DDT (pour dichlorodiphényltrichloroéthane) est un insecticide de synthèse utilisé massivement à partir de la Seconde Guerre mondiale, principalement dans l’agriculture et pour lutter contre le paludisme et le typhus. Il est interdit dans les années 1970 et 1980 dans la plupart des pays après des recherches attestant les observations de la biologiste états-unienne Rachel Carson qui, dans Printemps silencieux (1962), pointait ses effets néfastes sur l’environnement. Il continue à être utilisé dans certaines régions pour lutter contre le paludisme.
Mithridatisation
Le terme a pour origine le mythe du roi antique Mithridate qui, craignant d’être empoisonné, aurait développé une résistance à certains toxiques en absorbant de petites doses tout au long de son existence. Par extension, le terme est utilisé pour décrire l’insensibilisation à des idées, à des faits, auxquels on est constamment exposé.
« Forever Pollution Project »
Le « Forever Pollution Project » est une enquête collaborative inter-nationale de journalistes, ayant adopté une méthodologie scientifique reconnue, sur l’étendue de la contamination de l’Europe par les substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS), une famille de composés ultratoxiques employés dans une multitude de produits et d’usages. Le Monde a élaboré une carte permettant de visualiser l’ampleur de la contamination de l’Europe par ces « polluants éternels ».
1. Sous-produits issus de la dégradation des pesticides.
2. « Oui M. Béchu, le réchauffement climatique est “politique” », Reporterre, 21 avril 2023.
3. Votée en 1990, la loi Gayssot sanctionne pénalement la négation de l’existence historique des crimes nazis, et plus généralement des crimes contre l’humanité.
4. Claude Allègre, géochimiste, ministre de l’Éducation sous Lionel Jospin, connu pour ses prises de position controversées mettant en doute l’origine anthropique du changement climatique.
5. Unité de renseignement de la gendarmerie créée en 2019 dans le cadre d'une convention avec la FNSEA, le syndicat agricole majoritaire.
Biographie
Né en 1973, Stéphane Foucart est physicien de formation et diplômé de l’École supérieure de journalisme de Lille. Ses enquêtes en tant que journaliste au Monde lui ont valu le prix Européen du journalisme d’investigation en 2018. Traquant les climato-sceptiques et les marchands de doute industriels, il a fait paraître avec Stéphane Horel les « Monsanto Papers » qui ont révélé l’immense campagne de désinformation menée par la firme. Il est l’auteur de nombreux ouvrages, parmi lesquels La Fabrique du mensonge : comment les industriels manipulent la science et nous mettent en danger (Denoël, 2013), Des marchés et des dieux : quand l’économie devient religion (Grasset, 2018) et Un mauvais usage du monde (Seuil 2023).
Soutenez Socialter
Socialter est un média indépendant et engagé qui dépend de ses lecteurs pour continuer à informer, analyser, interroger et à se pencher sur les idées nouvelles qui peinent à émerger dans le débat public. Pour nous soutenir et découvrir nos prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner !
S'abonnerFaire un don