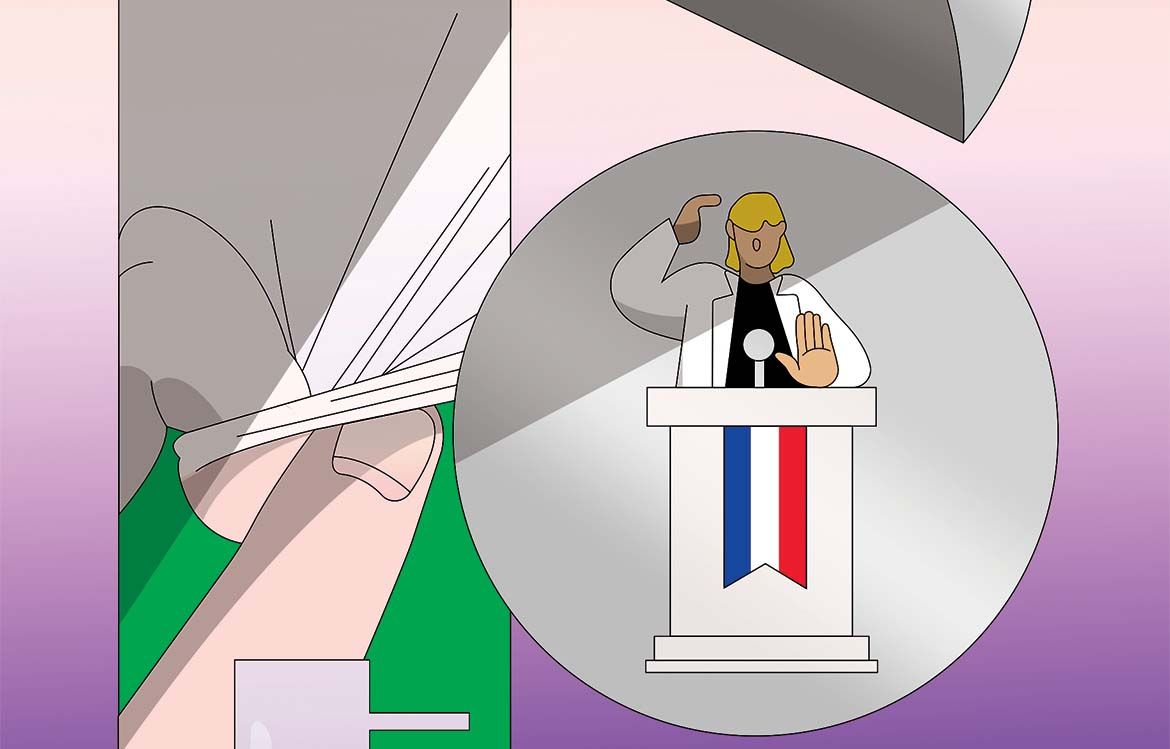Bonjour,
Socialter m’a suggéré d’écrire une lettre aux scientifiques qui contribuent aux rapports du Giec, mais j’ai préféré élargir mon adresse à celles et ceux qui, parmi les scientifiques, les lisent. Iels 1 sont, je crois, loin d’être aussi nombreux qu’on ne pourrait le penser. De fait, ces rapports ne leur sont pas d’abord adressés. Ils sont écrits par des scientifiques, mais sont avant tout destinés à informer les gouvernements. En tant que tels, ils doivent être approuvés avant publication par les représentants de ces gouvernements qui, par là même, reconnaissent la légitimité de leur contenu scientifique. Par conséquent, ils se veulent « utiles pour la prise de décision, mais sans intention de dicter l’action à engager », selon les termes de la présentation officielle du Giec.
Vous direz que cette absence d’intention correspond à la définition courante de l’objectivité scientifique lorsqu’elle concerne une question d’intérêt public. « Nous vous communiquons les “faits”, mais il vous appartient de décider comment vous les prendrez en compte. » À ceci près que, dans ce cas, ce qui sera déclaré « fait » a déjà été entériné par des représentants gouvernementaux qui, eux, ont en tête les intérêts et les priorités de leurs gouvernants respectifs. Et donc, celles et ceux qui contribuent à l’écriture de ces rapports savent que ceux qui les liront seront soucieux de censurer toute possibilité de mettre en cause la politique de leur gouvernement, aussi irresponsable soit-elle. Iels doivent espérer que les faits parleront d’eux-mêmes ou, plus précisément, que les scientifiques, libres de débattre, les relaieront, c’est-à-dire leur donneront la portée que les auteurs ont dû laisser quelque peu implicite, les doteront de conséquences qui ouvrent l’imagination à ce qui est vraiment en train de se passer et à ce que cela demande. C’est ce que les climatologues qui ont initié la fondation du Giec espéraient certainement 2. Mais cela ne s’est tout à fait passé ainsi. Où était leur erreur ?
« Les chercheurs et chercheuses qui travaillent aux batteries de demain s’en tiennent au fait scientifique “nu” : il faut diminuer les émissions de CO2. »
Vous qui me lisez, il y a beaucoup de chances que vous ne soyez pas de celles et ceux à qui cette lettre est formellement adressée. Les scientifiques lisent peu. Ou plutôt, ils lisent avant tout ce qui participe à la question qu’ils entendent faire avancer – les articles de leurs collègues qui peuvent y contribuer. Mais relayer les « faits » du Giec aurait demandé d’autres lectures, celles qui sont considérées au mieux comme une perte de temps, au pire comme le signe d’un intérêt de mauvais augure : elles peuvent créer le doute. On a souvent associé l’esprit scientifique à l’art de douter. Mais le doute ne doit pas affecter la confiance dans l’avancée de la connaissance comme étant au service du bien commun.
Retrouvez le texte d'Isabelle Stengers dans Bascules 2022 - Pour un tournant radical, sur notre boutique et en libriaries.

Or, de « mauvaises » lectures peuvent donner des idées propres à ébranler cette confiance. Ainsi, ceux et celles qui se consacrent à l’amélioration des batteries des voitures électriques de demain retiennent des travaux du Giec qu’ils participent à la nécessaire « transition énergétique ». Mais je ne crois pas qu’iels lisent – et encore moins discutent – un texte comme celui de Jean-Baptiste Fressoz, selon qui « il n’y a en fait jamais eu de transition énergétique. On ne passe pas du bois au charbon, puis du charbon au pétrole, puis du pétrole au nucléaire. L’histoire de l’énergie n’est pas celle de transitions, mais celle d’additions successives de nouvelles sources d’énergie primaire. L’erreur de perspective tient à la confusion entre relatif et absolu, entre local et global : si, au XXe siècle, l’usage du charbon décroît relativement au pétrole, il reste que sa consommation croît continûment, et que globalement, on n’en a jamais autant brûlé qu’en 2013. »
Les chercheurs et chercheuses qui travaillent aux batteries de demain s’en tiennent au fait scientifique « nu » : il faut diminuer les émissions de CO2. Iels ne s’intéressent pas au rôle que joue la fée électricité dans les berceuses qui nous parlent de transition. Iels ne se demandent pas, du moins publiquement, pourquoi leurs travaux n’ont pas pour contrepoint des mesures impliquant un avenir de sobriété en matière de mobilité. Pourquoi de telles mesures sont repoussées comme relevant d’une écologie « punitive ». Iels protesteront que cela ne les regarde pas. Leur tâche est de travailler à une avancée des connaissances qui donne une solution à un problème d’intérêt général. Iels doivent faire confiance à « la société » qui décidera du bon usage de ce que leurs travaux rendent possible. La science doit être « politiquement neutre », la « politiser » serait la tuer. Il semble, pour les scientifiques qui protestent ainsi, que susciter l’intérêt de l’État et de l’industrie pour ce qui sort de leurs laboratoires n’a rien de politique. C’est d’ailleurs ce que ces alliés les encouragent à penser. Le discours officiel est que « la science » contribue ainsi au progrès du genre humain. Et il est désormais bien entendu que cette contribution doit activement prendre en compte les exigences de la compétitivité et la soumission aux lois du marché. Tout cela n’a, paraît-il, rien de politique. Il s’agirait juste pour les chercheurs de prendre en compte « la réalité » s’iels veulent bénéficier des financements qui leur sont nécessaires. Car la « gouvernance » de la science a bien changé ces dernières décennies. En Europe nous avons d’abord eu droit à la « société de la connaissance », mais cette expression a été plus ou moins enterrée au profit de celle d’« économie de la connaissance » 3.
De même, l’adjectif « durable » a d’abord été accolé au terme « développement » (sommet de Rio de Janeiro, 1992), mais est ensuite venu s’associer à celui de « croissance ». Je ne parlerai pas de distorsion entre ces deux perspectives salutaires. Mais l’économie, substituée à la société, referme la porte entrouverte par la question des pratiques qui permettraient aux connaissances d’être effectivement « socialisées », partagées, évaluées et appréciées sur un mode lucide quant à leur portée et leurs conséquences. Et la croissance cloue la porte, car elle transforme l’avancée de la connaissance en source d’innovations, brevetables de préférence. Aujourd’hui, il est clair que toutes les avancées de la connaissance ne se valent pas. Certaines sont reconnues comme porteuses d’innovation et sont devenues des rouages de la machine économico-financière alors que d’autres vivotent désespérément. Et les équipes de recherche qui ne veulent pas vivoter se doivent de rédiger des projets qui s’inscrivent dans des objectifs de durabilité et de compétitivité, c’est-à-dire de soumission à la logique du marché. Sous le régime désormais institué de l’économie de la connaissance, iels ont dû, de plus, chercher à intéresser les industries, et donc aussi s’initier aux contraintes du secret industriel, de la prise de brevet et même du lancement de spin-off 4 se chargeant des recherches que l’industrie juge trop hasardeuses, mais qu’elle rachètera si elles tiennent leurs promesses.
« Ce qui est inconcevable pour vous est que la grande aventure de l’Homme conquérant la connaissance soit entravée. »
Certains d’entre vous qui lisez cette lettre avez peut-être protesté, organisé des manifestations pour « sauver la recherche ». Mais ne réclamiez-vous pas d’abord la liberté de poursuivre la quête désintéressée de l’avancée de la connaissance, la seule, plaidiez-vous, à même d’apporter « de surcroît » des réponses aux problèmes qui préoccupent l’humanité ? Ce que vous dénoncez ou pleurez, c’est la trahison de vos alliés, l’État et l’industrie, qui ont cessé de respecter les distances qui protégeaient votre autonomie relative. Mais vous êtes-vous privés, lors de l’heureux temps où l’on vous respectait, de présenter cette alliance comme « naturelle », génératrice de progrès, permettant à la « connaissance désintéressée » de « servir l’humanité » ? N’avez-vous pas été d’accord avec ces alliés pour tenir à distance un public qui serait accusé d’être frileux, réactionnaire, mû par des craintes irrationnelles s’il rechignait au progrès proposé ? Et vos experts n’ont-ils pas manifesté un parti pris assez systématiquement favorable aux innovations technoscientifiques, mettant en garde parfois contre certains risques, certes, mais dans la perspective « réaliste » de préserver leur faisabilité, c’est-à-dire leur profitabilité ?
Je me souviens encore, il y a vingt ans, lors de l’affaire des OGM, la manière dont s’est profilé ce que pourrait être une « société de la connaissance », lorsque des citoyens récalcitrants et bien informés ont posé des questions lucides qui ont fait bafouiller vos experts. Ces mêmes experts, ou leurs successeurs, plaident désormais de toutes leurs forces pour la libre mise sur le marché de semences « qui ne sont pas des OGM » puisqu’on n’y ajoute pas de gènes étrangers, mais dont on « édite » le génome grâce à des « ciseaux moléculaires » tellement plus précis (quoique pas tout à fait). Vous-mêmes avez peut-être lu dans les avertissements du Giec l’annonce d’une époque où l’innovation technoscientifique serait plus que jamais vitale. Il ne s’agira plus seulement de « nourrir la planète » mais de la sauver. Comment s’en étonner ? Les histoires qui vous sont transmises de génération en génération sont, elles aussi, « éditées ». Elles célèbrent la manière dont « la science » a rendu possible la résolution de problèmes cruciaux pour l’avenir de l’humanité et la satisfaction de rêves que l’on pensait fous. Mais elles « coupent » avec les ciseaux du « progrès » l’interrogation sur la façon dont ont été formulés ces problèmes, et sur ce qui a permis de financer la satisfaction de ces rêves.
Ces histoires vous ont-elles fait penser que les industries et les États vous prêtaient une oreille attentive par respect pour votre savoir ? Que ce savoir, s’il mène aujourd’hui à interroger le sens même du progrès, allait être accueilli comme le sont ceux qui portent des possibilités d’innovations profitables ? Ou alors avez-vous accepté l’idée que c’était une « crise », à laquelle des solutions innovantes allaient certainement pouvoir répondre, quitte à attendre avec confiance le miracle de la géo-ingénierie ? En tout état de cause, ce qui est inconcevable pour vous est que la grande aventure de l’Homme conquérant la connaissance soit entravée, voire contestée, par des craintes somme toute assez « terre à terre » et risquant de « politiser » la recherche.
« Le temps perdu depuis des années se paiera de catastrophes qui iront en se multipliant et en s’amplifiant. »
Que la plupart d’entre vous continuent d’affirmer que la science est « apolitique », servant un intérêt plus élevé que les intérêts « terre à terre » des humains vulgaires, relève de ce qui est le contraire de l’imagination : l’imaginaire. L’imagination se cultive au contact d’autres, qui pensent et sentent différemment, alors que l’« imaginaire » se transmet de génération en génération, sur un mode essentiellement répétitif et stéréotypé. Lorsque les scientifiques se plaignent, c’est encore et toujours à leurs alliés d’hier. Comme si ceux-ci allaient finir par comprendre que seule la libre avancée de la connaissance peut leur apporter ce que « la société » attend de « sa » science. Apprendre à tisser des liens avec celles et ceux qui ont été maintenu·e·s à distance serait quitter la zone de confort d’un imaginaire qui les protège de « la politique ». Même ceux qui, parmi eux, sont spécialistes de la climatologie ont le plus grand mal à quitter cette zone de confort.
Lorsque le négationnisme climatique s’est déchaîné en France, avec Claude Allègre 5 pour figure de proue, les chercheurs qui ont répondu à son livre sur l’imposture climatique ont certes défendu dans le détail les travaux du Giec, relevant les erreurs et falsifications de ces négationnistes, mais ils ont soigneusement évité de développer la question qui était pourtant aussi évidente qu’un éléphant au milieu d’un salon mondain. Claude Allègre accusait les spécialistes du climat de diffuser des résultats biaisés par un parti pris politique. Ils ont répondu comme si le problème était « purement scientifique », prolongeant ainsi ce à quoi se sont obligés les rapporteurs du Giec. Ils ont donc maintenu la distance avec le public, sans partager avec lui le désarroi d’être forcés par les faits à sonner l’alarme et d’être accusés d’« alarmisme » 6.
Mais depuis quelques années, des « faits » beaucoup plus intrusifs que les mesures, calculs et modélisations scientifiques ont pris le relais et sonnent effectivement l’alarme. Les désastres qui se multiplient signalent que les possibles qui existaient encore dans les années 1990, lorsque le Giec publia ses premiers rapports et que fut adopté le protocole (non contraignant) de Kyoto, font partie du passé. Et cependant, nos gouvernants continuent à faire comme si nous avions affaire à une « crise » que nous serons capables de surmonter par des réformes pas à pas. Il semble que la perspective pour 2030 d’une « Europe durable » constitue une fin en soi pour les autorités européennes, alors que l’effort ne fera que commencer, la perspective d’une « neutralité carbone » se profilant vingt ans après. Et il faudra ensuite arriver à un bilan d’émissions de plus en plus négatif. Dans ce scénario, seuls sont durables les effets des gaz à effet de serre qui vont continuer à être émis pendant ce soi-disant « pas à pas » et à s’accumuler dans l’atmosphère.
« L’imaginaire scientifique qui vous paralyse est en train de se fendiller. »
Il est très difficile d’accepter que, même si les engagements étaient tenus, le temps perdu depuis des années se paiera de catastrophes qui iront en se multipliant et en s’amplifiant. Il n’y aura pas de récompense, de matin calme de l’après-crise. C’est difficile pour tout le monde, et l’on se demande comment les sociothérapeutes peuvent oser diagnostiquer l’éco-anxiété comme un « symptôme ». La situation n’est-elle pas effectivement désespérante ? Comment ne pas plutôt traiter de « symptôme » l’éco-optimisme auquel nos gouvernants nous exhortent ? Ce symptôme, je crains que beaucoup d’entre vous à qui je m’adresse en souffrent, redoublé par le sens de la responsabilité face à un public qu’il faut rassurer, car de quoi deviendrait-il capable s’il paniquait ? Mais les jeunes, et moins jeunes, qui interrompent leurs études ou renoncent à leur carrière pour participer à des reprises de terre ou à des ZAD, ou à des « soulèvements de la terre » contre ceux qui l’empoisonnent et/ou la bétonnent, ne paniquent pas. Ils relaient les « faits » qui crient au saccage des mondes humains et autres qu’humains.
On pourrait dire, à la manière de Greta Thunberg, qu’ils et elles « écoutent les scientifiques », mais font ce que les rapporteurs du Giec n’ont pu faire : désigner les ennemis, ceux qui, imperturbablement, continuent leur œuvre de mort. Leur nuire autant que possible et, indissociablement, réapprendre les pratiques de résistance, de coopération et de solidarité qui éveillent les sens et l’imagination contre le désespoir, n’est-ce pas la réponse « rationnelle », non symptomatique, de ceux et celles qui savent qu’il est peut-être très, voire trop tard, mais que cela ne fait que commencer ? Et que s’il n’est plus temps d’échapper à l’épreuve, il s’agit d’apprendre comment lui répondre ? De fait, vous le savez, l’imaginaire scientifique qui vous paralyse est en train de se fendiller. Certains jeunes chercheurs osent s’engager en tant que scientifiques là où le Giec est tenu de s’abstenir. Ils ont compris qu’il ne suffit pas de rendre les chiffres et les modèles plus précis, de faire avancer la connaissance du climat, mais qu’il leur faut trouver les moyens de se laisser affecter eux-mêmes par une situation qui exige qu’ils sortent du rôle du scientifique qui « dit les faits ». Il leur faut, contre l’opposition qui sert à disqualifier le public, entre raisons objectives et subjectives, apprendre à partager la tentation du désespoir et la volonté de résister. Certains rapporteurs du Giec eux-mêmes entrent en résistance et ont fait fuiter la version originale, avant censure, du rapport portant sur les mesures de limitation du dérèglement climatique, où l’on apprend que les « faits » condamnent désormais le genre de mesures que nos gouvernements jugent « réalistes ».
« Ne plus définir la Terre comme le terrain offert à l’imaginaire guerrier de l’“avancée de la connaissance”. »
Cette version a été diffusée par le collectif transnational Scientist Rebellion, qui engage depuis la COP26 de Glasgow, à l’automne 2021, des actions de désobéissance civile. Il ne s’agit plus d’informer le public mais de désigner les responsables de l’inaction climatique et des entreprises de greenwashing, que ce soient des académies, des musées scientifiques 7, des médias, des banques ou des consortiums industriels. Mais les chercheurs et chercheuses récalcitrant·e·s et les étudiant·e·s, pourtant parmi les plus doué·e·s, qui « désertent » ou « bifurquent », rejoignent les activistes dans les rues, les champs et les forêts, sont-ils, comme le pensent beaucoup de leurs aînés, attristés et désemparés, « perdu·e·s pour la science » ? Oui, si par « la science » on entend celle qui se définit contre « l’opinion ». Mais pas forcément si, à travers les liens qui se nouent, les intérêts qui se partagent, les rencontres qui transforment, l’imagination qui se repeuple, celles et ceux qui fuient « la science » se découvrent capables d’autre chose que ce à quoi leurs alliés traditionnels les ont voué·e·s. Rejeter le rôle assigné de pourvoyeurs de solutions dites « rationnelles », c’est-à-dire, presque par définition aujourd’hui, de complices des opérations de greenwashing profitables, ne signifie pas rejeter la raison mais l’entendre comme ce qui demande que l’on se rende digne de la situation à laquelle on est confronté.
C’est peut-être un sens de ce que Bruno Latour appelle « la nouvelle libido sciendi » 8 demandée par les « sciences terrestres » : ne plus définir la Terre comme le terrain offert à l’« avancée de la connaissance », imaginaire guerrier, mais comme ce qui exige des apprentissages toujours situés, qui ne peuvent se faire qu’en relation d’interdépendance avec d’autres, qui sont également concerné·e·s par la manière dont cette situation sera caractérisée et par ce qu’elle demande. Vous qui m’avez lue jusqu’ici, vous pensez peut-être que ma proposition est utopique parce que « les gens ne sont pas capables de ce genre d’apprentissage ». Mais vous-mêmes l’êtes-vous ? Nous sommes tous et toutes abîmé·e·s, vous les bergers et celles et ceux que vous avez traité·e·s, depuis ces deux siècles où le progrès est devenu un mot d’ordre, comme un troupeau à mener malgré lui vers la lumière. Sortir de votre zone de confort, bifurquer, est un pari sans garantie, c’est vrai, mais cela l’est pour chacun·e. C’est un pari pour la vie qui va continuer, avec ou sans nous.
Bien cordialement. •
1 Pronom personnel incluant « il » et « elle », sans distinction de genre (N.d.É).
2 Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec) a été créé en 1988 sous l’égide de l’Organisation des Nations unies, avec la mission d’établir un consensus scientifique sur le changement climatique et ses effets, à partir d’une synthèse acceptée par tous des données et études connues, en vue d’éclairer les décideurs politiques sur les stratégies à mettre en œuvre (N.d.É).
3 La « stratégie de Lisbonne » adoptée en 2000 fixe l’objectif de transformer l’Union européenne en « l’économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde » à l’horizon 2010 (N.d.É).
4 Société commerciale créée à partir d’un laboratoire de recherche (N.d.É).
5 Le géochimiste et ancien ministre Claude Allègre a émergé dans les années 2000 comme une figure de la négation du changement climatique en France, à travers des tribunes dans la presse et l’ouvrage L’Imposture climatique (Plon, 2010) (N.d.É).
6 Lorsque, en 2009, j’ai publié Au temps des catastrophes(La Découverte), qui n’a malheureusement pas perdu son actualité, c’est le terme « catastrophe » qui a d’abord attiré les commentaires. N’étais-je pas « catastrophiste » ?
7 Une première petite action a eu lieu le 9 avril au Muséum national d’Histoire naturelle.
8 « Désir de connaître »
Soutenez Socialter
Socialter est un média indépendant et engagé qui dépend de ses lecteurs pour continuer à informer, analyser, interroger et à se pencher sur les idées nouvelles qui peinent à émerger dans le débat public. Pour nous soutenir et découvrir nos prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner !
S'abonnerFaire un don