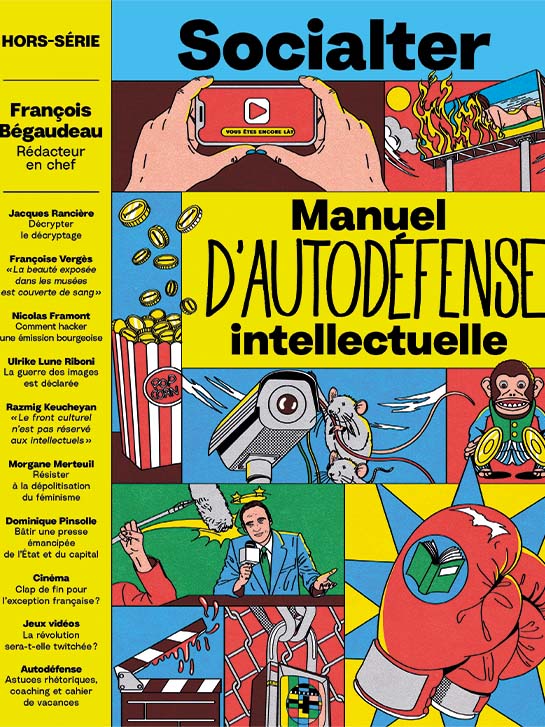Dans l’émission spéciale de Mediapart « #MeToo, 5 ans après » diffusée le 4 octobre 2022, la chansonnière Mathilde, militante du collectif Relève féministe, expliquait à la journaliste Marine Turchi l’apport, selon elle, du mouvement #MeToo : « Un sentiment de sororité par-delà les frontières. [...] À partir de ce moment-là, ma lutte féministe devenait moins cosmétique, plus politique, et j’ai pris des décisions aussi pour ma vie que j’avais jamais prises avant, comme par exemple le fait que mon féminisme prévaudra sur tout clivage partisan [...] peu importe mon niveau de désaccord avec une autre femme, elle bénéficiera toujours de ma sororité parce que nous vivons, en tant que femmes, les mêmes oppressions. [...] J’ai compris que nous étions unies par autre chose que nos clivages partisans. »
Article à retrouver dans notre hors-série « Manuel d'autodéfense intellectuelle », en kiosque, librairie et sur notre boutique.
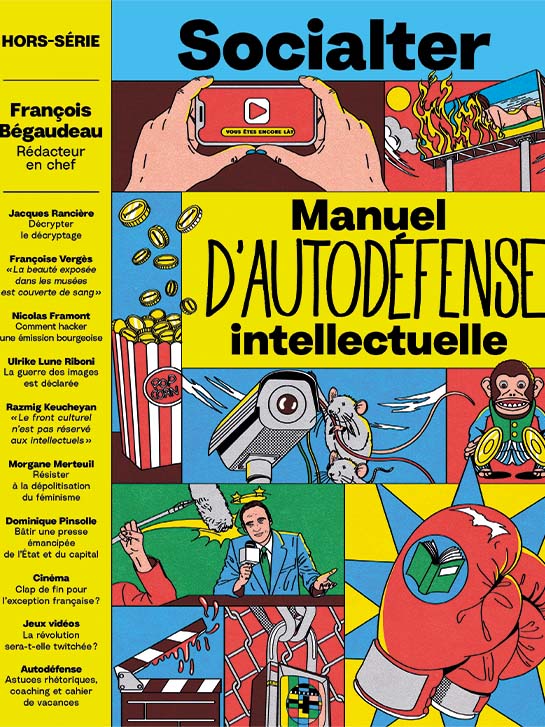
La prise de parole de Mathilde réunit les principaux écueils d’une certaine tendance des luttes féministes contemporaines en France : si une sororité est désirable au-delà des désaccords, c’est que « nous vivons, en tant que femmes, les mêmes oppressions ». Et c’est forte de cette idée que Mathilde peut affirmer que ce qui nous rapproche est donc plus fort que ce qui nous sépare. La boucle est bouclée : nous, femmes, faisons des expériences similaires d’oppression ; nous, femmes, devons nous réunir au-delà de nos divergences politiques.
Les présupposés de cette position imprègnent, moins explicitement peut-être, la majorité des discours qui se revendiquent aujourd’hui du féminisme entendu comme lutte contre les violences sexistes et sexuelles (VSS). Le caractère problématique de l’hégémonie qu’a prise cette lutte ces dernières années tient à ce qu’elle permet d’affirmer que les femmes constituent une classe partageant des intérêts, dans l’oubli que les « clivages partisans » qui les désunissent sont la traduction de clivages matériels, qui rendent certains intérêts irréconciliables. Dès lors, cette « sororité par-delà les frontières » peut être vue comme l’avatar d’une forme de réconciliation de classe.
Selon la périodisation la plus commune, le mouvement #MeToo aurait initié la « quatrième vague » du féminisme, qui aurait pour principal enjeu la lutte contre les violences faites aux femmes. Des articles sur la charge mentale aux décomptes quasi quotidiens des féminicides conjugaux, le prisme de la violence de genre et du continuum des VSS est devenu le principal angle du militantisme féministe et des articles médiatiques qui en parlent. Surtout, cette approche fait l’unanimité : des ambassadrices de l’ONU aux colleuses de rue en passant par Mediapart, une même et unique priorité féministe : en finir avec les VSS.
La dénonciation des VSS est évidemment nécessaire : après des siècles de domination, les victimes sont enfin écoutées et les agresseurs mis en cause. Mais cette lutte urgente ne peut masquer que le bloc féministe est fissuré par d’importantes contradictions internes, qu’il devra dépasser, quitte à affirmer de nécessaires ruptures entre « sœurs ». Comment combattre le système patriarcal aux côtés d’un gouvernement comptant Darmanin dans ses rangs ? De manière moins caricaturale, comment penser qu’une même analyse politique – puisqu’il s’agit bien de politiser la question des VSS – pourrait être partagée des milieux les plus réformistes aux plus anarchistes ? Le collectif NousToutes et la Coordination féministe antifasciste mènent-elles vraiment un combat commun ? Il y a lieu de questionner cet apparent consensus 1.
Ainsi, le vocable VSS traduit aujourd’hui majoritairement une conception de la violence comme ce qui est exercé par les hommes sur les femmes. Cette violence est « systémique » en ce qu’elle est massive, et nourrie par différents mécanismes du « système » (patriarcal) : à un bout de la chaîne, les petites filles à qui on apprend à se soumettre alors qu’on développe les traits de la masculinité toxique chez les petits garçons ; à l’autre, le féminicide (conjugal). Entre les deux, un ensemble d’individus et d’institutions qui reproduisent cette oppression, notamment via la culture du viol (des « harceleurs de rue » aux flics qui ne prennent pas les plaintes). En d’autres termes, le « système patriarcal » est avant tout un système moral : c’est parce qu’il est animé par une mauvaise morale que les femmes y sont violentées. Aussi, il faut que « la honte change de camp », comme si tout n’était finalement qu’affaire de probité morale, non de rapports de pouvoir.
Si on va au bout de cette logique davantage morale que politique, et qui a sa pertinence, la lutte contre les VSS revient à préserver un ordre intrinsèquement producteur de violences, en le parant d’un vernis féministe. Il convient de rompre avec cette tendance, et ce sur la base de trois principes : le refus de la rhétorique égalitariste (hétérosexuelle), la non-allégeance au système pénal et carcéral, l’anti-impérialisme.
Dépasser l’égalitarisme
L’idée que l’oppression des femmes résulte d’un défaut d’égalité avec les hommes est un des principaux vecteurs de dépolitisation du féminisme. Non contente de présupposer une égalité des femmes entre elles, elle participe à déterminer les objectifs du mouvement féministe en termes de « rattrapage » des hommes : égalité salariale, parité en politique, égalité face à la charge contraceptive, face au travail domestique, etc. Surtout, elle risque de renforcer la dépendance des femmes à l’égard des hommes, au détriment de leur autonomie : en faisant de la famille nucléaire (hétérosexuelle) le principal horizon de travail reproductif, elle ne permet pas d’imaginer meilleure réponse à la surcharge des femmes qu’une plus grande implication des hommes en son sein.
Cette « solution » ne répond pas aux difficultés des familles monoparentales (majoritairement féminines) ni ne permet d’imaginer d’autres types d’organisation du travail de reproduction (lire ci-contre), en visant notamment un au-delà de la famille nucléaire. Dans la même veine, la recherche d’égalité salariale ne dit rien de l’inégalité fondamentale sur laquelle repose le salariat. Au final, s’il y a bien conscience de la manière dont l’exploitation des femmes dans la sphère professionnelle, publique, détermine leur oppression dans la sphère « privée » du foyer, et vice-versa, les revendications égalitaristes ne s’attaquent à aucune de ces sphères en tant que telles, mais visent simplement à les rendre plus paritaires : les patrons gardent leurs chemises (toujours repassées par celles qui restent les inégales des désormais égales) du moment qu’ils paient les femmes autant (ou aussi mal) que les hommes ; en parallèle, l’hétérosexualité, plutôt que d’être dénoncée comme l’un des piliers structurants du capitalisme patriarcal, est sauvée.
Le travail de reproduction : Dans la pensée marxiste, la reproduction correspond à l’une des trois dimensions de la force de travail, avec les rapports de travail (manières dont est utilisé le travail) et la finalité du travail (productions pour lesquelles le travail est utilisé). Elle décrit le mode et le milieu de vie des travailleurs et leurs façons de satisfaire leurs besoins matériels, professionnels et humains. Ce que n’a pas vu Marx, c’est que cet aspect du travail est largement assumé par des femmes.
Au mieux sera théorisée la possibilité (et pire, la désirabilité) d’une hétérosexualité débarrassée du patriarcat 2 grâce à de nouvelles formes de masculinités, réduisant plus que jamais l’homosexualité à une simple préférence sexuelle possiblement apolitique. Aussi terrifiante que soit déjà cette perspective, elle l’est doublement lorsque l’on envisage ses implications en termes pratiques, ou pour le dire autrement en contexte néolibéral autoritaire : répressifs.
« Toutes les féministes détestent la police », dit le slogan, mais certaines ne demandent qu’à l’aimer, pour peu que des policiers enfin bien formés participent à faire cesser « l’impunité » des agresseurs. On a vu ces dernières années comment la nécessité pour le mouvement féministe d’obtenir des victoires, ne serait-ce que symboliques, se traduisait souvent par des prises très ciblées. Au-delà des questions « pourquoi les hommes agressent les femmes ? », « comment les en empêcher ? », il convient plutôt de se demander « quels hommes ont le pouvoir d’agresser quelles femmes ? », « quels hommes sont effectivement pénalisés ? », « quelles femmes ont la capacité d’être reconnues comme victimes ? » et « qu’est-ce que cette pénalisation apporte aux victimes et plus généralement aux femmes ? ».
Et ce, non pour mettre la lumière sur les hommes au moment où les souffrances endurées par les femmes sont révélées, mais pour éclairer les dynamiques actuelles de reconnaissance/légitimation des statuts de victime et de coupable : plutôt que d’être dupes de la manière dont les approches punitives pourraient être « justes », il s’agit de s’interroger sur les dynamiques du système pénal et carcéral afin de déterminer s’il fait partie du problème ou de la solution.
Traite et prostitution
Dans Pour elles toutes. Femmes contre la prison(Lux, 2019), Gwenola Ricordeau rappelle ainsi que si certains préjudices intéressent davantage le système pénal que d’autres, certains accusés l’intéressent également davantage. Ainsi, les hommes condamnés pour viol en France sont quasi exclusivement issus de milieux populaires. Et si la prise de guerre la plus visible de #MeToo en France fut Tariq Ramadan, c’est que le système pénal ne fait qu’utiliser le prétexte des femmes pour servir les intérêts de la bourgeoisie et du suprémacisme blanc. En d’autres termes, « la race façonne la procédure pénale », de même que la classe, et l’on pourrait ajouter que la procédure pénale les façonne en retour. C’est à ce titre que l’étendard de lutte contre les VSS porté par un si grand consensus, dans la France de 2023, doit nous rendre particulièrement vigilantes.
L’exemple paradigmatique de ce qui, plutôt qu’une convergence entre intérêts racistes et féministes, est bien plutôt une véritable communauté d’intérêts, un « fémonationalisme », est certainement la lutte contre la prostitution, notamment dans sa dimension de lutte contre la traite. Les recherches de Milena Jakšić 3 ont ainsi montré comment, sous couvert de lutte contre ce qui est souvent reconnu comme l’un des paroxysmes des VSS – la traite à des fins de prostitution – il était en réalité bien difficile pour les victimes d’être reconnues comme telles, cette reconnaissance légale allant de pair avec l’obtention d’un titre de séjour.
Au contraire, les intérêts des victimes se retrouvent dissous dans d’autres priorités nationales, parmi lesquelles le contrôle des frontières et la lutte contre l’immigration illégale : le meilleur moyen de protéger les victimes de la traite, c’est encore de les empêcher de venir en France... Alors que la question du travail du sexe fait couler beaucoup d’encre chez les féministes, il est particulièrement regrettable que peu, parmi celles qui se veulent solidaires des travailleuses du sexe, affrontent cette question précise de la traite et du contrôle des frontières, se contentant en général d’affirmer une solidarité abstraite (mais certes consensuelle) avec les victimes.
Contre l’impérialisme
À défaut d’affronter cette question avec la rigueur qu’elle mériterait, elle nous invite au minimum à interroger la fonction de l’État – et notamment d’un État comme la France, c’est-à-dire actif historiquement dans les dynamiques coloniales et impérialistes occidentales – en tant qu’agent producteur de violences à l’échelle mondiale. Ceci nous amène à un troisième principe : la lutte contre les VSS engage une lutte contre l’État-nation, non un soutien à son expansion impérialiste. Une solidarité doit ainsi s’affirmer avec toutes les victimes des États impérialistes, en tant qu’agents d’oppression patriarcale, tant dans les colonies actuelles de France que dans les pays ou régions qui souffrent des politiques impérialistes occidentales, y compris lorsqu’elles se font sous un étendard féministe ou queer friendly.
« Une solidarité doit ainsi s’affirmer avec toutes les victimes des États impérialistes. »
La lutte contre les VSS ne passera pas par l’enrôlement des femmes et des queers dans Tsahal, mais par la libération de la Palestine ; elle implique également de combattre les politiques d’endettement des pays du Sud par le FMI (ainsi que le réclame notamment le mouvement Ni Una Menos en Argentine) ; elle exige un soutien à l’autodétermination politique des colonies françaises actuelles. Ce principe internationaliste, anti-impérialiste, peut sembler lointain à l’heure d’organiser les manifestations locales du 8 mars ou du 25 novembre, mais il permet de donner une véritable portée politique au mouvement féministe, en lui permettant une sortie de ses contradictions internes par le haut. Une solidarité internationaliste s’exprime déjà régulièrement à l’égard des victimes d’États expansionnistes ou autoritaires de blocs antagonistes comme les femmes iraniennes ou kurdes, ou les queers russes. Il doit désormais assumer un autre niveau de conflictualité en se solidarisant des victimes de son propre impérialisme, plutôt qu’en soutenant l’idée d’une diplomatie féministe qui n’a pour fonction que de légitimer l’ingérence des pays impérialistes.
Rappelons en effet que l’utilisation des droits des femmes et des LGBT par les États du centre dans les pays périphériques a lieu dans des contextes de dominations politiques (guerres et occupations par les armées) et économiques (accords de libre-échange). Cet « impérialisme des droits humains » suscite des résistances qui peuvent prendre la forme de politiques réactionnaires, antiféministes et homophobes à l’égard de leurs peuples. La meilleure façon de lutter contre les VSS à l’échelle mondiale est donc de lutter contre la politique impérialiste de son propre État.
Les trois principes défendus ici 4 permettent ainsi de politiser la question des violences sexistes et sexuelles à la fois à l’échelle du foyer, à l’échelle institutionnelle et à l’échelle internationale. Ils portent une distinction nette – comme celle en jeu dans l’opposition entre antiracisme moral et antiracisme politique/décolonial – entre un féminisme moral, partisan d’une approche individualisante (objectif : rendre les hommes gentils), et un féminisme politique, qui s’attaque à la production matérielle de ces violences.
À la différence d’une approche « intersectionnelle » qui se résume bien souvent à viser partout et à ne toucher nulle part, il s’agit d’identifier les principaux nœuds de la domination afin de défaire leur articulation, et de se donner l’autorisation d’imaginer d’autres possibles radicalement différents, en dépassant le simple aménagement « safe » des structures existantes. Au-delà de la lutte contre les violences masculines, la lutte féministe se doit d’être un point d’appui solide contre la violence inhérente au système d’exploitation capitaliste, elle doit être le terrain de la lutte des classes, non de leur apparente réconciliation.
1 La notion de consensus s’entend ici à l’intérieur des forces qui se revendiquent du féminisme, en toute conscience du fait que ce consensus n’en est pas forcément un au-delà.
2 Tendance Mona Chollet, Réinventer l’amour. Comment le patriarcat sabote les relations hétérosexuelles, La Découverte, 2021.
3 Milena Jakšić, La traite des êtres humains en France. De la victime idéale à la victime coupable, CNRS éditions, 2016.
4 La question écologique n’est pas mentionnée explicitement ici, mais il va de soi que tout anti-impérialisme conséquent va de pair avec une position écoféministe.
Soutenez Socialter
Socialter est un média indépendant et engagé qui dépend de ses lecteurs pour continuer à informer, analyser, interroger et à se pencher sur les idées nouvelles qui peinent à émerger dans le débat public. Pour nous soutenir et découvrir nos prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner !
S'abonnerFaire un don