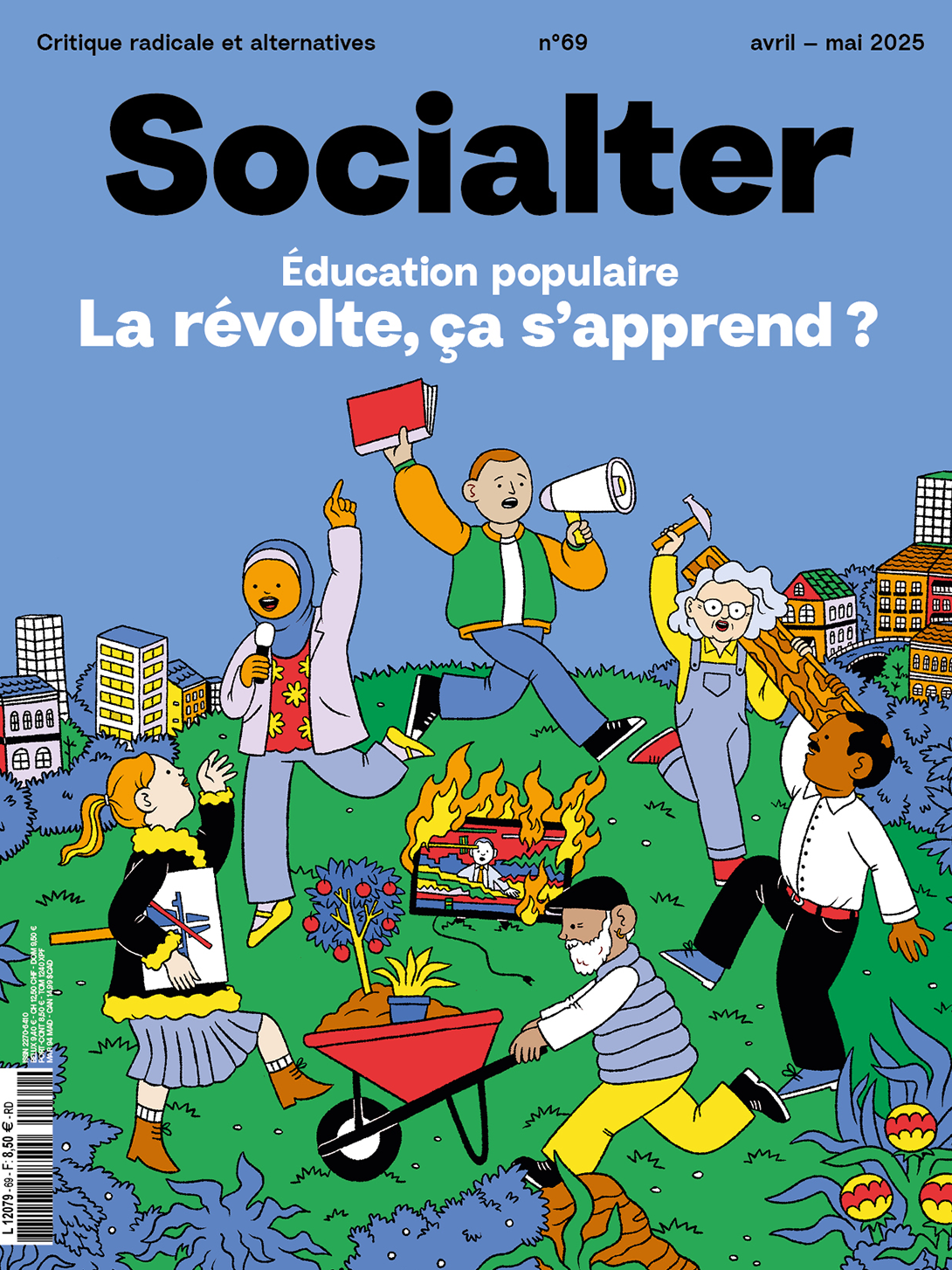Été 1945, Vercors. Tandis que les Alliés libèrent peu à peu la France occupée, un groupe hétéroclite de formateurs plus ou moins autodidactes, issus de toutes les classes sociales – ingénieurs, ouvriers, officiers, artistes, enseignants – tente de donner un sens à ce qui vient de se produire. Ayant pris le maquis pour former les jeunes résistants, après le démantèlement de l’école et de leurs structures d’apprentissage sous Vichy, ils élaborent un texte puissant, conscient des enjeux à venir pour la reconstruction de la France.
Le possible retour du fascisme doit être contré, selon eux, par une nouvelle forme d’éducation populaire, résolument politique. « Nous voulons être des éducateurs, PRODUIRE DE L’ÉDUCATION, comme d’autres produisent du pain, de l’acier ou de l’électricité. (…) La culture populaire ne saurait être qu’une culture commune à tout un peuple : commune aux intellectuels, aux cadres, aux masses. Elle n’est pas à distribuer. Il faut la vivre ensemble pour la créer. » Naît dans ce sillage Peuple et Culture, l’un des plus importants réseaux de l’éducation populaire en France.
Article de notre n°69 « Éducation populaire », disponible en kiosque, sur notre boutique et sur abonnement.
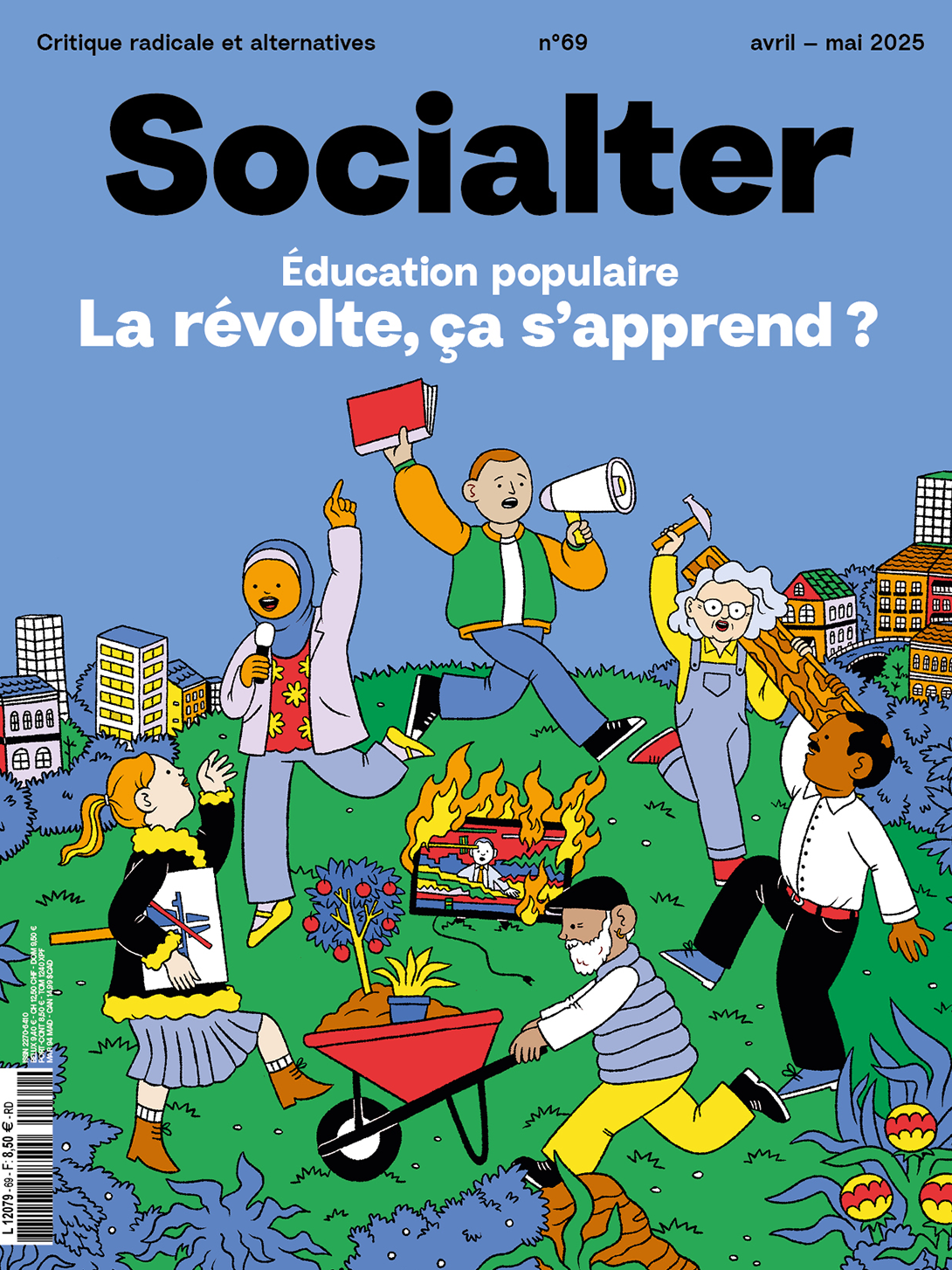
Quatre-vingts ans plus tard, au moment où le mouvement célèbre sa création, les réflexions des fondateurs résonnent avec une troublante actualité : comment déjouer l’emprise des idées réactionnaires sur les esprits ? Comment faire pour que le « droit au savoir (soit) inséparable du droit au bien-être ? » Car, comme l’écrivaient les penseurs de Peuple et Culture en leur temps, « à travers la connaissance, une culture vraie se courbe vers l’action. Elle ne tend pas seulement à interpréter le monde mais à le transformer. »
Quatre-vingts ans plus tard, le terme d’éducation populaire, devenu parfois « ringard », prête à confusion. Il évoque davantage l’animation socioculturelle que le ferment d’idées révolutionnaires.
Pourtant, dans une France où l’extrême droite réalise des scores vertigineux et compte sur des relais médiatiques puissants, des lieux et espaces résistent et tentent malgré tout de former au débat, à la conflictualité et à la pensée critique. Ils encouragent aussi la convergence des luttes sociales et écologiques, sur le temps long. « À bas bruit, ces structures se trouvent au plus proche du quotidien des gens », souligne Guillaume Sabin, ethnologue, militant et praticien de la pédagogie sociale.
Elles opèrent une « dé-formation continue » comme l’affiche la coopérative l’Engrenage, basée à Tours. Cette dernière propose des ateliers portant autant sur les pratiques autogestionnaires que sur l’engagement des jeunes, l’animation de débats, les théories féministes, les stratégies de mobilisation auprès de collectifs d’habitants… Modestes mais puissants leviers d’action, leurs efforts renouent ainsi avec l’histoire éminemment politique des mouvements d’éducation populaire.
« Ce qui manque à l’ouvrier, c’est la science de son malheur »
Le courant ouvrier et révolutionnaire qui s’affirme avec la Commune de Paris en 1871 donne un tour particulièrement anticapitaliste au mouvement. « Ce qui manque à l’ouvrier, c’est la science de son malheur », écrit alors l’anarchiste et syndicaliste Fernand Pelloutier, à l’initiative de la création des Bourses du travail en 1895 – lieux de transmission, d’organisation et de soutien aux luttes ouvrières. D’autres initiatives valorisent à la même époque la pratique de l’horizontalité (le refus d’un savoir surplombant), comme les « causeries populaires » nées durant la Belle Époque.
Ces initiatives popularisées par l’anarchiste individualiste Albert Libertad permettent aux participants, y compris aux femmes, de se retrouver dans des lieux ouverts pour discuter et se former sur des sujets politiques. La formation « hors des cadres institutionnels », qu’il s’agisse de l’école ou de l’usine, devient dès lors une caractéristique importante des pédagogies alternatives. Célestin Freinet (1896-1966) en France, ou le Nobel de littérature Rabindranath Tagore (1861-1941) en Inde, et plus tard Paulo Freire (1921-1997) au Brésil, parmi d’autres, conceptualisent les apprentissages « buissonniers », hors système, avec l’objectif de faire réfléchir les élèves aux rapports de domination qui les entourent.
Tagore, poète et philosophe engagé – qui avait été scolarisé au Royaume-Uni – avait ainsi réfléchi dès 1892 à un système éducatif pour « décoloniser » l’esprit des jeunes Indiens, alors sujets britanniques. En 1901, il crée sa propre école-ashram « sans murs », Santiniketan, qui donnera son nom au lieu et se développera ensuite en université. Les enseignements se font souvent à l’ombre de manguiers ou de banians, et, à l’époque comme aujourd’hui, accordent une place importante à l’écologie. Fondée sur la pratique artistique, la solidarité, la gratuité, on y enseigne aussi le cosmopolitisme (les professeurs sont issus de communautés et religions différentes, fait rare alors) et la philosophie.
Ce type de pédagogies, encourageant l’esprit critique et la prise de conscience des oppressions, fleurit tout au long du XXe siècle et circule dans le monde. En France, l’Éducation nouvelle, méthodologie imaginée par Célestin Freinet dans les années 1920, fondée sur la libre expression, la responsabilisation de chacun et la coopération, se développe.
Tournant récréatif
Mais au fil du temps, l’éducation populaire, qui se décline sous différents courants (républicain, ouvrier, confessionnel) est rattrapée par une forme d’institutionnalisation. Alexia Morvan, ancienne membre de la Scop d’éducation populaire Le Pavé, aujourd’hui conseillère d’éducation populaire et jeunesse au service départemental Jeunesse engagement sports d’Ille-et-Vilaine, a retracé les étapes de la dépolitisation de ce champ dans sa thèse1. C’est le Front populaire qui, en 1936, fait basculer le mouvement dans la « démocratisation des loisirs et de la culture ».
Puis, l’agrément « Éducation populaire » voit le jour sous Vichy, qui en profite pour imposer un tour viriliste et patriote au secteur associatif. À la Libération, en 1944, le projet d’ordonnance de Jean Guéhenno, qui voulait faire la promotion d’une formation critique des citoyens, est écarté au profit d’une action publique ciblée sur la jeunesse via les pratiques sportives. Cet échec entérine le succès d’une conception récréative de l’Éducation populaire.
À partir des années 1960, « l’État reproche aux associations d’être trop idéologiques et pas assez techniques » et les charge de « la planification d’équipements socioculturels (avec la charge de locaux) dans le cadre d’une vaste politique d’animation mais surtout de pacification de la vie sociale » des quartiers populaires, précise la chercheuse. Cette nouvelle contrainte alourdit les structures qui doivent devenir « rentables » pour survivre, et multiplier les activités.
La notion se « ringardise », l’État prend en charge la formation des éducateurs : « Il devient de plus en plus difficile d’exercer un regard critique. » La question des financements publics continue de peser avec le développement des politiques de contrats et d’appels d’offres tout au long des années 1970 et 1980. « L’action est découpée par dispositifs en fonction de symptômes à traiter et ciblée territorialement (avec des indices de délinquance pour les quartiers populaires) contre la vision globale, intégrale, de l’éducation populaire », écrit Alexia Morvan.
« L’institutionnalisation de l’éducation populaire s’est faite contre sa puissance critique », poursuit-elle. Durant les années 1998-2001, des travaux engagés sur l’avenir de l’éducation populaire avec la ministre communiste de la jeunesse et des sports, Marie-Georges Buffet, aboutiront à des projets pour repenser ce champ autour des questions de citoyenneté et de démocratie politique, mais resteront sans lendemain. Cette période sera marquée par un renouveau des pratiques de la part d’acteurs engagés dont feront partie les membres de la coopérative Le Pavé, créée en 2007, et qui fera des émules avant et après son autodissolution en 20142.
Alliance du rouge et du vert
Ces acteurs ont renoué avec le « projet profondément républicain de l’éducation populaire, mais cette fois au sens de la République sociale. Ils ont fait le constat que si les citoyens ne peuvent se représenter la société dans laquelle ils vivent, c’est un danger pour la démocratie. De même, le conflit social étant au cœur du projet démocratique, il faut pouvoir s’y confronter de façon pacifique. Ce qui explique qu’ils puisent dans les traditions de l’éducation “conscientisante” (issue des théories de Paulo Freire, NDLR) et de la “formation par l’action” », explique le chercheur Nicolas Brusadelli.
D’autres acteurs vont participer de ce mouvement et contribuer à remettre en avant l’éducation populaire politique dans la sphère publique. « Attac, par exemple, était dans une posture proche de celle-ci, ce qui a permis à certains secteurs du mouvement social de s’emparer des sujets économiques critiques, et d’associer des militants altermondialistes et écolos. L’éduc’ pop politique a participé de la réussite de cette alliance du rouge et du vert », note le sociologue qui a travaillé sur les sociabilités militantes, notamment chez Alternatiba et Attac.
Il souligne cependant les limites du mouvement, mis au défi de sa sociologie – souvent composée de personnes issues des classes moyennes disposant d’un fort capital intellectuel – et de l’échec des coopératives d’éducation populaire à construire une organisation nationale et durable.
Depuis les années 2010, la diffusion de savoirs sur la crise climatique, l’émergence progressive de mouvements d’écologie radicale, avec des lieux ou collectifs emblématiques, tels que les ZAD, XR, et plus récemment les Soulèvements de la Terre, mais aussi le mouvement des Gilets jaunes, ont permis de mettre en lumière les injustices sociales et environnementales. La multiplicité des appels à « bifurquer », à « dévier » du système dominant, ont requis de nouveaux besoins et lieux de formation. Pour la philosophe Irène Pereira, « cette tendance, encore émergente, s’est faite plus visible, ce qui a repolitisé l’écologie dans le monde associatif, dans le sillage des mouvements antiracistes et féministes ».
« Comment on s’organise contre un système qui détruit la planète »
Selon Wim de Lamotte, de la Turbine à Graines, association d’éducation populaire créée en 2014 dans la Drôme, « l’enjeu est de savoir comment on s’organise contre un système qui détruit la planète. Prendre soin de nos stratégies, sortir du militantisme rigide y participe aussi. » Les formations proposées, en extérieur, s’adressent particulièrement aux collectifs militants qui souhaitent par exemple appréhender les situations de conflits, l’épuisement militant ou entretenir un rapport plus horizontal au savoir.
Dans un autre registre, à Brest, l’ethnologue et ancien pédagogue de rue Guillaume Sabin a troqué sa casquette de maître de conf’ pour celle de « magasinier-valoriste » à la Réserve des matériaux. Dans cette recyclerie dédiée au BTP, autofinancée, il alterne entre travail manuel et sensibilisation aux problématiques sociales et écologiques par le réemploi, auprès des particuliers qui affluent depuis bientôt deux ans. Et la « joie du dehors » que promeut l’ex-chercheur, auteur d’un livre éponyme sur la pédagogie sociale3, s’exprime lorsque les employés, venus récupérer du matériel sur des chantiers ou maisons en rénovation, se retrouvent à échanger avec les habitants. « L’usage et l’occupation de l’espace public comme un lieu d’expérimentation politique est particulièrement important au vu du contexte actuel », rappelle Alexia Morvan.
Les collectifs Terre de Liens, Accueil Paysan ou Reprise des Savoirs vont également dans ce sens en menant des chantiers participatifs (qui se déroulent parfois sur des lieux de lutte) alliant savoirs froids scientifiques, savoirs chauds (expériences personnelles) et savoirs manuels. Pour Baptiste Lanaspeze et Marin Schaffner, auteurs de Mais qui enseigne l’écologie ? (Wildproject, 2025), qui plaident pour des universités écologiques plurielles et non institutionnelles, l’éducation à l’écologie politique se fait principalement ainsi en « reliant la main et la tête », par le truchement « d’expériences de vie et [par] les cultures collectives (familiales, amicales, associatives, militantes) [qui] restent les ferments les plus solides pour apprendre à vivre de façon écologique », assurent-ils.
À rebours des éco-gestes individuels et de la « consommation responsable », « l’éducation populaire peut prétendre à contribuer à une autre écologie (...) [elle] défend une approche collective, basée sur le partage des responsabilités à la fois à un niveau local mais également à un niveau politique, volontairement tournée vers la critique sociale », défend Mathieu Depoil, chercheur et directeur de la Maison-Phare4. L’association, ancrée dans un quartier prioritaire de Dijon, accueille adultes comme enfants lors de différents ateliers, du maraîchage à la critique des médias, en passant par l’initiation aux théories féministes. Une vision de l’éducation par le « milieu », au sens de l’environnement immédiat des personnes concernées, qui contribue à bâtir une écologie véritablement populaire.
Reste que ce type de démarche ouvertement politique est rarement assumée par les acteurs de l’éduc’ pop. C’est en partie pour la protéger, dans un contexte de menace sur les libertés associatives, que des organisations associatives et syndicales travaillent actuellement sur un projet de loi-cadre sur l’éducation populaire. Sur le modèle belge, il s’agirait d’instaurer un statut spécifique qui acte la dimension « critique et démocratique » de ce champ associatif, « dans une perspective d’émancipation individuelle et collective des publics en privilégiant la participation active des publics visés et l’expression culturelle5 ». Une façon de préserver l’héritage politique d’un mouvement fécond et pluriel.
1.Pour une éducation populaire politique : à partir d’une recherche-action en Bretagne, Alexia Morvan, 2011.
2. Le Pavé, définie comme coopérative d’éducation populaire politique, comptait notamment parmi ses membres fondateurs Alexia Morvan et le militant et homme de théâtre Franck Lepage, à l’initiative des conférences gesticulées. Ce dernier théorise également les notions de savoirs froids (scientifiques, objectifs) et chauds (récits intimes) à mobiliser dans les formations.
3. Théorie éducative qui part du vécu de l’individu et de son environnement, afin de soutenir des initiatives sociales pour transformer concrètement les conditions d’existence des personnes.
4. « Éducation populaire et écologie sociale : vers une (re)politisation des pratiques pédagogiques ? », Mathieu Depoil, La Rage du social, 3 juin 2024.
5. Décret relatif au développement de l’action d’Éducation permanente dans le champ de la vie associative, 17 juillet 2003, Fédération Wallonie-Bruxelles.
Soutenez Socialter
Socialter est un média indépendant et engagé qui dépend de ses lecteurs pour continuer à informer, analyser, interroger et à se pencher sur les idées nouvelles qui peinent à émerger dans le débat public. Pour nous soutenir et découvrir nos prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner !
S'abonnerFaire un don