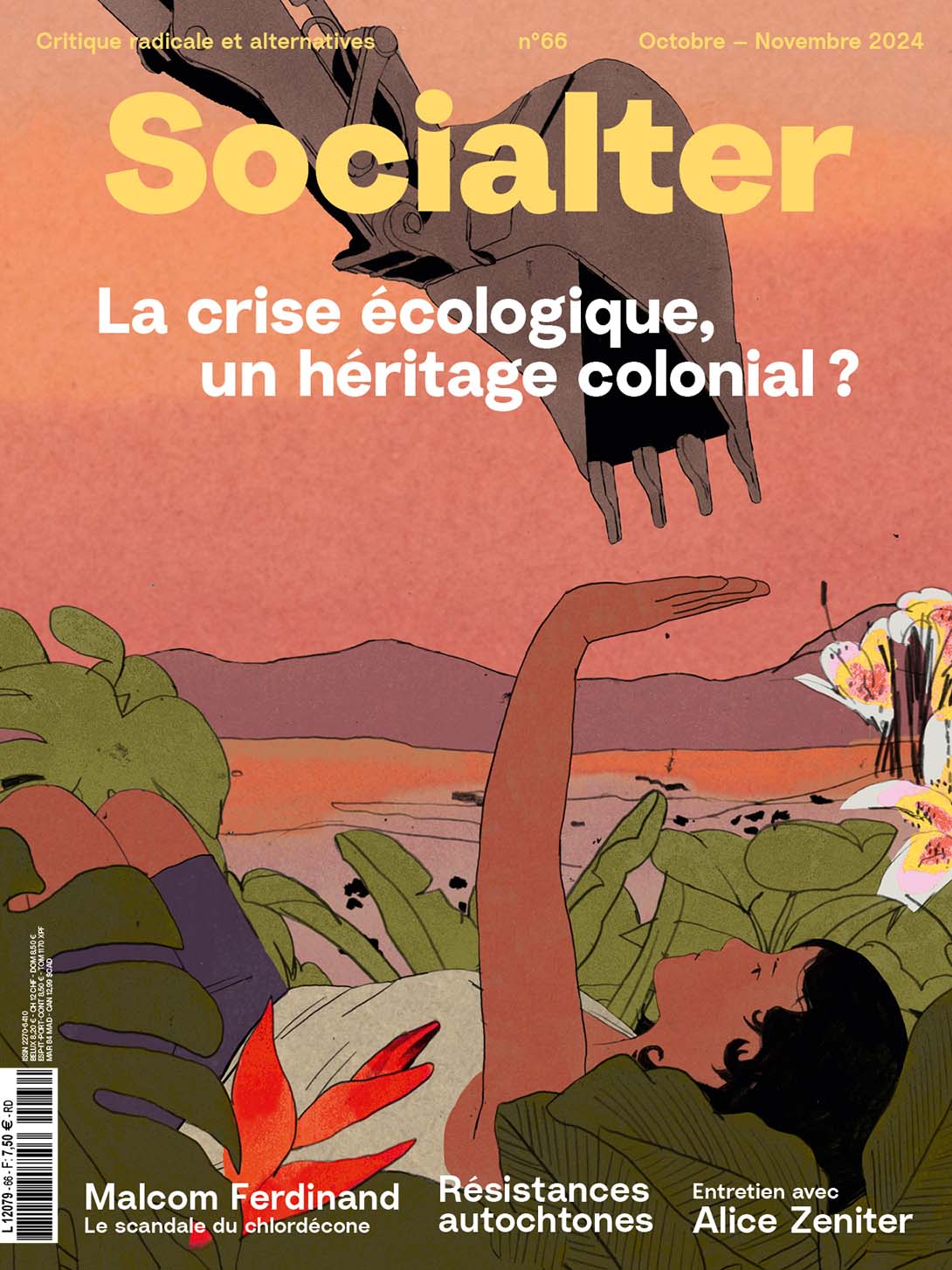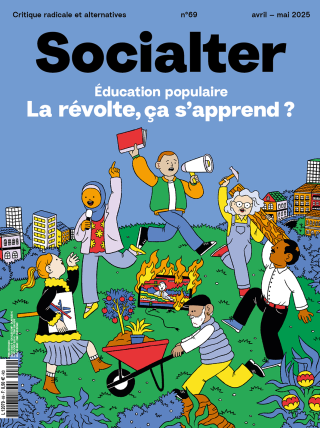Perché sur une butte, Marc-Antoine Forconi contemple les 1 140 hectares de parcelles, landes, forêts et falaises qui, sous ses yeux, constituent le Groupement Agricole d’Exploitation en Commun de Montlahuc (GAEC). Dans le Diois drômois, cette ex-monoculture ovine a été reprise en 2012 par des jeunes agriculteurs, dont Marc-Antoine, pour y développer un modèle permacole. Brebis, chèvres, vaches et chevaux évoluent dans ce décor de montagne sèche, où les précipitations seront divisées par deux d’ici à 2050.
Article issu de notre n°66, en librairie et à la commande.
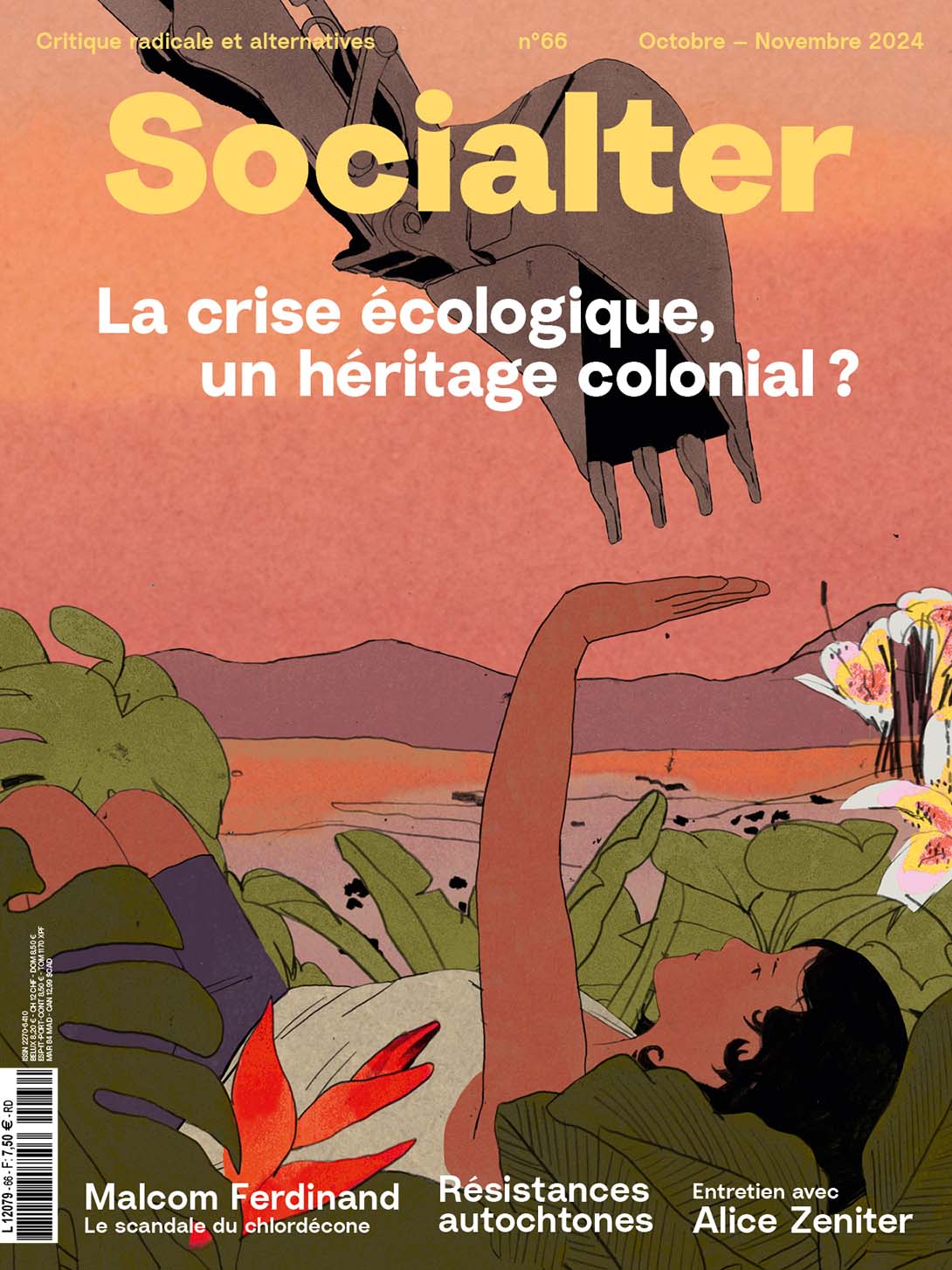
Pour affronter un manque d’eau qui se fait déjà sentir, les six associés, dont toute la démarche vise à « s’intégrer à l’écosystème plutôt que d’essayer de le plier à nos besoins », ont notamment mis en œuvre les principes de « l’hydrologie régénérative ». Cette discipline émergente, dont le nom a été proposé par Simon Ricard, ex-ingénieur converti à l’agroécologie, reprend et généralise les principes du Keyline design, lecture du paysage théorisée dans les années 1950 par l’agriculteur australien Percival Alfred Yeomans, pour « aménager le territoire en fonction du relief de façon à ce que l’eau reste là où elle tombe », explique Simon Ricard.

Promue par une génération d’hydrologues, de paysans et d’ingénieurs, cette approche fondée sur la nature qui revisite des techniques anciennes mais délaissées repose sur l’idée que la gestion de l’eau s’est jusqu’ici concentrée sur « les conséquences plus que les causes, en gérant les flux en aval et non en amont ». Et que ces solutions focalisées sur l’adaptation, voire la maladaptation, si elles demeurent utiles pour certaines, seront insuffisantes.
Comprendre l’approche implique de « réaliser combien l’activité humaine a altéré le cycle de l’eau », juge l’hydrologue Charlène Descollonges, qui a cofondé avec Simon Ricard l’association Pour une hydrologie régénérative (PUHR). « En canalisant l’eau par des pratiques comme l’agriculture intensive, l’artificialisation des sols, la destruction des zones humides, nous avons accéléré son cycle : les sols, comme du béton, ne savent plus retenir l’eau, qui ruisselle très vite jusqu’aux rivières et la mer. »Ces altérations ont mené au dépassement des limites planétaires de l’eau bleue – des rivières et des nappes – mais aussi de l’eau verte, moins connue, stockée dans le sol et la biomasse. Or « le changement climatique vient accentuer ces effets, engendrant sécheresses et inondations plus intenses et plus fréquentes. »
« Les agriculteurs sont prêts à se lancer quand ils voient des lieux où ça marche »
Dès lors, la logique de l’hydrologie régénérative est de jouer de façon complémentaire « sur le triptyque eau, arbre et sol », explique Simon Ricard. « Ralentir l’eau pour l’infiltrer par de micro-aménagements fondés sur la nature ; régénérer le sol pour qu’il recouvre sa capacité d’infiltration ; planter arbres et haies, pour redensifier les paysages et recréer des corridors écologiques favorisant l’évapotranspiration et tempérant les manques mais aussi l’excès d’eau. »Une vision qui implique de repenser l’aménagement à l’échelle de chaque bassin versant, à partir de sa topographie.
Baissières, mares et mycorhizes
À Montlahuc, Marc-Antoine désigne du doigt le versant d’en face : « Vous voyez ces lignes droites d’arbres qui traversent à l’horizontale les parcelles ? Ce sont des baissières. »Ouvrage clé de l’hydrologie régénérative, ces petits fossés placés sur la courbe de niveau cassent la pente pour récupérer l’eau qui, ne pouvant ni continuer son chemin ni ruisseler à droite ou à gauche, s’infiltre dans le sol. Au bord, sur un talus, « des haies d’arbres captent les eaux et bloquent le vent qui sinon emporte l’évapotranspiration. Leurs racines vont continuer à infiltrer l’eau même quand le fossé se rebouchera, ce qui permet la durabilité de l’ouvrage sans l’entretien. » Les paysans entendent ainsi « multiplier les usages de l’eau, utilisée quatre fois avant de poursuivre sa course ».

Sur le bassin versant voisin, « on a travaillé sur l’eau qu’on ne voit pas en favorisant les microcycles de l’eau », poursuit-il. Par exemple, « la moitié de nos haies sont des végétaux de sous-bois (lierre, buis…) qui captent l’humidité dans l’air chaud et échangent cette eau contre du glucose aux arbres voisins : le buis restitue 2 à 4 millimètres d’eau par jour à l’arbre voisin ! » Ce microcycle est permis par les mycorhizes. « Toile internet de la nature », ces champignons formés sur le bois mort y créent une pellicule d’eau qu’ils diffusent : pour favoriser ces mycorhizes, les haies sont paillées avec du bois déchiqueté et des arbres sont trognés pour restituer une partie de leurs racines à la décomposition dans le sol.
Marc-Antoine marque une pause. « Mais tout ça, on l’a fait à l’envers, sourit-il avec malice. On aurait dû commencer d’en haut, en s’occupant des forêts sans qui il n’y aurait plus d’eau à retenir. »Désormais, ils « travaillent à accélérer la transformation de ces forêts de pins gourmandes en eau et fragilisées par le changement climatique en forêts de feuillus, en y disséminant des fruits sauvages ». Bientôt, des mares participeront à former des corridors écologiques entre le bas de l’exploitation, où le retour du castor a recréé une niche écologique, et les forêts en haut.« Afin que les animaux disséminent eux-mêmes : les solutions inspirées par la nature, c’est bien, l’idéal est de la faire travailler à notre place ! »
Approche holistique
Dans l’arrière-pays boulonnais, c’est moins la sécheresse que les inondations qui guettent dans l’immédiat Jérôme et Audrey Valcke-Sergent, fondateurs de l’écolieu De Rives en rêves. Là aussi, ils misent sur l’hydrologie régénérative, intégrée dès leur installation à la conception de leurs parcelles, afin d’atténuer les risques de ruissellement, que les monocultures environnantes aggravent, selon Jérôme. Baissières, haies et mares créées sur son terrain ne l’ont pas épargné des dégâts des inondations qui ont sinistré l’hiver dernier quelque 6 500 foyers dans le Pas-de-Calais. Mais il constate que l’eau, grâce à ces aménagements dédiés à « récupérer l’eau de pluie de toiture ou de précipitation lors de gros orages, s’est bien davantage infiltrée que sur les parcelles des voisins ».
Il le sait bien, l’impact de sa seule action reste limité. Or, adopter de telles pratiques n’est pas évident pour des agriculteurs« à qui on dit depuis des décennies d’enlever des arbres pour mécaniser et évacuer l’eau », rappelle Simon Ricard qui forme à l’hydrologie régénérative avec le bureau d’études Permalab. Il s’agit de changer les itinéraires techniques, repenser son parcellaire et renoncer à de la surface… « À court terme, cela peut créer une concurrence déloyale avec le voisin qui ne change rien. » Jérôme, qui tente de sensibiliser autour de lui, est persuadé que « le calcul est gagnant à terme, au vu des coûts croissants liés aux inondations, qui font grimper les primes d’assurance ». En outre, « le temps de travail en plus, on le gagne ailleurs », assure Marc-Antoine, qui plaide pour « multiplier les espaces tests et leur suivi par la recherche »car « les agriculteurs sont prêts à se lancer quand ils voient des lieux où ça marche ». « On nous prenait pour des hippies, aujourd’hui l’exploitation tourne, on se paye… ça interpelle. »

Une transition qui doit « être accompagnée par les collectivités », poursuit Simon Ricard, et être abordée, pour avoir un réel impact, de façon cohérente à l’échelle des bassins : des zones humides à recréer aux villes à désimperméabiliser, en passant par les zones boisées à reconnecter, les parcellaires et pratiques agricoles à faire évoluer et les chemins de l’eau naturels et artificiels à restaurer pour leur rendre méandres et continuité écologique.
Dans le Rhône, l’association Sauvegarde de la vallée vivante du Garon tente de faire valoir cette approche pour combattre la construction prochaine de trois barrages écrêteurs censés répondre au risque de crue centennale : les jugeant inadaptés et dangereux, elle propose un projet alternatif fondé sur le cumul de solutions pour réinfiltrer l’eau. « On a dépassé nos capacités de contrainte de la nature, il vaut mieux lisser le risque en accompagnant les éléments » estime l’une de ses membres, Valérie Valette.« Le réflexe est d’évacuer l’eau, mais c’est pire : les flux se rassemblent et s’accélèrent », abonde Michal Kravcik,hydrologue slovaque et Prix Goldman 1999. C’est du programme qu’il a mené dans son pays que l’association s’inspire : en 2010, à la suite d’inondations dévastatrices, il est sollicité par le gouvernement slovaque. Dans 488 communes,« nous avons regardé où l’eau avait fait le plus de dégâts pour placer, du haut vers le bas, 100 000 petits ouvrages de rétention d’eau de pluie ».
L’association se heurte pourtant à un mur des pouvoirs publics. Car ces solutions méconnues « vont à l’encontre de la réponse rapide et efficace de court terme et demandent de la concertation » souligne Simon Ricard. Si les structures existent pour décloisonner l’action sur l’eau – les schémas d’aménagement et de gestion de l’eau – elles ne sont pas généralisées en France et restent « peu infusées de l’idée que l’eau est, plus qu’un gâteau à se partager, une ressource à cultiver et à régénérer ».
Signe que les lignes bougent, des collectivités s’ouvrent au sujet : l’agglomération Valence-Romans est accompagnée par l’association PUHR dans un projet lancé sur trois communes, pour répondre « à des problèmes de ruissellement et perte de sols agricoles, inondations et manque d’eau potable », raconte Romain Chevalier, du service gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations. « Ce sont des solutions qu’en tant que technicien on a entendues, parfois utilisées, mais là il y a une conception globale sur tout le bassin versant, avec une cinquantaine d’exploitants impliqués. »La généralisation de cette approche implique, pour Charlène Descollonges, d’acculturer les différents acteurs sur le sujet et de changer les règles de la gouvernance de l’eau, pour mieux y associer les citoyens.
Soutenez Socialter
Socialter est un média indépendant et engagé qui dépend de ses lecteurs pour continuer à informer, analyser, interroger et à se pencher sur les idées nouvelles qui peinent à émerger dans le débat public. Pour nous soutenir et découvrir nos prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner !
S'abonnerFaire un don