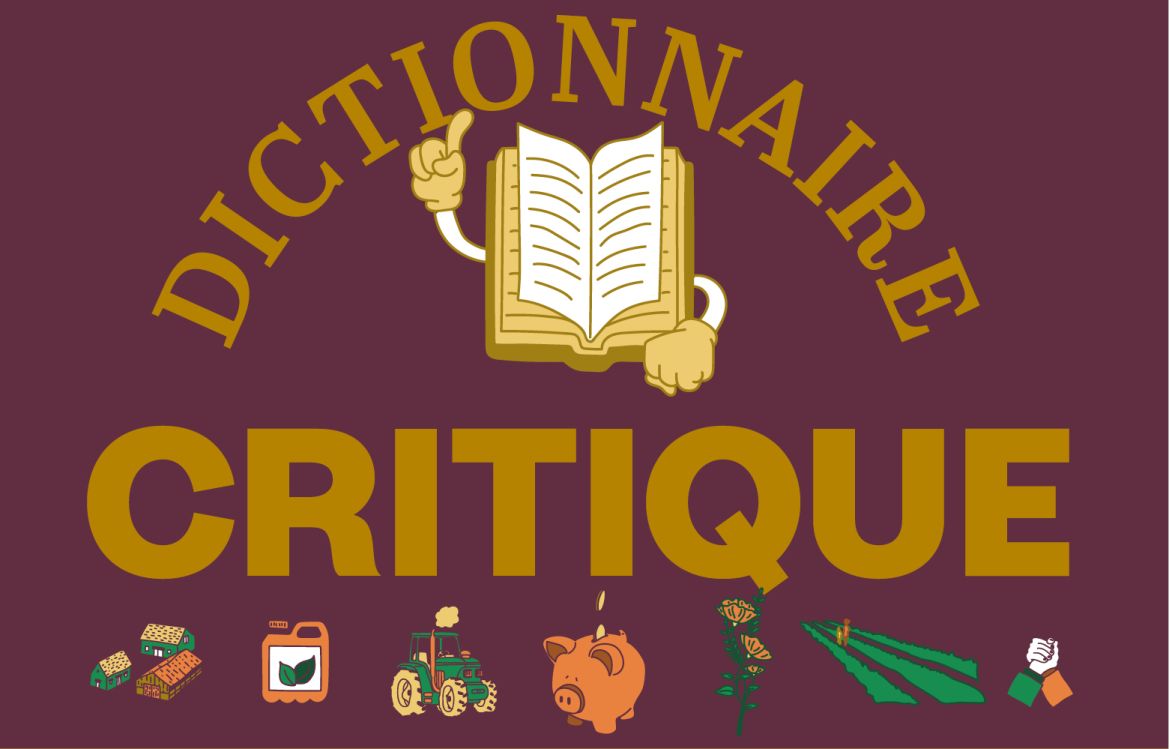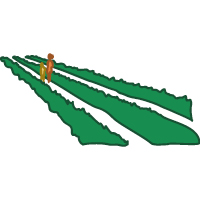Exploitation agricole 
Qu’elle soit familiale ou à taille humaine, individuelle ou collective, l’exploitation agricole reste la formule consacrée, y compris dans le code rural, pour parler des lieux qui nous nourrissent. Un terme qui suinte toute la conception qu’ont les institutions de l’activité agricole. Aucun doute que cet imaginaire trouve une filiation avec les secteurs extractivistes, qu’il s’agisse de minerais, d’hydrocarbures, ou autres cultures dites de rente telles les plantations de canne à sucre : le sol et la terre ne sont plus que des gisements dont il conviendrait d’extraire un maximum de valeur. L’agriculteur, lui, n’est plus un paysan, mais un simple exploitant. La complexité inhérente à ce métier si particulier, qui négocie de manière permanente des agencements avec le monde vivant, s’en trouve réduite à un rapport de domination de l’homme sur son milieu.
Dictionnaire à retrouver dans notre hors-série « Ces terres qui se défendent », en kiosque, librairie et sur notre boutique.

Pour se défaire de ces termes enfermants, les tenants des agricultures alternatives privilégient l’emploi du mot « paysan », étymologiquement « celui qui vit au pays ». N’est-ce pas là un terme plus riche de sens que le réductionnisme économiciste dont nous écrase l’idée de l’« exploitant » ? Le paysan est non seulement celui qui vit au pays, mais aussi l’un de ses acteurs centraux en façonnant et entretenant les trames de nos paysages. Le pays mentionné doit alors être compris dans une acception bien plus large que l’État-nation à laquelle on l’associe pourtant souvent. Il y a en réalité autant de pays que de paysages dans notre territoire national. Si l’exploitation agricole s’intègre dans une filière et rend des comptes à la machine capitaliste, paysans et paysannes sont eux enchâssés dans les tissus qui constituent toute l’épaisseur de nos territoires. Ce n’est pas un hasard si le mouvement, qui réunit les personnes qui travaillent la terre, a choisi pour slogan depuis les années 1970 : « Pas de pays sans paysans » !
Coopérative 
Statut juridique de l’économie sociale et solidaire, la coopérative repose sur le principe initial « une personne = une voix », qui permet de distribuer de manière plus égalitaire le pouvoir dans une entreprisequ’en fonction du seul montant de l’investissement financier. Vertueuses, donc, les coopératives agricoles ? Le monde des coopératives recouvre en fait des réalités très diverses. Certaines sont même un maillon essentiel du complexe agro-industriel en étant au cœur de la mise en œuvre de l’intégration des filières. Elles organisent alors l’ensemble des étapes de production de nos denrées, de la semence enrobée de pesticides jusqu’à la transformation et la distribution de nos aliments. Elles définissent les prix d’achat des productions agricoles autant que le choix et le prix des intrants nécessaires pour les faire pousser ; réduisant à peau de chagrin le domaine des choix dévolus aux agriculteurs. Si, en principe, les coopératives restent entre les mains de leurs sociétaires exploitants agricoles, la pratique montre qu’elles se sont transformées par le jeu de fusions-acquisitions en mastodontes transnationaux se déclinant en une myriade de filiales.
Mais le réflexe coopératif reste ancré dans le monde paysan et de nombreuses autres initiatives ont réussi à ne pas se prendre les pieds dans le marché. Ce peut être le cas des Cuma (coopératives d’utilisation de machines agricoles) qui permettent de s’associer à plusieurs pour réduire les coûts d’achat d’une machine, mais aussi de réfléchir collectivement et entre pairs aux matériels nécessaires. Dernière incarnation possible dans le monde agricole des coopératives : l’installation paysanne collective. De plus en plus de collectifs choisissent en effet ce statut pourtant peu reconnu par l’administration pour cet usage. Les collectifs restent malheureusement exclus des aides à l’installation, pourtant cruciales pour l’équilibre économique des fermes à ce moment-clé. Mais c’est aussi un choix politique fort qui permet, par la socialisation des moyens de production, de dispenser d’un investissement massif les futures générations d’agriculteurs au moment de leur installation. Un autre mouvement coopératif est possible !
Modernisation agricole 
Tout ce qui s’oppose à l’archaïsme est bon, c’est bien connu ! La modernisation agricole a débuté avec le XXe siècle et l’arrivée des tracteurs et moissonneuses-batteuses, réduisant la place et la pénibilité du travail animal et humain dans les champs. Mais, comme le souligne l’historien Christophe Bonneuil, la modernisation trouve plus particulièrement son origine lors de la Seconde Guerre mondiale avec l’importation de la conception agricole nazie par le régime de Vichy, se traduisant notamment par la promotion d’un usage massif de produits chimiques comme engrais ou biocides pour lutter contre champignons, ravageurs ou maladies. Un modèle dévastateur pour les sols, les milieux agricoles, exterminant ses multiples habitants. Le pendant foncier de cette modernisation prend corps dans plusieurs lois quelques années plus tard menant à la création des Safer (lire notre article p. 43), qui régulent les marchés fonciers et permettent aussi un rééquilibrage des rapports de force entre fermiers et propriétaires.
Mais dans le même temps, une vaste entreprise de fusion des parcelles agricoles est menée (le remembrement) à des fins productivistes, entraînant la disparition progressive des haies, prairies et bocages et laissant leurs habitants sans niche écologique. Toutes ces actions se traduisent par la baisse drastique de la population agricole alors que les rendements explosent. Les tickets de rationnement s’éloignent et très vite les premières crises de surproduction surviennent, poussant la « ferme France » à trouver de nouveaux débouchés internationaux pour ces denrées en trop, et déstabilisant les économies de nombres de pays en développement. Uniformisation des paysages, appauvrissement des sols, désertification des campagnes… autant d’effets qui nous incitent à questionner cette « modernisation » : quels sont les prix à payer pour que nos estomacs soient rassasiés ?
Agriculture raisonnée 
D’après le décret 2002-631 du 25 avril 2002, « les modes de production raisonnés en agriculture consistent en la mise en œuvre, par l’exploitant agricole [...], de moyens techniques et de pratiques agricoles conformes aux exigences du référentiel de l’agriculture raisonnée ». Un peu tautologique, n’est-ce pas ? Quelles sont donc ces exigences qui valent à des pratiques d’être raisonnées ? Grosso modo : réduire autant que possible les externalités négatives d’une exploitation industrielle, que ce soit en termes d’intrants injectés dans le sol ou de pollutions, de bien-être animal, etc. Belle illustration de l’adage « le mieux est l’ennemi du bien ». À vouloir créer un espace entre le pire de
l’agro-industrie et les contraintes de l’agroécologie, on détourne l’attention et l’effort d’une authentique politique de reconversion du modèle agricole. Mais n’est-ce pas le but ? Après tout, l’agriculture raisonnée est le fruit de la promotion du Forum des agriculteurs responsables respectueux de l’environnement (Farre) porté essentiellement par les représentants de l’agriculture intensive, parmi lesquels on retrouve la FNSEA ou des industriels de l’agrochimie tels que Monsanto, BASF, DuPont ou l’Union des industries de la fertilisation. L’intérêt de l’agriculture raisonnée, en plus de se présenter implicitement comme « raisonnable », est de devenir une machine à labels dont l’utilité première est de brouiller les repères de consommateurs déjà perdus dans le labyrinthe des certifications.
Services environnementaux 
Les paiements pour services environnementaux (PSE) en agriculture entendent rémunérer les pratiques vertueuses de certains agriculteurs, c’est-à-dire des actions qui contribuent à restaurer ou maintenir des écosystèmes environnant les cultures, et dont la société tirerait indirectement des bénéfices. Par exemple : préserver la qualité de l’eau, améliorer le stockage de carbone des sols, protéger le paysage et la biodiversité… Les services environnementaux seraient le pendant des services écosystémiques : les services rendus aux sociétés humaines par la nature. La logique est fort simple, et pour certains séduisante : la nature nous rend des services que l’on peut évaluer économiquement, donc on rémunère les agriculteurs (ou les collectivités) qui maintiennent ces services ou les accroissent. De là, on peut y voir un moyen incitatif doublé d’un complément de revenu pour de petits agriculteurs.
Mais là encore, il s’agit de faire passer des pratiques agroécologiques sous l’égide du marché. L’intérêt de mener ce type de pratiques agricoles vertueuses dépend de l’incitation financière à le faire. Le prix attaché à la pratique vertueuse dépend de l’évaluation du service rendu par la nature que l’on protège (mais comment évaluer l’inestimable ?), et la pratique vertueuse peut aisément devenir une marchandise elle-même, alors aisément intégrable dans des mécanismes de compensation et dans le marché carbone (ce qui reviendrait à accorder aux agro-industriels un droit d’acheter des « permis de détruire » les écosystèmes sous couvert de financement des pratiques bénéfiques par ailleurs). Les PSE font alors surtout obstacle à toute mesure plus coercitive ou interventionniste en évitant l’encadrement et l’interdiction des pratiques agricoles nocives, ou l’incitation à l’installation paysanne et la conversion à l’agroécologie.
Compensation écologique 
Le grand public est de plus en plus familier avec la notion de « compensation carbone », qui se traduit généralement par des mécanismes de plantation d’arbres dans un endroit vaguement connu. La compensation écologique, elle, désigne plus largement des projets d’ingénierie écologique (création de forêts, déplacements d’espèces, etc.) qui viennent créer ou modifier des écosystèmes précis pour compenser la destruction d’un écosystème similaire ailleurs. Autrement dit : si l’on détruit une zone humide ici, il faudrait pouvoir la recréer là-bas. Présentée en France comme un ultime recours depuis la loi relative à la protection de la nature de 1976 (peu applicable), la compensation a été précisée par la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages de 2016, plus claire sur ses modalités mais réaffirmant son caractère de solution de dernier recours après que tout a été mis en œuvre pour que les effets destructeurs d’un projet soient évités, et si cela n’est pas possible, réduits au maximum.
Pourquoi pas ? Sauf que, dans les faits, les marges d’interprétation étant très larges, la compensation écologique a rarement les traits d’un dernier recours, mais tend dangereusement vers la solution privilégiée et expéditive. Pour certains acteurs, quitte à payer, autant ne pas s’embarrasser et tout raser pour ensuite financer un quelconque mécanisme de compensation. Au niveau international, on voit même se « créer un marché de la prise en charge de la dégradation de la biodiversité, à travers la privatisation d’espaces acquis pour satisfaire des obligations légales de compensation des dégradations réalisées sur des milieux pouvant être éloignés de la biodiversité et des milieux impactés », pointe le chercheur en science politique Rémy Petitimbert. Car la compensation a juste à être « équivalente », pas « identique », laissant là encore de grandes marges d’interprétation sur les modalités de restauration, l’importance de la biodiversité concernée, etc. La compensation écologique permet finalement « de hiérarchiser le vivant, du fait de son utilité pour les sociétés humaines, et contribue à justifier ainsi la disparition de la biodiversité jugée la moins utile. »
Métropolisation 
Où que vous habitiez en France, vous connaissez forcément une grande ville voisine qui s’est récemment vu adjoindre le qualificatif de métropole. Le terme trouve son origine dans le grec ancien mêtrópolis (cité mère). On en dénombre aujourd’hui officiellement 22 sur le territoire français, toutes situées au cœur d’aires urbaines d’au moins 400 000 habitants. La métropole est surtout devenue centrale dans la conception de l’aménagement du territoire et l’un des fétiches de la mythologie de la Came (compétitivité, attractivité, métropolisation, excellence). L’idéologie sous-jacente est simple : pour être attractive et bénéficier à plein des synergies économiques (par les effets de seuil et d’économies d’échelle), il est primordial de concentrer dans un nombre réduit de territoires un maximum de matière grise, d’offre culturelle et de pouvoir économique. L’action publique est dès lors entièrement tournée vers l’avènement de villes suffisamment attractives pour être en mesure de rivaliser avec leurs homologues européennes dans la grande course de la concurrence mondialisée.
Cette façade cache pourtant une réalité moins reluisante : le grand nombre d’effets pervers ou d’externalités négatives qu’engendre cette concentration, aux premiers rangs desquels se trouvent les phénomènes de pollution et de congestion (les bouchons ou les transports saturés). La concentration urbaine est également synonyme de spécialisation des quartiers – ici ceux d’affaires, là les résidentiels ou culturels – opérée au détriment de toute la complexité du tissu de nos villes, entrelacs bien plus subtils qu’une compilation de « fonctions urbaines » qu’il suffirait d’enchaîner dans sa journée. Cette simplification radicale érode aussi les interrelations complexes que noue une cité avec ses campagnes alentour. La concentration des pouvoirs dans la ville-centre réduit ainsi les arrière-pays à de vastes zones sous influence urbaine exclusivement tournées vers l’alimentation quotidienne des citadins ou leur randonnée mensuelle. De même, en concentrant toujours plus d’emplois et de populations, la métropole bétonne à tout va : toujours plus loin vers ses marges et de manière toujours plus intensive en son sein. L’avancée du front urbain est ainsi un moteur central des dynamiques d’artificialisation des sols, recouvrant des terres de très bonne qualité agronomique et nuisant au potentiel nourricier de nos territoires.
À cet égard, l’aménagement du triangle de Gonesse, au nord de Paris, qui prévoit la bétonisation de milliers d’hectares de terres parmi les meilleures d’Europe est une parfaite illustration d’un phénomène déjà à l’œuvre depuis plusieurs décennies. En ville, la concentration amène également à sacrifier des terres pourtant très intensives en usages comme ces parcelles de jardin, rares oasis de respiration, de rafraîchissement ou de sociabilité pour ses habitants. Aucune ingénuité dans ces choix urbanistiques : la métropolisation est une formidable machine à cash. En s’appuyant sur la différence de prix entre une terre à usage agricole et une terre aménagée, le mètre carré peut voir son prix multiplié par plusieurs milliers ! Autant dire que toute possibilité d’enrôler de nouvelles terres dans la centrifugeuse de la métropolisation attire les promoteurs et aiguise les appétits des investisseurs.
Éco-quartier 
Ils ont fleuri dans nos villes depuis une vingtaine d’années. Ils sont même devenus depuis 2012 l’objet d’un label octroyé par l’État récemment décliné en « écocité ». Les principes affichés de cette démarche semblent, dans un premier temps, louables. Sont ainsi intégrés, par exemple, dans les projets d’aménagement urbain des objectifs tels que « viser la baisse des émissions de CO2 », « optimiser l’utilisation des ressources » ou encore « mettre en œuvre le vivre ensemble ». De belles incantations qui nous feraient presque oublier tous les reproches dont les écoquartiers font l’objet. Lorsqu’il s’agit d’une opération de renouvellement urbain, l’édification d’un écoquartier nécessite généralement au préalable la destruction de barres HLM pour ensuite y introduire une part de mixité sociale dans des zones jugées trop homogènes (comprenez : trop pauvres). Ainsi, pour ses détracteurs, les implantations d’écoquartiers jouent souvent le jeu de la gentrification sous prétexte de mixité en triant par le haut les habitants et en poussant la frange la plus précaire loin de leurs quartiers d’origine.
Mais la notion d’écoquartier est encore plus problématique lorsque c’est un nouvel ensemble urbain qui sort de terre. Dans ce cas, l’édification nécessite d’abord de bétonner des surfaces agricoles, naturelles ou en friche, réduisant d’autant notre potentiel nourricier et la place dévolue au reste du vivant. Où est l’« éco » d’un quartier construit sur dalles de béton dans la droite ligne des cités nouvelles et grands ensembles des années 1960 ? De même, si la place des habitants est bien mentionnée dans les intentions du label, elle reste souvent à l’état de vœux pieux, comme vernis démocratique à des opérations d’aménagement déjà décidées en un autre lieu. La fabrique de la ville s’est ainsi parée d’un label qui sied aux enjeux de notre siècle… sans changer en profondeur ses manières de faire et présupposés.
Tiers-lieu 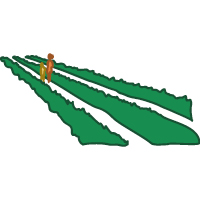
La notion de tiers-lieu bénéficie d’un flou artistique qui la rend quelque peu insaisissable. Car entre le travail et la maison, c’est tout un éventail d’espaces qui ne peuvent être pris d’un bloc : du squat militant à la friche reprise par les habitants, du lieu culturel éphémère favorisé par les pouvoirs publics à un espace investi afin d’augmenter temporairement l’attractivité d’un quartier ou d’une ville, d’espace interstitiel où une autre société s’invente à moteur actif de la gentrification de quartiers populaires… la polysémie même de « notion » invite à la prudence, et surtout à la vigilance. Car dans bien des cas, la dénomination de tiers-lieux instrumentalise la volonté de recréer du « commun » urbain et informel dans le but de valoriser l’espace urbain inexploité et de préparer de futurs projets d’aménagement.
Autrement dit : bien loin de la reprise de terres et d’espaces à des fins d’autonomie alimentaire ou sociale, voire même une réaffirmation subtile de l’emprise. L’occupation, la mise en activité, parfois même en culture, de ces tiers-lieux, même vertueuses, soulèvent un débat plus profond : dans quelle mesure ne doit-on pas justement laisser ces lieux tiers et interstitiels tranquilles ? Ne peut-on pas accepter de « lâcher prise » ici et là afin de permettre aux friches de se développer et de réinviter du sauvage en ville, de laisser la place à un vivant incontrôlé d’où pourraient émerger à nouveau des dynamiques évolutives imprévisibles ?
Soutenez Socialter
Socialter est un média indépendant et engagé qui dépend de ses lecteurs pour continuer à informer, analyser, interroger et à se pencher sur les idées nouvelles qui peinent à émerger dans le débat public. Pour nous soutenir et découvrir nos prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner !
S'abonnerFaire un don