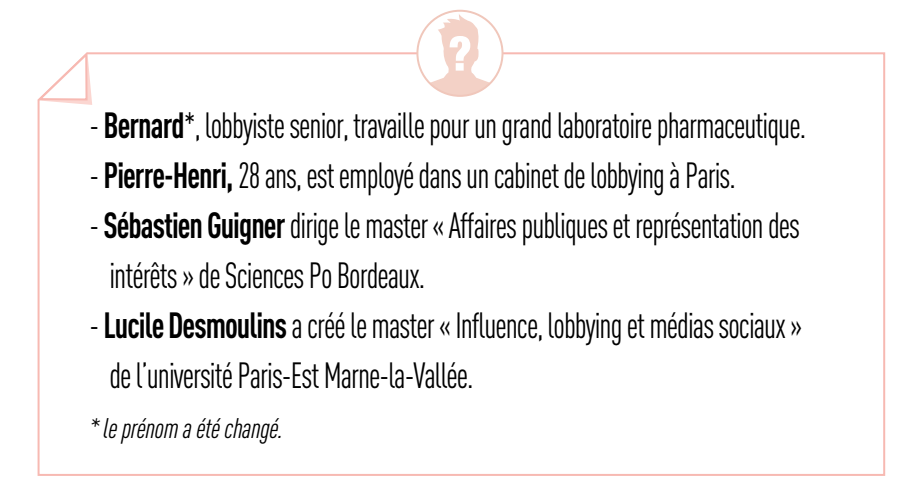1/ Pourquoi j’ai voulu être lobbyiste ?
Il y a mille façons d’exercer et, forcément, autant de vocations. Bernard, dans le milieu depuis plus de vingt ans, n’y avait jamais pensé avant. Comme Pierre-Henri, fraîchement débarqué dans le milieu, il est d’abord passionné par la politique – « J’ai commencé à militer chez les Jeunes giscardiens à 13 ans ! » Et comme Pierre-Henri, il sera formé dans un Institut d’études politiques (IEP, c’est-à-dire Sciences Po) et mettra son premier pied dans le monde professionnel comme assistant d’un député. Mais, à la différence de son confrère, il gravitera plusieurs années dans des organisations politiques avant de recevoir une offre : diriger les affaires publiques françaises d’un des plus grands laboratoires mondiaux. Il n’a jamais quitté le secteur depuis. Pierre-Henri, lui, est de la génération suivante, souvent issue de formations universitaires spécifiques. Assistant parlementaire en parallèle de ses études à l’IEP de Toulouse, il pratiquait les lobbyistes du côté politique. C’est avec un cours de master portant sur le sujet qu’il change de regard. « Quand j’ai réalisé que la décision publique prenait en compte le problème formulé par des professionnels, j’ai compris que le lobbying pouvait être une façon de concrétiser mon goût pour la politique », raconte-t-il. Il fait son stage de fin d'études au sein d’un cabinet de lobbying où il travaille sur la « loi Macron » de 2015. « J’ai alors pu me faire ma propre opinion, bien loin de l’image sulfureuse et galvaudée qu’on peut avoir sur le sujet dans les médias et le discours politique. J’ai vu que je pouvais être une force d’appoint du processus de décision publique. Évidemment, c’était en défendant des intérêts privés, mais qui allaient dans le sens de l’intérêt commun », explique Pierre-Henri, donnant l’exemple d’un « permis malin » aidant les jeunes à financer leur permis de conduire.
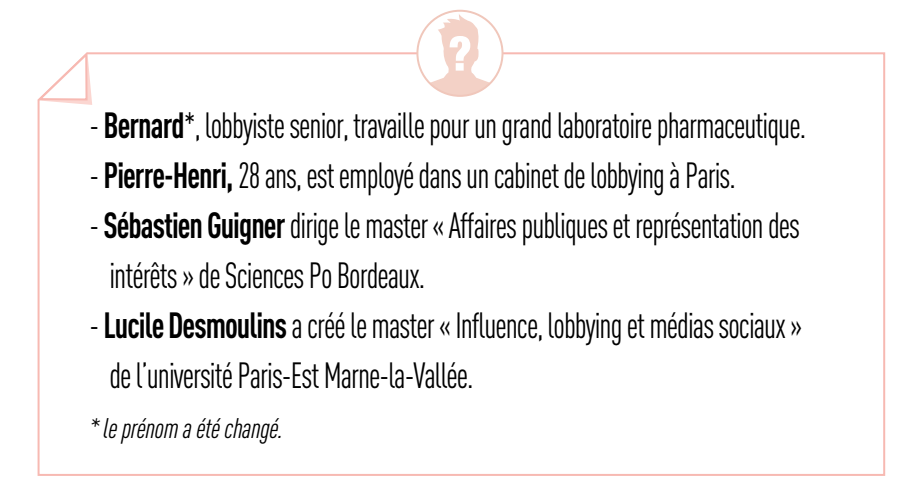
L’image souvent négative véhiculée par le lobbying n’effraie pas les étudiants de l’IEP de Bordeaux. Au contraire, explique Sébastien Guigner. Directeur du master « Affaires publiques et représentation des intérêts » (APRI) depuis sept ans, il souligne que la formation a « le vent en poupe, comme toutes les formations en lobbying, et ce malgré le “bashing” qui existe autour du terme ». La sélection des quelque 18 étudiants qui entreront dans le master est de plus en plus drastique : il y a quatre fois plus de candidats que d’admis. « Depuis deux ans, c’est peut-être le master le plus demandé de l’IEP. » Selon le politiste, « ces vocations s’enracinent dans la disqualification des partis politiques et des syndicats, qui sont les deux institutions traditionnelles censées portées des intérêts dans la sphère publique ». Parmi ses étudiants de l’université Paris-Est Marne-la-Vallée (Upem), Lucile Desmoulins détecte « une ambition de connaître ce qu'il y a dans la boîte noire des processus de décision ». Sébastien Guigner évoque, lui, « un goût pour les questions politiques et le droit », mais aussi pour les causes à défendre. « De plus en plus d’étudiants veulent défendre des intérêts publics », souligne-t-il, évoquant des « cycles de thématiques » avec les questions environnementales au moment de la COP21 de Paris ou les droits des femmes après #MeToo.
2/ Comment devient-on lobbyiste ?
« Droit du plaidoyer et affaires publiques » à l’université Paris-Dauphine, « Affaires publiques et représentation des intérêts » à l’IEP de Bordeaux, « Représentation des intérêts et lobbying » pour celui de Strasbourg, « Affaires publiques nationales et européennes » à l’Institut Catholique de Paris (ICP)… Les formations en lobbying essaiment. Qu’y apprend-on ? Lucile Desmoulins, qui a créé le master « Influence lobbying et médias sociaux » il y a trois ans, met l’accent sur « l’élargissement des compétences, car [s]es étudiants doivent faire face à une concurrence venue d’écoles prestigieuses, type Sciences Po ». Cette formation étant l’aboutissement d’un cycle débuté en intelligence économique, la maîtresse de conférences va « insister sur les outils pour trouver les informations stratégiques et les insérer à la décision ». Le socle de l’apprentissage repose sur quatre grands axes : la capacité à trouver l’information et la traiter « pour fournir la substance au décideur » ; la maîtrise des procédures de décision ; la connaissance des acteurs et, enfin, des compétences en communication. « Cela passe par des choses toutes simples, comme savoir écrire un mail de remerciements, envoyer une carte de vœux, aller à des événements », détaille celle qui fait aussi faire un peu de théâtre à ses étudiants.
À l’IEP de Bordeaux, « la stratégie est de miser sur la connaissance du politique pour apprendre à penser comme eux pour qu'ils finissent par penser comme nous », avance Sébastien Guigner. De façon concrète, le directeur du master « aime à dire qu'on leur apprend les coulisses de la décision publique », c’est-à-dire « comment ça fonctionne en réalité » en essayant de repérer le jeux des différents acteurs sur un sujet et comprendre les coalitions possibles. Sur le plan académique, cela passe par du droit, de la science politique et de la sociologie des médias qui apprennent notamment « pourquoi il est inutile de chercher à faire prendre des décisions avant des élections ». L’enseignement est surtout fait d’interventions de professionnels, de simulations, d’études de cas et d’exercices de rédaction d’amendements ou d’articles de presse.
Solide, pensez-vous ? Pour Bernard, ces diplômes sont superflus. « Il y a un tas de masters par rapport à mon époque. Et je le revendique : les affaires publiques ne sont pas liées à une formation, mais à un état d’esprit. C’est une façon d’être, un éveil sur la chose publique et un talent dans les relations sociales », explique celui qui demandait à ses stagiaires quel quotidien ils lisaient car « connaître plus que son cercle d’expertise est indispensable ». Pierre-Henri, pourtant diplômé du master de l’ICP en 2016, n’est pas totalement en désaccord. Les qualités d’un bon lobbyiste – être au courant de l’actualité, « sentir » les sujets qui vont émerger, avoir un « sens aigu » des relations sociales – ne dépendent pas d’un enseignement. Mais son master lui a « donné des clés méthodologiques, des outils » pour mieux structurer son travail, comme la capacité à rédiger un amendement ou à cartographier des acteurs.
3/ Être lobbyiste au quotidien, ça ressemble à quoi ?
Si l’ADN du métier reste partout le même, c’est-à-dire chercher à influencer les décisions publiques selon ses intérêts, sa réalité est très variable selon l’employeur. Ce dernier peut être une entreprise, mais aussi un cabinet – au sein duquel le lobbyiste défendra plusieurs entités – ou une fédération d’un secteur d’activité, qui conduira à défendre les intérêts communs de cette branche. « Au sein des affaires publiques d’un laboratoire, il y a deux choses : la routine où il faut faire preuve d’imagination face aux concurrents, trouver des éléments différenciants ; et il y a les challenges liés à une mauvaise réglementation, une loi de financement de la sécurité sociale défavorable, qui impliquent de faire valoir des arguments », raconte Bernard. Si le « lobby de la pharma » est celui qui nourrit le plus de fantasmes, lui assure que l’époque du Far West est révolue et que, depuis au moins une décennie, c’est le sérieux sur les dossiers qui prime. « Je n’ai jamais cru au mythe du carnet d’adresses, que d’ailleurs je n’avais pas en arrivant dans le milieu », assure-t-il. Selon lui, le « cœur des affaires publiques est de cultiver l’environnement, créer un climat avec son empreinte ». Et ce travail de fond est « le plus efficace, plutôt que de jouer sur la bonne relation avec X ou Y ». En cas de mauvaise nouvelle, Bernard avait le réflexe de réunir un groupe ad hoc en vue de « préparer le meilleur argumentaire possible ». Ensuite, l’enjeu est d’activer les bons leviers pour faire valoir ses intérêts. Le meilleur cas de figure est d’être reçu directement par le décideur, par exemple le directeur d’administration concerné ou le cabinet du ministre. Dans cette hypothèse, « la convivialité n’amène rien » ; il faut simplement être rigoureux sur le fond du dossier. Mais « si tu ne peux pas rencontrer le décideur principal, il faut bâtir une stratégie d'alliances qui permette de faire porter les messages par d'autres, comme les grands professeurs ou les médias ». Pierre-Henri, lui, évolue au sein d’un cabinet de quatre lobbyistes basé à Paris et qui travaille pour une dizaine d’organisations. Les missions, s’étalant de six mois à deux ans, diffèrent selon les clients – certains n’attendent qu’une veille, d’autres un accompagnement politique. Sa « journée classique », même s’il se défend d’en avoir une, passe le matin par un tour d’horizon de l’actualité – Journal officiel, presse, veille sectorielle – en vue de rédiger des notes de synthèse. Une attention particulière est portée sur les mouvements au sein des cabinets ministériels et l’agenda parlementaire. Puis, il y a un « versant social », consistant à suivre des conférences, nouer des contacts, bref « connaître l’écosystème d’un sujet pour repérer les possibles stratégies d’alliances ».
Dans le quotidien de Pierre-Henri, l’entretien de son réseau occupe une place majeure. « Le lobbying, ce sont des rendez-vous interpersonnels. Et, évidemment, dans ces rendez-vous, on glisse toujours une note ou des “position papers” qui résument les enjeux d’un client en deux pages maximum. » L’objectif est de nouer contact avec le bon interlocuteur, que ce soit rencontrer le nouveau conseiller ministériel nommé sur un sujet sensible ou repérer un parlementaire proche de ses positions. « Si on le sollicite et qu’on le sent intéressé, on lui propose ensuite un amendement » à un texte de loi en discussion, relate Pierre-Henri, qui souligne qu’il est « actuellement assez facile de rencontrer les députés car certains du groupe de La République en marche sont issus du privé, voire de cabinets d’affaires publiques ». Le jeune lobbyiste tient cependant à tempérer : « Ce serait avoir une vision édulcorée que de croire qu’un rendez-vous suffit. »
4/ Et l’éthique dans tout ça ?
Aucun de nos interlocuteurs n’ignore la connotation sulfureuse du terme. Sébastien Guigner avoue même que le nom du master de Sciences Po Bordeaux ne contient pas le mot « lobbying » car il risquerait de « repousser plus que d’attirer ». Mais aussi de braquer en interne, dans le temple du service public qu’est censé être Sciences Po : « Pour beaucoup de professeurs et d’étudiants, la logique privée est illégitime. » Les temps changent et, avec le succès, le master s’est fait une place. Même pour les étudiants, le rapport au lobbying évolue. « Un certain nombre d’entre eux arrivent en étant réticent à utiliser le terme, mais après deux ans à découvrir ce monde-là, ils assument leurs compétences. » Et puis, la découverte de la déontologie au cours de la formation contribue à les mettre à l’aise, car « ils constatent que ce n’est pas un monde sans foi ni loi ». À l’Upem, Lucile Desmoulins va même plus loin que la déontologie en proposant un cours d’éthique. « Cette question ne concerne pas seulement les armes ou les cigarettes, mais aussi défendre une entreprise qui va dans le mur et broyer des gens qui l’ignorent », explique-t-elle. Le master articule un cours « très théorique » sur la notion de justice et l’aspect réglementaire avec des études de cas réels « racontés dans les livres ou vécus par les étudiants ». En pharma, l’époque trouble est terminée, assure Bernard. « Quand je suis arrivé, on fonctionnait beaucoup sur le réseau, tout le monde se tenait par la barbichette. L’industrie vivait encore sur un passé de relations personnelles avec les régulateurs, qui a pris fin avec l’éclosion des scandales, en particulier le Mediator », se souvient-il. Le dirigeant déplore le « tort énorme » que ces pratiques ont porté à l’image du secteur : « Quand on cite un lobby, c’est toujours la pharma et jamais l’agro-alimentaire, par exemple. » « Quand je vais au travail le matin, je crois dans les dossiers que je défends », assure Pierre-Henri, dont l’essentiel de l’activité concerne du « lobbying territorial, donc de la création d’emplois ». S’il affirme n’avoir jamais eu de cas de conscience jusqu’ici, il aurait « des problèmes à travailler pour un client qui voudrait supprimer de l'emploi, porter atteinte à l’environnement ou défendre une marchandisation du corps en bioéthique ». En tout cas, lui n’a pas de complexe à s’afficher comme lobbyiste. Influence, affaires publiques : « Tous ces termes relèvent de la novlangue. Nous sommes lobbyistes, il n’y a pas de raison de se cacher ! »
Cet article a été initialement publié dans le numéro 37 de Socialter "Bienvenue en lobbycratie", disponible sur notre boutique en ligne.

Soutenez Socialter
Socialter est un média indépendant et engagé qui dépend de ses lecteurs pour continuer à informer, analyser, interroger et à se pencher sur les idées nouvelles qui peinent à émerger dans le débat public. Pour nous soutenir et découvrir nos prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner !
S'abonnerFaire un don