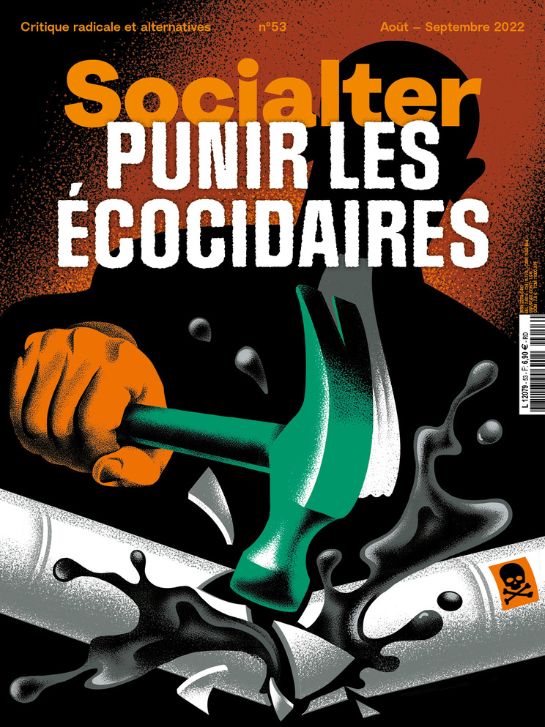Électrification des véhicules, changement des méthodes de production, lutte contre le gaspillage… Alors que la crise climatique s’accélère, les entreprises sont de plus en plus enclines à mettre en place des mesures pour réduire leurs émissions. Si de nombreux dirigeants sont sans doute sincères et enthousiastes à l’idée de mener ces opérations de verdissement, l’objectif est surtout économique : une entreprise « neutre en carbone » est mieux perçue par les consommateurs, peut être avantagée dans des appels d’offres ou encore bénéficier de subventions supplémentaires. Les entreprises high-tech l’ont bien compris : « neutre en carbone depuis 2020 », Apple met ainsi en avant l’origine recyclée de nombreux matériaux de ses smartphones ou la réduction des plastiques à usage unique dans ses emballages. De même, Google est un des premiers acheteurs mondiaux d’électricité d’origine renouvelable et déploie une stratégie d’économie « circulaire » dans ses data centers.
Article à retrouver dans notre numéro 53 « Punir les écocidaires », disponible sur notre boutique.
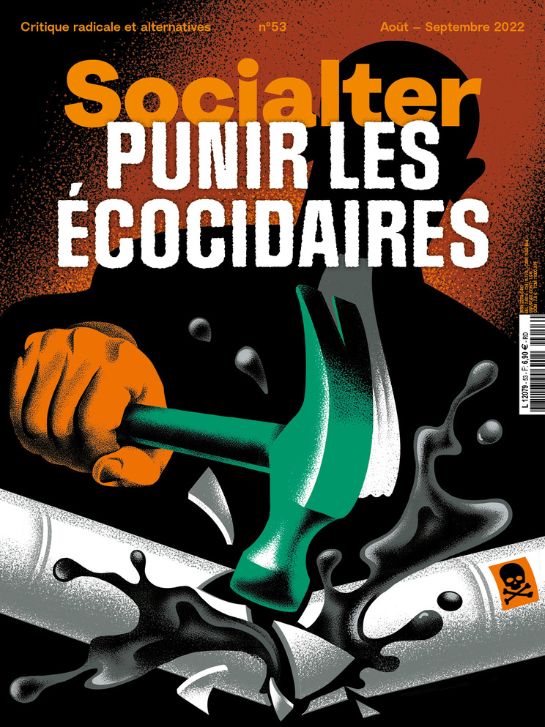
« D’après une étude, les émissions de Google et de Facebook seraient en réalité deux fois plus élevées qu’annoncé, celles de Netflix 50 % plus hautes et celles d’Apple 64 %. »
Mais ces efforts pourraient bien n’être qu’un écran de fumée. Selon un rapport rendu par trois ONG américaines, l’empreinte carbone des grandes entreprises augmente fortement dès lors que l’on s’intéresse un peu à leurs actifs financiers, soit les milliards accumulés dans leur trésorerie. D’après cette étude, les émissions de Google et de Facebook seraient en réalité deux fois plus élevées qu’annoncé, celles de Netflix 50 % plus hautes et celles d’Apple 64 %. Un chiffre qui monte à 5 512 % pour PayPal ! « Cette empreinte carbone n’est aujourd’hui prise en compte par personne : ni les entreprises, ni les ONG, regrette Paul Schreiber, chargé de campagne pour l’ONG Reclaim Finance, qui scrute les investissements dans les énergies fossiles. Aller regarder où sont investis les actifs financiers des entreprises est pourtant extrêmement intéressant, notamment pour celles de la tech, qui ont beaucoup de cash en réserve. »
Une comptabilité lacunaire et peu contraignante
Si cette empreinte cachée est si importante, pourquoi n’est-elle pas prise en compte ? Tous les spécialistes pointent les lacunes de la comptabilité carbone, qui omet souvent une grande part des émissions. Ainsi, le GHG Protocol (ou GreenHouse Gas Protocol), standard américain de référence, distingue trois catégories d’émissions : le « scope 1 », qui regroupe les émissions liées à l’activité directe de l’entreprise (usage de véhicules, transformation de matériaux…) ; le « scope 2 », lié à la consommation d’énergie ; et le « scope 3 », qui rassemble toutes les émissions dites « indirectes ». Ce dernier agglomère tous les gaz à effet de serre générés par les fournisseurs et sous-traitants, ainsi que par les clients des entreprises. Comptabiliser ces émissions indirectes offre donc une vision globale de l’impact climatique d’une firme.
« Les entreprises jouent sur le périmètre utilisé pour leurs annonces, alors que le scope 3 représente la majorité des émissions, souvent autour des trois quarts », explique Guillaume Kerlero de Rosbo, expert en transition écologique à l’Institut Rousseau. Certes, prendre en compte les gaz à effet de serre émis en amont et en aval de la production aboutit à un double comptage. Par exemple, les émissions liées à la fabrication de l’aluminium utilisé dans un smartphone sont ainsi à la fois comptabilisées dans le « scope 1 » d’une fonderie et dans le « scope 3 » du fabricant de téléphone. Cela n’exonère toutefois pas les entreprises, notamment les plus grandes, de demander des efforts auprès de leurs fournisseurs et de leurs clients, comme elles peuvent le faire sur d’autres aspects, tels que le travail des enfants.
En France, beaucoup d’entreprises ne font pas cet effort, car la législation hexagonale autour de la comptabilité carbone leur permet d’ignorer ces émissions indirectes. « Seules les entreprises de plus de 500 employés doivent faire un bilan carbone comprenant les scope 1 et 2 », décrit Guillaume Kerlero de Rosbo. Quant au « scope 3 », seules les structures publiques de plus de 250 employés et les collectivités de plus de 50 000 habitants doivent l’évaluer, ce qui n’inclut donc pas les acteurs privés. Enfin, la loi est peu appliquée : « Environ 60 % des entreprises ne font pas de bilan carbone, soit parce qu’elles ne sont pas au courant, soit parce qu’elles préfèrent payer l’amende de 10 000 euros à l’État français, qui n’est pas dissuasive », ajoute-t-il.
Les actifs financiers, base de l’iceberg
Dès lors, « chacun a intérêt à considérer un périmètre d’émissions arbitrairement restreint, précise César Dugast, manager du pôle Neutralité carbone au sein du cabinet de conseil Carbone 4. BNP Paribas, par exemple, ne regarde que la consommation de ses bureaux et de ses serveurs. » Selon lui, l’impact carbone indirect des entreprises via leurs actifs financiers devrait faire l’objet d’un nouvel indicateur afin d’« alerter le grand public sur le fait que cette épargne a un impact ». En effet, l’épargne accumulée par les entreprises ne reste pas dormir dans un coffre-fort. Elle est généralement placée auprès de banques ou d’autres acteurs financiers, chargés de la faire fructifier. Remis en circulation sur les marchés, ces fonds financent alors d’autres entreprises, dont des activités polluantes ou émettrices. Or, en raison du passage par des intermédiaires, ils ne sont pas pris en compte dans le « scope 3 ».
D’après Guillaume Kerlero de Rosbo, « la plupart des entreprises n’ont pas du tout conscience de financer indirectement les énergies fossiles ». L’étude américaine sur les multinationales du numérique citée précédemment est ainsi la première à s’y intéresser. En revanche, la responsabilité des banques et autres acteurs financiers dans le chaos climatique est, elle, de plus en plus étudiée.
Le dernier rapport annuel « Banking on Climate Chaos », qui répertorie les financements des 60 plus grandes banques mondiales dans les énergies fossiles, fait office de référence. Il évalue ces investissements à 4 600 milliards de dollars depuis 2016 – un chiffre à comparer aux 2 000 milliards investis dans les énergies renouvelables sur la même période. Parmi les 60 banques étudiées, 6 sont françaises, dont 4 dans le top 30 : BNP Paribas (10e), Société générale (21e), Crédit agricole (23e) et BPCE/Natixis (29e). Ensemble, elles cumulent plus de 350 milliards de dollars d’investissements écocidaires sur les six dernières années. À ces montants s’ajoutent les centaines de milliards investis par les autres acteurs financiers, tels que les assureurs, les gestionnaires d’actifs, de fonds de pension, de capital-investissement, etc.
Verdir la finance, une tâche herculéenne
Depuis quelques années, et alors que l’Agence internationale de l’énergie (AIE) appelle à renoncer dès maintenant à la mise en exploitation de nouveaux gisements d’énergies fossiles, ces flux financiers sont de plus en plus pointés du doigt par les militants écologistes. « Ce qu’on demande, c’est que les acteurs financiers s’assurent que les entreprises qu’ils financent aient des plans pour respecter les engagements climatiques ou qu’ils utilisent leur pouvoir d’actionnaire pour voter contre certains projets et, si ça ne fonctionne pas, de désinvestir », détaille Paul Schreiber.
Ces pressions peuvent fonctionner, veut croire le chargé de campagne : « Si de plus en plus d’acteurs refusent de prendre part aux émissions d’obligations de TotalEnergies par exemple, cela va renchérir ses coûts de financement. » Selon lui, ces difficultés commencent à porter leurs fruits concernant le charbon. Le groupe BHP, plus grande entreprise minière au monde, a ainsi été contraint de fermer une mine australienne qu’il souhaitait revendre, faute d’acquéreur. Toujours en Australie, une mine du groupe Adani n’a pas réussi à trouver d’assureur. « On a vu des entreprises qui exploitent du charbon créer des tontines, c’est-à-dire des structures ad hoc pour s’auto-assurer », complète Paul Schreiber.
D’après Reclaim Finance, très peu d’acteurs financiers ont cependant adopté des engagements à la hauteur des enjeux : sur les 150 institutions financières étudiées, beaucoup continuent d’investir dans le charbon. En France, c’est par exemple le cas de la Société générale et de la banque Rothschild. Quant au pétrole et au gaz, les efforts sont pratiquement nuls : plus de la moitié des acteurs analysés n’ont même pas de doctrine sur la question. Les autres se contentent souvent de déclarations floues, évoquant un vague désengagement du secteur ou mettant en avant leurs produits de finance « verte » ou « durable ».
Sans surprise, la plupart de ces annonces s’apparente à du « greenwashing ». D’abord, certains labels de « finance verte », tels que l’investissement socialement responsable (ISR), sont peu contraignants. Pour passer sous les radars, les acteurs financiers refusent aussi parfois de financer de nouveaux projets… tout en continuant à fournir des liquidités aux entreprises qui en sont à l’origine. Les entreprises pétro-gazières mettent par exemple de plus en plus en avant leurs projets d’énergie renouvelable, ce qui leur permet de trouver des financeurs pour ces projets et d’affecter des moyens ailleurs. Dernière combine : les financeurs peuvent réduire leur exposition au secteur pétro-gazier tout en augmentant la quantité totale d’actifs qu’ils gèrent pour faire baisser leur part d’actifs fossiles qui, en réalité, reste à un niveau constant. Toutes les entités d’un même groupe n’ont d’ailleurs pas forcément la même politique : une fois les nombreuses resquilles prises en compte, très peu d’acteurs apparaissent en réalité vertueux. Par exemple en France, seule la Banque postale a adopté une politique compatible avec l’accord de Paris, selon Reclaim France.
« Nouveaux subprimes »
Si les acteurs financiers prêtent autant d’argent à Big Oil, c’est bien sûr parce que ces placements rapportent. « Les acteurs financiers n’ont pas de vision de long terme, ils se contentent de chercher du profit sur quelques années », indique Christian Nicol, membre de l’Institut Rousseau et cadre dans une grande banque. Une situation qui pourrait vite changer. D’après une étude publiée dans Nature, la moitié des actifs fossiles pourraient devenir des « actifs échoués », perdant une grande part de leur valeur d’ici une quinzaine d’années... en tout cas si la transition énergétique a lieu au rythme prévu par l’accord de Paris, avec une baisse de la production de charbon, de pétrole et de gaz de 6 % par an. Ce sont 11 à 14 milliers de milliards de dollars qui pourraient ainsi s’évaporer. Les nouveaux projets d’extraction sont particulièrement risqués, et ce pour deux raisons : d’une part, ils prennent plusieurs années à entrer en service ; d’autre part, l’amortissement de la mise de départ pour les investisseurs prend parfois des décennies. « Même avec une transition tardive, ils seront difficilement rentables », explique Paul Schreiber.

Une étude de l’Institut Rousseau va dans le même sens : selon elle, les actifs fossiles pourraient devenir de « nouveaux subprimes », du nom de ces produits financiers « pourris » à l’origine de la crise bancaire et financière de 2007. Analysant les 11 principales banques de la zone euro, le rapport fait un lien entre les quelque 530 milliards d’actifs fossiles possédés par les banques et leurs fonds propres, environ du même montant. En cas de perte de valeur importante et rapide de ces actifs, ces banques feraient donc faillite. Pour l’économiste Gaël Giraud, cela expliquerait la réticence des banques à agir : freiner la transition énergétique permet d’éviter une dévalorisation de leurs actifs.
En pointant du doigt la menace d’une crise financière, les auteurs de ces études espèrent forcer les acteurs financiers à changer de braquet. « C’est quelque chose qui peut les pousser à agir, car cela met en danger leurs activités », estime Christian Nicol. L’association Finance Watch prépare une campagne sur ce sujet, pour les inciter à considérer ces actifs comme risqués, ce qui les obligerait à provisionner plus de fonds propres, entraînant des surcoûts pour les entreprises exploitant les énergies fossiles. Une autre piste serait de limiter les bonus et les versements de dividendes tant que les banques n’ont pas engagé d’efforts suffisants.
Employer les grands moyens
Si ces techniques peuvent accélérer le timide mouvement de désinvestissement, le secteur financier reste malgré tout focalisé sur les bénéfices à court terme. Ainsi, pour nos interlocuteurs, un durcissement de la réglementation et une action forte de la banque centrale sont indispensables. L’Institut Rousseau propose par exemple de considérer automatiquement les actifs fossiles comme risqués et d’encadrer leur titrisation. « On peut aussi jouer sur les collatéraux [titres financiers mis en gage comme garantie auprès d’un créancier, ndlr] acceptés par la banque centrale ou instaurer des haircuts, c’est-à-dire dévaloriser ces actifs », complète Paul Schreiber. Concrètement, cela impliquerait qu’il serait plus difficile pour des banques d’obtenir de l’argent frais auprès de la banque centrale en déposant ces actifs comme garanties. Les actifs fossiles pourraient aussi être exclus des politiques de quantitative easing, ces rachats de titres par les banques centrales sur les marchés financiers.
Enfin, l’option la plus radicale, proposée par l’Institut Rousseau, serait de créer une « fossil bank », c’est-à-dire une sorte de poubelle réunissant tous les titres qui ne pourront être remboursés, pour en délester leurs propriétaires actuels et éviter une crise financière. « L’idée est de racheter la grande majorité de ces actifs, avec une petite décote de 10 à 15 %, car les banques doivent aussi supporter le poids de leurs erreurs », ajoute Christian Nicol. La « bad bank » en question obtiendrait alors un grand pouvoir sur Big Oil, via les actions et obligations qu’elle détiendrait, ce qui équivaudrait peu ou prou à une nationalisation. Elle pourrait alors instaurer des plans de transition bien plus rapides et utiliser les profits des énergies fossiles pour financer cette transition… au lieu de rémunérer des actionnaires.
Soutenez Socialter
Socialter est un média indépendant et engagé qui dépend de ses lecteurs pour continuer à informer, analyser, interroger et à se pencher sur les idées nouvelles qui peinent à émerger dans le débat public. Pour nous soutenir et découvrir nos prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner !
S'abonnerFaire un don