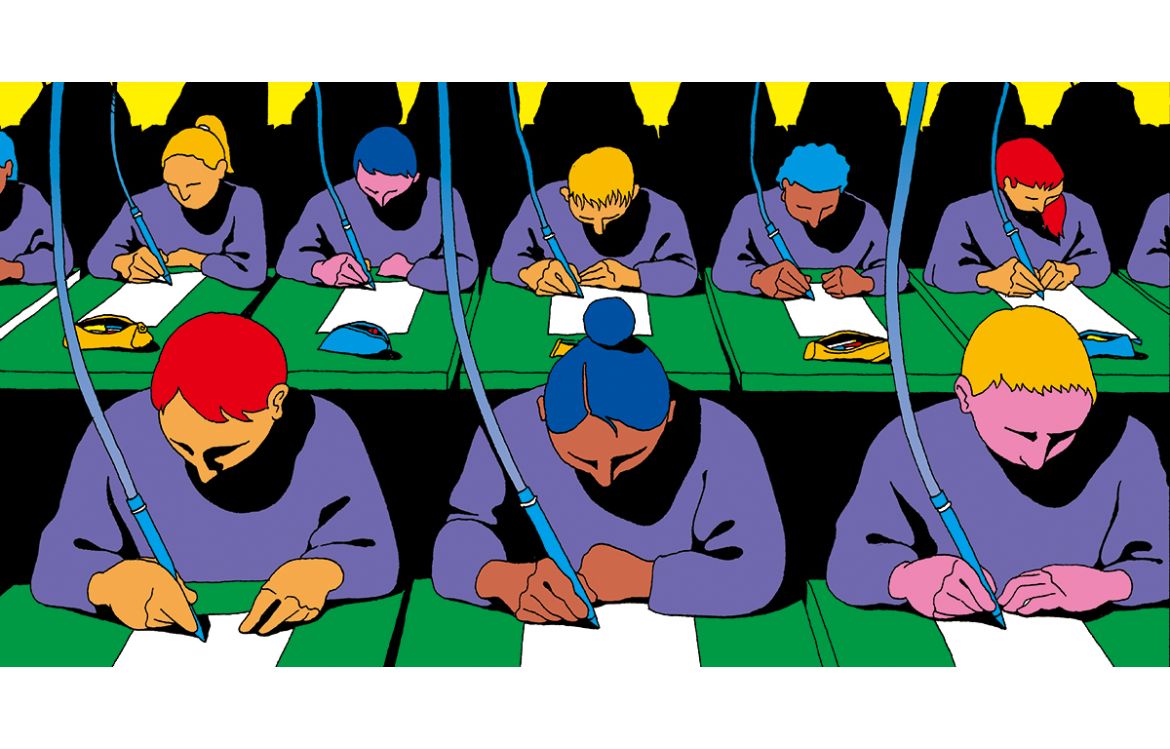«Pouvons-nous imaginer un centre de R&D du groupe Huawei au sein de Télécom Paris, de Monsanto sur le campus d’AgroParisTech, de British Tobacco dans une faculté de médecine ou de Nexter à l’École spéciale militaire de Saint-Cyr ? » Ces mots de révolte sont ceux des étudiants et anciens élèves de Polytechnique. Parmi leurs griefs, qu’ils expriment en partie sur un site dédié à leur revendication, l’opposition au projet de Total d’installer un centre d’innovation et de recherche où travailleront pas moins de 250 salariés en plein cœur du campus – entre le restaurant, les logements et les salles de cours. En plus d’y prendre ses quartiers, Total prévoit de construire des espaces communs (salles de travail et de conférence, cafétéria, etc.) à destination des salariés et des étudiants. Une proximité inacceptable pour 61 % de ces derniers, interrogés par les représentants d’élèves de l’École polytechnique, qui fustigent tant l’initiative que l’absence de transparence de la part de l’administration. Finalement construit 200 mètres plus à l’est, eu égard au dernier conseil d’administration (CA) de Polytechnique, le centre de recherche conservera toutefois les espaces communs aux étudiants et aux salariés.
À cette nouvelle polémique qui s’installe dans le débat public s’en ajoutent d’autres, comme la création à l’université Paris Sciences & Lettres (PSL) d’un diplôme d’établissement à caractère de licence « Sciences pour un monde durable et impact positif » financé presque exclusivement par BNP Paribas, ou encore les multiples partenariats industriels noués avec les institutions : entre Sciences Po et Total, l’École des ponts et Veolia, Centrale et Schlumberger, ou l’université Paris-Dauphine et Mazars et le Crédit Agricole CIB. Rassemblés, tous ces attelages révèlent la toile de fond et les mutations profondes de l’enseignement supérieur, dont l’indépendance risque fort de s’abîmer pour n’être plus qu’un souvenir.
Une mécanique bien huilée
Ce basculement s’est d’abord opéré au niveau juridique. À partir des années 2000, une succession de lois engagent les universités et les grandes écoles vers une « plus grande autonomie budgétaire ». La loi relative aux libertés et responsabilités des universités (LRU), adoptée le 1er août 2007 puis promulguée le 10 août 2007, donne par exemple forme aux pôles de recherche et d’enseignement supérieur (PRES), qui permettront, dix ans plus tard, la fusion des universités – gage d’une plus grande visibilité et « compétitivité » internationale, mais aussi (et surtout) la possibilité pour les établissements de créer des fondations de droit privé et des partenariats avec des entreprises.
Depuis, les partenariats entre les grandes écoles, les universités et les entreprises se multiplient sous diverses formes. « Partenariats universitaires dans le monde », « bourses d’études », « MOOC » (1), « challenges étudiants », « Total Professeurs Associés (TPA) », « présence sur les forums », « chaires d’enseignement et de recherche », « sponsoring et participation à des événements majeurs pour la communauté éducative internationale »… l’organigramme du site internet de Total révèle la pléthore de liens possibles entre les entreprises privées et l’enseignement supérieur. Outre les relations « formelles », d’autres approches moins visibles existent, comme celle menée au sein des Bureaux des étudiants (BDE), désormais directement financés par des entreprises. À titre d’exemple, les financements de la « Kès », le bureau des élèves de Polytechnique, proviennent à la fois des cotisations, des partenariats avec le privé (des trois entreprises marraines de promotion) et du forum des entreprises – l’équipe administrative de Polytechnique et les responsables de la trésorerie du BDE n’ont pas souhaité communiquer les chiffres. Un « mélange des genres » qui irait croissant depuis les années 2000, selon Léonard, un ancien trésorier de la Kès, depuis membre de La Sphinx, un groupe de réflexion d’anciens étudiants qui vise notamment à questionner la place de Polytechnique dans l’enseignement supérieur public.
S'acheter une crédibilité écologique
L’arrivée conjointe des filières « environnement » – qui se déploient sous bien des aspects (« énergies renouvelables », « développement durable », « recyclage des déchets »…) – a aussi été l’occasion pour les multinationales de l’énergie de créer des partenariats. Or, leur activité repose encore essentiellement sur l’extraction et la production de pétrole (Total), la vente de services et d’équipements pétroliers (Schlumberger), ou encore sur des activités mandataires de multinationales pétrolières (Butagaz). Hugo*, étudiant à Sciences Po Paris à l’École d’affaires publiques (EAP), pointe ainsi certains travers : « Ce qui m’a le plus choqué, c’est que l’ensemble des cours sur l’énergie portait sur le pétrole ou le gaz et qu’il n’y avait quasiment rien sur les énergies renouvelables, alors même que l’intitulé de notre master comprend la notion de “développement durable”. » En effet, en 2017, la première année de master d’affaires publiques « Énergie, ressources et développement durable » s’est soldée par un sentiment de désillusion pour certains étudiants, après la découverte du « partenariat stratégique » avec Total. « Lors de la première année de master, l’un des cours obligatoires sur la géopolitique de l’énergie était tenu par le président de la Fondation Total et, en master 2, nous avions un cours sur la finance tenu par un banquier qui était clairement climatosceptique. C’est lorsque j’ai dû réaliser un exposé sur le modèle de financement d’un puits de pétrole que j’en ai eu assez. Avec deux autres étudiants, nous sommes allés voir l’administration. La directrice exécutive de l’École d’affaires publiques nous a alors répondu qu’il n’était pas possible de changer le contenu de la formation pour l’instant, que “Total était très content de la formation de Sciences Po”. » Même si Total, contacté par Socialter le 15 juin 2020, avance que « le groupe n’a aucun droit de regard sur les cours dispensés par Sciences Po ou sur les recherches qui y sont menées », cela n’a pas empêché l’entreprise d’instiller sa vision du monde dans les salles de cours : « Je me rappelle avoir été extrêmement choquée par les paroles de l’un de nos professeurs, Yves-Louis Darricarrère, alors président de la Fondation Total. Il nous avait dit que la guerre d’Irak n’avait rien à voir avec le pétrole, qu’il ne fallait pas s’inquiéter car il y aurait encore du pétrole pour quatre-vingts ans… Nous étions en complet décalage. Lui avait passé toute sa carrière chez Total, c’était un convaincu, il imposait son point de vue. Nous sommes même allés le voir avec d’autres étudiants pour lui dire que ce cours ne correspondait pas à ce à quoi nous nous attendions », confie Emma, ancienne étudiante de Sciences Po Paris. Selon l’école, la part des dons octroyée par Total représenterait 0,1 % du budget de l’établissement. Les étudiants à l’initiative de la campagne Sciences Po Zéro Fossile, un collectif qui œuvre pour le désinvestissement des énergies fossiles au sein de l’école, sont quant à eux plus sceptiques : « Les étudiants des promotions précédentes ont eu accès à des chiffres plus élevés, et il est aujourd’hui impossible de savoir en tant qu’étudiante de Sciences Po le montant et la répartition des dons de Total et de sa Fondation au sein de l’établissement », explique Delia Ioana Nedelcu, membre du collectif.
Tributaire du privé
Les entreprises privées orienteraient-elles vraiment les enseignements ? Pour Léonard, ancien étudiant du cycle ingénieur de l’École polytechnique, l’influence du secteur privé sur l’enseignement se ressent dans le catalogue des cours proposés : « Durant le cycle ingénieur, les étudiants sont amenés à choisir, lors de leur 3e ou 4e année de spécialisation, entre deux cursus, “Énergie du xxie siècle” ou “Sciences et défis”. En choisissant “Énergie du xxie siècle”, je pensais avoir un large choix de cours. Cette année-là, le parrain de promotion était l’entreprise EDF, et il y avait une surreprésentation des cours sur le nucléaire. Les cours sur d’autres types d’énergie étaient donc plus difficiles à trouver, et je me rappelle avoir bataillé par exemple pour pouvoir suivre un cours sur la fusion, qui se distingue de la fission nucléaire. » À l’École des hautes études commerciales (HEC), bien que certains cours soient assurés par des universitaires, Hugo Hernandès, étudiant du « Msc Sustainability and Social Innovation », s’indigne que « l’un des cours centraux – qui porte sur les implications géopolitiques du changement climatique et les différents moyens de produire des énergies fossiles – [soit] assuré par Jean-Michel Gauthier, ancien partenaire Deloitte et cadre de Total, aujourd’hui consultant freelance ». Même la Sorbonne n’y échappe pas : sur le site internet de Total, on apprend que Jean-Marc Fontaine – qui a principalement réalisé sa carrière dans l’exploration et la production de pétrole (2) – propose aujourd’hui des cours aux universités et aux grandes écoles (les Arts et Métiers, HEC et... la Sorbonne) sur la responsabilité sociale des entreprises (RSE), l’innovation et le développement durable. L’objectif de ces interventions dans les universités et les grandes écoles est clair : attirer les nouveaux talents. Pourtant, garantir l’indépendance des grandes écoles semble essentiel lorsque l’on se penche sur l’organigramme du ministère de la Transition écologique et solidaire – l’administration centrale étant principalement composée d’anciens élèves de grandes écoles d’ingénieurs, de commerce et de Sciences Po.
“Polytechnique a signé un contrat de 3,8 millions d’euros pour financer une chaire de recherche avec Total ; l’école Centrale compte deux chaires de recherches avec Total et EDF, en plus d’un partenariat avec Schlumberger.”
Des chaires d'études au mécénat intégral
La plupart des grandes écoles détiennent des chaires d’études financées par des entreprises privées ou bénéficiant directement de donations via leur fondation. Polytechnique a signé un contrat de 3,8 millions d’euros pour financer une chaire de recherche avec Total ; l’école Centrale compte deux chaires de recherches avec Total et EDF, en plus d’un partenariat avec Schlumberger (multinationale de services et d’équipements pétroliers). De façon moins surprenante, les écoles de commerce ont toujours été très liées au monde de l’entreprise. Les étudiants de l’École des hautes études commerciales (EDHEC) du « MSc in Global & Sustainable Business » doivent, à l’issue du dernier semestre de leur master, travailler ou réaliser un mémoire de recherche en partenariat avec les entreprises partenaires comme Butagaz ou encore The Body Shop. Les universités non plus ne font pas exception. Les étudiants et les enseignants de l’université Paris sciences et lettres (PSL) – organisme qui bénéficie du statut d’établissement public expérimental et dont l’École normale supérieure fait partie – ont très mal vécu la création de la licence « Sciences pour un monde durable et impact positif » par BNP Paribas, présentée dans une vidéo promotionnelle sur la chaîne YouTube de la banque par le président de PSL, Alain Fuchs, et par l’administrateur directeur général de BNP Paribas, Jean-Laurent Bonnafé. Le collectif PSL contre-attaque – composé d’étudiants, de chercheurs, d’enseignants et de membres du personnel des établissements associés – s’est alors constitué suite à la signature de la convention de partenariat en 2019. Pour Élise Muller, qui fait partie du collectif, ce mécénat est problématique : « L’entreprise BNP Paribas est connue pour être une banque très polluante qui finance massivement les énergies fossiles, en plus d’autres méfaits à son actif comme la fraude fiscale ou des accusations de complicité de génocide. Cela nous paraissait très dangereux d’associer ce mécène à une formation qui, comme son nom l’indique, est une formation sur le développement durable. Il s’agissait déjà pour nous d’une opération de “greenwashing” de la part de la BNP. » D’autant plus que le mécénat unique crée une situation de dépendance par rapport à ce mécène : « Il n’y a pas d’assurance concernant la pérennité des fonds, et donc la formation. Les enseignants dépendent du bon vouloir du mécène », souligne encore Élise Muller lors de la conférence « Main basse des multinationales sur l’enseignement supérieur », organisée par Greenpeace et les Amis de la Terre le 4 juin 2020.
Une démocratie parcellaire
Qu’il s’agisse de l’affaire Polytechnique ou de l’université PSL, les étudiants mobilisés sur ces questions souhaitent être informés de la nature des liens avec les multinationales. Pourtant, il est très difficile d’avoir accès à ces informations, et il est encore plus compliqué de se faire entendre. Sciences Po avait bien tenté de lancer une consultation du 4 au 15 novembre 2019 – dans le cadre de son programme « Climate Action: Make It Work » – dont le but était de recueillir les propositions d’initiatives des étudiants pour le futur plan de transition écologique. Les trois premières propositions, selon l’école, devaient être sérieusement étudiées. « Pendant le temps de la campagne, la proposition “Cesser le partenariat avec Total” était en 1re position. Ensuite, il s’est passé quelque chose d’étrange : la plateforme a rassemblé plusieurs propositions similaires et notre proposition a été reléguée à la 3e place », partage Delia, de la campagne Sciences Po Zéro Fossile. Depuis le lancement du programme d’action à trois ans pour agir sur les enjeux de la transition écologique, aucune réflexion n’a débuté sur les partenariats avec les entreprises les plus polluantes. Ce manque de transparence, à mesure que Sciences Po affiche ses engagements pour la transition écologique, devient de plus en plus problématique. Pour pallier ces lacunes et ce manque de cohérence, cinq étudiants de l’École d’affaires publiques ont créé en 2019 un collectif de cycle de conférences sur les enjeux environnementaux. Selon Delia « si cette école souhaite être leader sur le plan environnemental, il faut se poser cette question des partenariats. Cela peut par exemple passer par la mise en place d’un comité d’éthique sur la provenance des dons. En tout cas, il faut donner plus d’informations, privilégier autant que possible la transparence et laisser une voix aux étudiants ».
Même les étudiants présents lors des conseils d’administration n’ont pas accès à toutes les informations. Comme l’explique Estelle*, membre du conseil d’administration de l’ENS, « les conseils d’administration sont de moins en moins en plénière comme cela devrait l’être… À l’ENS, il y a un conseil d’administration restreint qui prend les décisions en amont avec la garde rapprochée du directeur. De même pour PSL, où les décisions sont prises sans aucune consultation ». Pourtant, hormis certains cas spécifiques qui nécessitent un conseil d’administration restreint (concernant les carrières du personnel, par exemple), un CA restreint est illégal ; les comités et autres commissions au sein des universités n’ont pas non plus de rôle décisionnaire. Si l’université PSL enfreint cette règle, c’est grâce à son statut d’« établissement public expérimental », créé par l’ordonnance du 12 décembre 2018, qui lui permet entre autres de déroger au code de l’éducation, notamment sur les questions de gouvernance.
Par ailleurs, depuis l’adoption de la loi LRU en août 2007, qui organise l’autonomie des universités, l’effectif et la composition des conseils d’administration ont changé, passant de quelque 30 ou 60 membres, à seulement 20 ou 30 membres. Les CA comprennent désormais davantage de personnes extérieures (dirigeants d’entreprise, élus locaux…), mais n’intègrent plus obligatoirement des représentants d’organisations syndicales de salariés, des associations scientifiques et culturelles, des organismes du secteur de l’économie sociale et des grands services publics. Les étudiants, eux aussi, sont moins représentés (la part minimum des étudiants passe ainsi de 20 à 10 %), de même que le personnel non enseignant – à savoir les ingénieurs, administratifs, techniciens, ouvriers et personnel de service (IATOS) – qui passe de 10 à 6,7 %. Au sein de l’École polytechnique par exemple, le PDG de Total siège au conseil d’administration et « souhaiterait également prendre la tête de la levée de fonds de la Fondation de l’École polytechnique », et donc remplacer Xavier Huillard (président et directeur général de Vinci), selon le porte-parole du collectif Polytechnique n’est pas à vendre !, Matthieu Lequesne. Ce collectif dénonce lui aussi le manque de transparence de l’école dans l’affaire des locaux du futur centre de recherche de Total. Soupçonnant la direction d’avoir caché le projet, les étudiants ont demandé les comptes rendus des conseils d’administration des trois dernières années, que l’école leur a refusés, malgré le caractère réglementaire – et obligatoire – de la requête. « Lorsque le projet d’implantation des locaux de Total commence à être connu des étudiants [un an après le vote de l’emplacement, ndlr], la direction de l’école nous a alors expliqué que les travaux allaient commencer le mois prochain. Après quelques recherches, nous avons appris que le permis de construire n’avait pas encore été délivré et que les travaux n’allaient pas commencer avant six mois », soutient Matthieu. Pour les membres du collectif Polytechnique n’est pas à vendre !, le loyer semble tout autant suspect. Le terrain initialement prévu pour le centre de recherche est loué pour un bail de cinquante ans, pour la modique somme de 50 000 euros par an, soit 4 euros par mètre carré.
“Les universités, comme les écoles, sont considérées comme « des entreprises privées » qui doivent vendre des services, et donc se vendre.” (Philippe Blanchet)
Un tournant néolibéral
L’enseignement supérieur devrait être un laboratoire de débats et de formation d’esprits critiques capables de questionner le statu quo. Or celui-ci est aujourd’hui pétri des valeurs de l’entreprise (3). « Ces bouleversements sont la résultante d’une longue et sûre transformation du milieu de l’enseignement, où les universités, comme les écoles, sont considérées comme “des entreprises privées” qui doivent vendre des services, et donc se vendre », explique Philippe Blanchet, universitaire et auteur de l’ouvrage Main basse sur l’université (Textuel, 2020). Dans son enquête, Business Model (La Découverte, 2020), Olivia Chambard analyse également ce mouvement, porté depuis la fin des années 1970 par plus plusieurs acteurs, dont le Conseil national du patronat français (CNPF) devenu le Mouvement des entreprises de France (Medef), qui auraient encouragé un rapprochement entre les entreprises et l’enseignement français – les écoles de commerce en étant l’emblème. Dans les années 2000, de nouveaux paradigmes éducatifs sont également portés par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et la Commission européenne. Il s’agit de former les jeunes dès le secondaire à de nouvelles compétences liées non plus à l’esprit critique mais à l’esprit d’entreprise. Un apprentissage du savoir-être qui rapproche confusément l’école de l’entreprise et ce, dès le primaire. Au Québec, où ces enseignements sont pionniers, des cours d’entrepreneuriat sont donnés dans les écoles primaires. « En France, certains collégiens apprennent déjà comment recruter, produire et faire fructifier leur entreprise en générant du profit, relève Olivia Chambard. La fonction de l’école est détournée pour intégrer la discipline et les logiques de l’entreprise. » Face à ce constat, les étudiants sont de plus en plus mobilisés pour transformer leur formation. L’appel pour un réveil écologique, mouvement lancé par plusieurs étudiants et jeunes diplômés, réclame « des formations à la hauteur des enjeux actuels » et un renouveau de la démocratie au sein des établissements. Depuis la signature massive de son Manifeste (lancé en septembre 2018 et signé par plus de 40 000 étudiants) et le rapport du Shift Project « Mobiliser l’enseignement supérieur pour le climat » (mars 2019), une discussion sur le rôle et le contenu des formations s’est engagée. Les tribunes s’enchaînent et une proposition de loi relative à la généralisation de l’enseignement des enjeux liés à la préservation de l’environnement a vu le jour. En attendant une hypothétique intervention du législateur, reste à voir si ce lobbying citoyen gagnera suffisamment de poids pour se mesurer à celui bien rodé des multinationales.
(1) MOOC pour Massive Open Online Course (cours en ligne ouvert et massif).
(2) De 1999 à 2000 : Elf Exploration Production, France - Directeur, membre du directoire de la direction technique. De 1982 à 1999 : Elf Exploration Production (activités d’exploration en France, aux Pays-Bas, au Gabon, au Royaume-Uni). Informations disponibles sur le site de Totalprof.com.
(3) Pour décrire les mutations de l’université américaine, les sociologues de l’université d’Arizona Sheila Slaughter et Larry L. Leslie ont développé le concept de « capitalisme universitaire » dans les années 1980.

Soutenez Socialter
Socialter est un média indépendant et engagé qui dépend de ses lecteurs pour continuer à informer, analyser, interroger et à se pencher sur les idées nouvelles qui peinent à émerger dans le débat public. Pour nous soutenir et découvrir nos prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner !
S'abonnerFaire un don