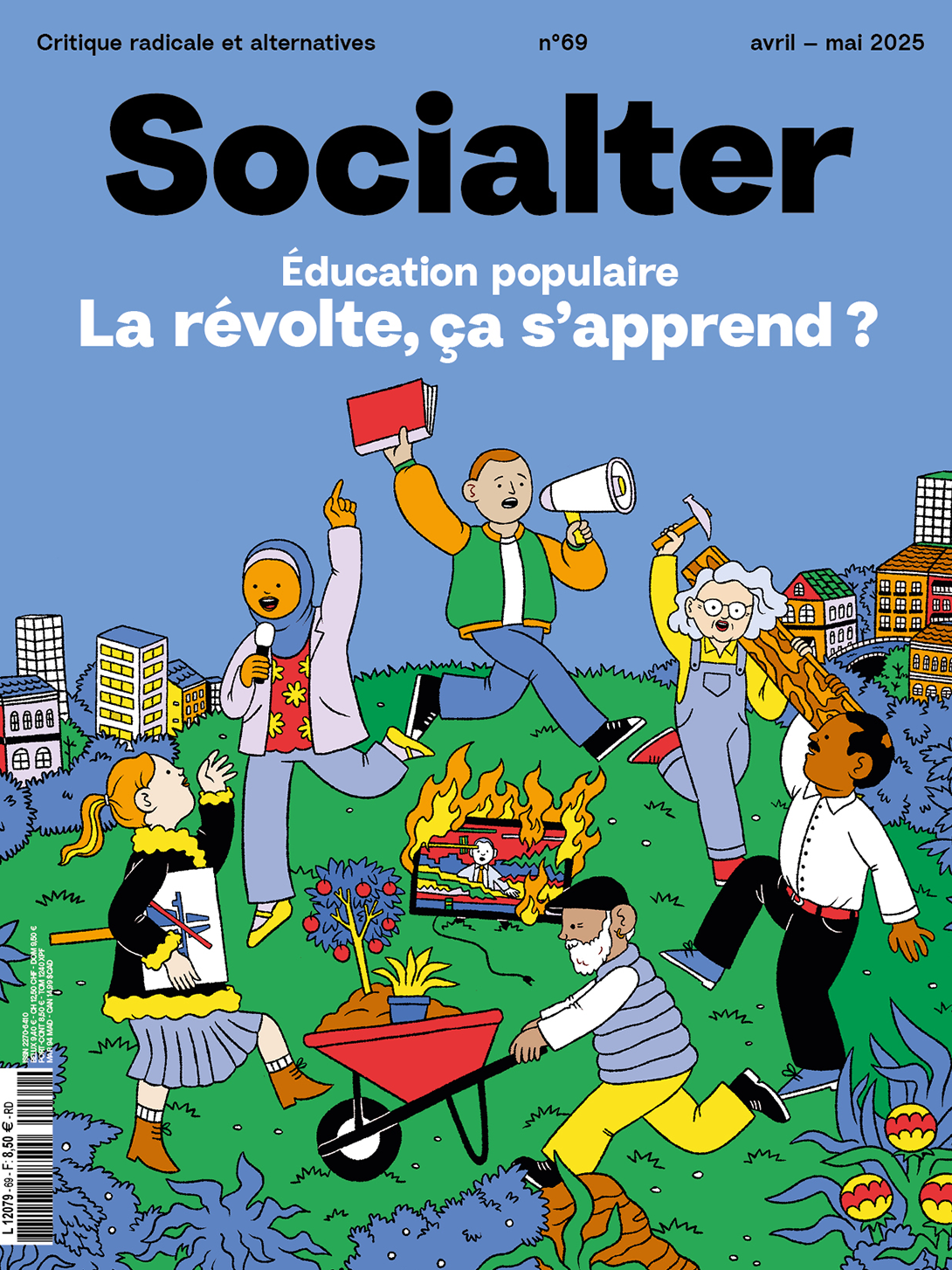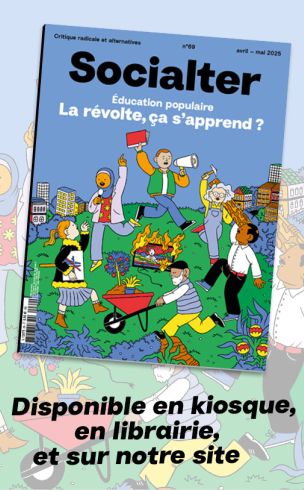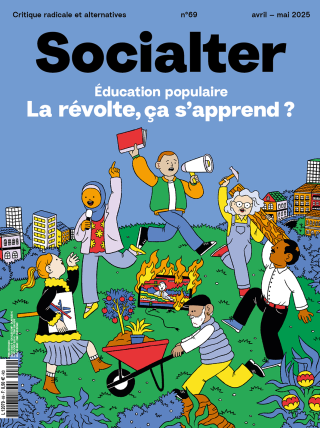Depuis son arrivée au pouvoir en janvier, la nouvelle administration Trump mène une offensive radicale contre les universités et la recherche. Inspiré par l’agenda réactionnaire et ultralibéral du « Project 2025 », le nouveau gouvernement des États-Unis annonce des licenciements massifs, des coupes budgétaires drastiques, et assume une véritable censure, excluant le financement de recherches considérées comme « woke » ou inspirées par un prétendu « marxisme culturel ». Avec une cible privilégiée, à côté des travaux sur les inégalités de genre ou raciales : les sciences du climat et du vivant.
De notre côté de l’Atlantique, de manière moins spectaculaire, les attaques de la droite et de l’extrême droite se multiplient aussi contre les savoirs environnementaux, les institutions (Anses, OFB, Ademe, etc.) et les normes écologiques.
Entretien de notre n°69 « Éducation populaire », disponible en kiosque, sur notre boutique et sur abonnement.
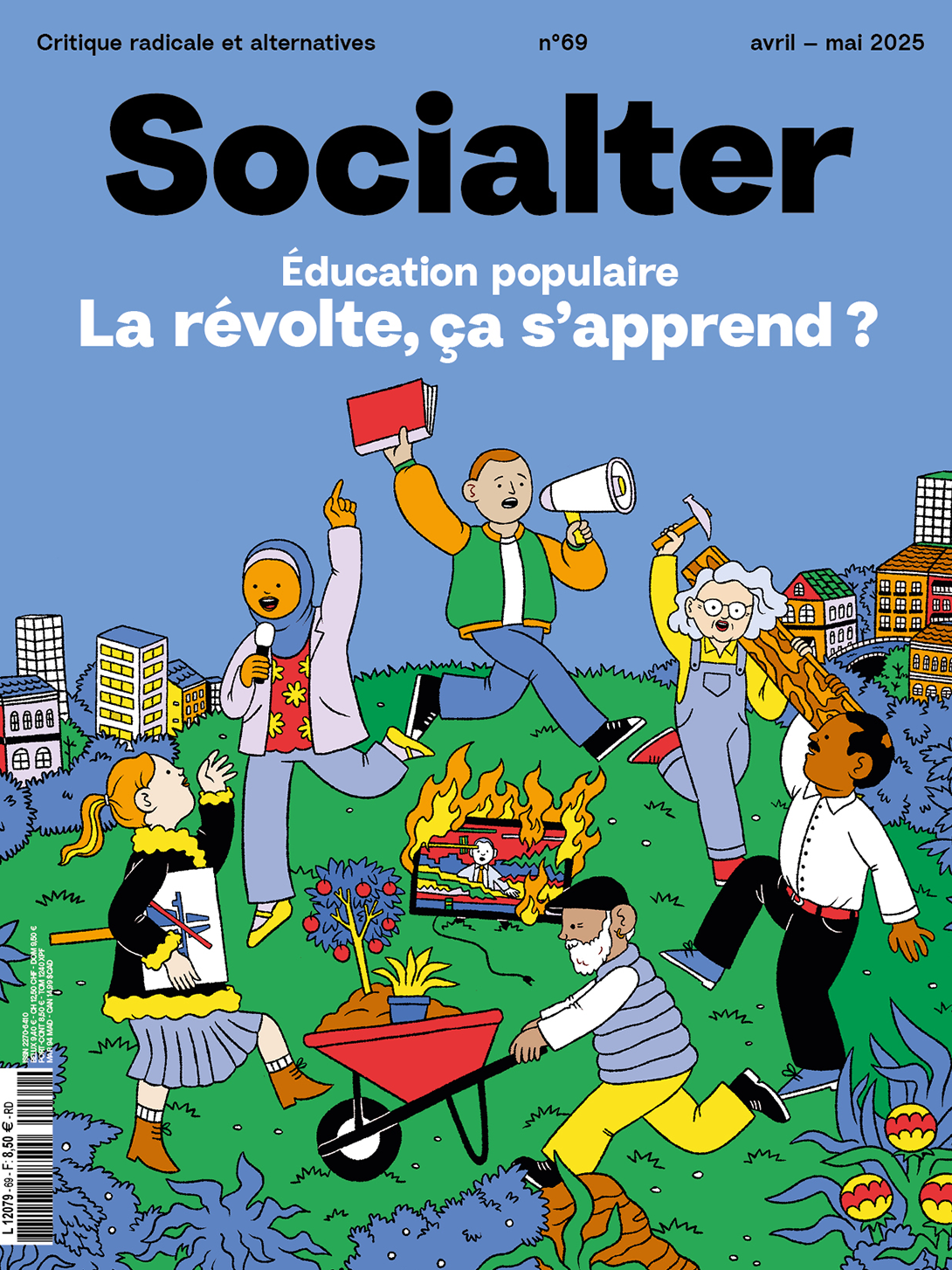
Face aux attaques de l’administration Trump, la communauté scientifique internationale s’est mobilisée le 7 mars sous la bannière « Stand up for science ». Un mot d’ordre auquel vous vous êtes associés l’un et l’autre. Christophe Cassou, vous êtes l’un des signataires d’une tribune appelant les citoyens et scientifiques français à rejoindre le mouvement contre les « nouveaux obscurantistes ». Sommes-nous à un tournant ?
Christophe Cassou Nous sommes entrés dans une guerre éclair contre la fabrique des savoirs, sans précédent dans son ampleur et dans sa brutalité. J’ai l’habitude d’utiliser la métaphore du thermomètre. Jusqu’à présent, on cassait le thermomètre et on s’attaquait ainsi aux indicateurs qui nous permettent d’évaluer de manière objective la réalité du bouleversement climatique. Aujourd’hui, on vise directement les personnes qui lisent le thermomètre : c’est-à-dire toutes celles et ceux qui produisent de la connaissance, dans toutes les disciplines.
Il s’agit donc d’attaques contre des fondamentaux du faire-science : la collecte de données, leur partage, de leur analyse, leur intégration dans les processus de décision. Et ces attaques touchent en particulier les sciences du climat, de l’environnement, de la santé, de la justice environnementale, des inégalités sociales… Pourquoi ? Parce que ces « sciences de la durabilité » vont à l’encontre d’une idéologie qui se base sur l’accaparement des ressources naturelles au profit d’intérêts particuliers, et qui nie la dimension sociale des vulnérabilités causées par le changement climatique.
Philippe Grancolas Il y a une volonté de détruire les personnes et les structures qui font la science, et non plus seulement de les faire taire ou d’en minimiser les analyses. Si un cap a été franchi, il s’inscrit néanmoins dans une tendance. J’ai travaillé au Brésil, quand Jair Bolsonaro était au pouvoir (2019-2022, NDLR) : il avait un rapport aux sciences analogue à celui de Donald Trump. Il ne faut pas non plus minimiser les signaux inquiétants qu’il y a en France.
Quels sont les effets transfrontaliers des attaques récentes pour la recherche ?
C.C. On se focalise beaucoup sur les États-Unis, mais il ne faut pas oublier qu’en Argentine, Javier Milei s’est déjà attaqué à la recherche publique, de manière très directe, en démantelant le Conseil national de la recherche scientifique et technique (Conicet), l’équivalent du CNRS en France. Le souci, quand cela concerne un pays comme les États-Unis, c’est que les effets sont démultipliés au niveau mondial, car ce pays est un acteur majeur en termes de production de données et de recherche sur les sciences du climat. Valérie Masson-Delmotte1 a réalisé un recensement des études incluant des auteurs américains sur le climat : leurs contributions représentent aujourd’hui environ 25 % de la production mondiale.
« J’écris actuellement un article avec une équipe américaine. Depuis trois semaines, mes collègues américains ne répondent pas. Cela vient-il de leur direction ? Est-ce une autocensure par peur d’être licencié ? Nous sommes dans un chaos total et en pleine confusion. »
D’autre part, les États-Unis ont une longue histoire de collecte de données météorologiques et d’observations sur le climat. Ils fournissent des enregistrements de longue durée, essentiels pour la recherche climatique mondiale. Désormais, certaines de ces données sont inaccessibles, avec le danger qu’elles soient un jour effacées. Il y a donc urgence à les sécuriser en créant des doublons dans d’autres pays. Enfin, les coupes dans le budget de la National Oceanic And Atmospheric Administration (Noaa) ont déjà conduit à une diminution du nombre de radiosondages (une procédure de mesure des paramètres météorologiques, NDLR) alors que ces observations quotidiennes, transmises sur le réseau météorologique mondial, sont ensuite utilisées par tous les centres météo pour leurs prévisions, y compris ici, en Europe.
P.G. Concernant la biodiversité, les systèmes d’observation ne sont pas sur la même échelle de temps, nous n’avons pas d’équivalent de l’observation météo si ce n’est avec des suivis locaux de populations (par exemple, celui des oiseaux communs en Europe). En revanche, il existe des plateformes internationales qui font remonter des données collectées localement. Par exemple, la plateforme Global Biodiversity Information Facility (GBIF) comprend plusieurs milliards de données issues des collections des musées d’histoire naturelle et des programmes d’observation du monde entier.
Il y a des nœuds de collecte dans chaque pays, et le nœud américain est évidemment important. Heureusement, les financements 2025 des États-Unis pour la plateforme ont été actés avant l’investiture de Donald Trump. D’autant que la dynamique de coopération internationale sur le vivant est plus récente que celle sur le climat. Dans un an, on peut très bien se retrouver avec de grosses difficultés pour faire fonctionner le secrétariat du GBIF ou de l’IPBES. Si ces réseaux peuvent survivre à l’absence ou à l’opposition des États-Unis, ce sera probablement au prix de quelques difficultés.
Dès son arrivée à la Maison-Blanche, Donald Trump a acté le retrait des États-Unis de l’Accord de Paris. Depuis, le calendrier patine et la participation des scientifiques états-uniens au prochain rapport du Giec est remise en cause. Faut-il craindre un arrêt de la coopération internationale ?
C.C. La semaine dernière, une plénière était organisée par les membres du Giec pour discuter du cadrage du prochain rapport général. Les États-Unis ont pratiqué une politique de la chaise vide : ils ont interdit à Kate Calvin, scientifique en chef de la Nasa et co-présidente du groupe n° 3 du Giec2, de se rendre en Chine pour y assister. Elle n’était même pas en visio. Si elle était présente par la suite lors d’une réunion des auteurs principaux du rapport spécial du Giec sur les villes, prévu pour 2027, nous ne savions pas si elle participait en son nom ou pour représenter son pays.

Certains pays, comme l’Arabie saoudite, la Chine et l’Inde, tentent d’autre part de retarder la publication du prochain rapport du Giec, alors qu’il y a un rendez-vous très important pour le climat en 2028 : le deuxième bilan mondial des politiques publiques en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Depuis un mois, une nouvelle étape a été franchie avec l’interdiction pour les chercheurs de la Noaa de communiquer avec l’Ifremer3, leur équivalent océanographique en France. La coopération internationale est directement menacée. Enfin, pour vous donner un exemple très concret, j’écris actuellement un article avec une équipe américaine. Depuis trois semaines, mes collègues américains ne répondent pas. Cela vient-il de leur direction ? Est-ce une autocensure par peur d’être licencié ? Nous sommes dans un chaos total et en pleine confusion.
P.G. Il faut se rendre compte d’une chose : la manière dont la science peut éclairer les décisions publiques varie selon les cultures et les situations locales. Dans toutes les instances internationales auxquelles j’ai eu l’occasion de participer, comme le conseil d’administration du GBIF ou les délégations nationales aux plénières de l’IPBES, il y a de grandes divergences de sensibilité ! Un scientifique de la République démocratique du Congo n’a pas la même appréhension politique des avis collectifs qu’un scientifique des États-Unis ou encore d’Europe.
Il existe aussi de fortes disparités en termes de données et d’accès aux ressources. Cela génère un sentiment d’injustice souvent légitime. Certains scientifiques issus des pays du Sud se sentent parfois mis à l’écart des discussions sur la biodiversité, et ils n’ont pas tout à fait tort. Leur communauté scientifique a du mal à se constituer a posteriori d’une indépendance acquise il y a quelques décennies. On est parfois confronté à une situation postcoloniale malsaine qui n’aide pas à construire des accords internationaux. Alors, si à toute cette complexité s’ajoutent les interventions politiques de Donald Trump contre la science, bien sûr, cela menace encore davantage la coopération.
Alors que les discours climatosceptiques se sont normalisés aux États-Unis et trouvent aujourd’hui de nouveaux relais en France, on assiste également à un essor de la désinformation sur la biodiversité. Certains contestent l’état des connaissances sur l’effondrement du vivant et disent que la situation n’est pas si grave en Europe car certaines espèces sont florissantes…
P.G. Effectivement, on retrouve sur les questions de biodiversité tous les mécanismes de déni qu’on peut observer sur le climat. Il y a toujours des « rassuristes » qui vont clamer que tout va mieux, en pointant le retour du castor dans le Loiret ou du tigre du Bengale dans une réserve en Inde. Ils concentrent leur attention sur une espèce qui se porte bien et nient l’existence de toutes celles qui vont mal. Ainsi, dans un entretien publié sur le site du Point le 10 octobre dernier, le porte-parole d’Action Écologie4 Bertrand Alliot a affirmé que « la biodiversité ne s’effondre pas en Europe ».
Cette manière de nier les faits scientifiques est très banale et d’autant plus grave qu’il n’y a pas encore de vraie prise de conscience de l’effondrement des écosystèmes, car les points de bascule5 sont locaux, systémiques et ne sont pas forcément perceptibles. Prenons l’exemple de la dégradation des sols fertiles, cela concerne quand même 40 % des sols à l’échelle du monde, c’est colossal. En France, 25 % des sols sont dégradés mais ce n’est évidemment pas visible à l’œil nu. J’ai pour ma part travaillé pendant trente ans sur les insectes dans des forêts tropicales ; j’ai constaté leur déclin année après année.
Une partie de la biodiversité a définitivement disparu et elle ne reviendra pas. J’en ai fait le deuil. Le déni de dirigeants comme Donald Trump, Jair Bolsonaro, ou Javier Milei face à cet effondrement est la combinaison d’une très mauvaise représentation culturelle de la biodiversité et d’énormes conflits d’intérêts, principalement liés aux industries fossiles et à l’agro-industrie.
Ces attaques sont toutefois le signe que la biodiversité n’est plus un impensé total. Et comme cette notion commence à percoler dans l’ensemble de la société, elle devient un enjeu. Et comme elle devient un enjeu... On l’attaque pour maintenir le statu quo.
C.C. Nous avons une bonne connaissance des processus qui conduisent à l’effondrement de la biodiversité et au réchauffement du climat mondial. Nous savons que nos modes de vie sont absolument contraires à ce qu’il faudrait faire pour diminuer les risques de rendre la Terre inhabitable. À ce stade, nous ne pouvons plus parler de climatoscepticisme ou même de climato-dénialisme. Pour moi, nous sommes au-delà. Le climatoscepticisme est, Valérie Masson-Delmotte le dit très bien, « un écran de fumée entre science et société ».

Quant au dénialisme, il exprime le rejet de la responsabilité de l’homme dans la crise écologique. Dans le cas des États-Unis, nous sommes face à des cas de censure et de dissimulation de données scientifiques. Pour décrire cette réalité, j’utiliserais plutôt les termes de « climato-obscurantisme » ou bien de « climato-bellicisme ». Au regard de l’idéologie économique de Donald Trump, d’Elon Musk, ou de certains lobbys du pétrole et de l’agro-industrie, le corpus des connaissances est devenu une menace qu’il faut éliminer.
Les pressions sur la recherche ne s’accumulent pas qu’outre-Atlantique. À quand remontent les premiers signaux inquiétants en France et comment voyez-vous la situation actuelle ?
P.G. La situation de la recherche et de l’enseignement supérieur français est depuis très longtemps en dents de scie. De grands établissements ont été créés après-guerre, comme l’Inserm, l’Ifremer ou l’Inrae. Mais il y a toujours eu des responsables politiques qui ne voyaient pas la connaissance comme un bien commun et qui considéraient les organismes de recherche ou d’enseignement supérieur comme superfétatoires, démesurés ou trop coûteux.
Aujourd’hui, la grosse différence c’est que les attaques sont plus frontales, avec la diffusion délibérée de fausses informations. Après les inondations à Cannes fin septembre 2024, le maire David Lisnard a par exemple attaqué Météo France dans une interview à un quotidien, en omettant les conséquences de l’artificialisation des sols en cas de très fortes pluies. De la même manière, quand Valérie Pécresse ou Gérard Larcher s’en prennent au budget de l’Ademe qu’ils jugent trop important, ils oublient – ou font mine d’oublier – que cette agence est opératrice de crédits de l’État pour la transition écologique des entreprises, des collectivités et des citoyens et qu’il ne s’agit pas de son budget propre.
C.C. Le 14 janvier 2025, même le premier ministre François Bayrou a attaqué frontalement – et sans aucun fondement – l’Office français de la biodiversité lors de son discours d’investiture, en accusant ses agents d’humilier les paysans avec des contrôles « une arme à la ceinture ». C’est grave, car ce récit hors-sol nourrit les petites musiques populistes qui sont en train de monter partout et de gangrener les espaces d’échange et de délibération. Il y a donc, en France, les germes d’une dérive similaire à celle des États-Unis, si on ne fait pas attention et, si on ne met pas en place dès aujourd’hui des mécanismes de protection et de résistance en cas d’arrivée au pouvoir de l’extrême droite.
« Il y a toujours eu des responsables politiques qui ne voient pas la connaissance comme un bien commun. Aujourd’hui, les attaques sont plus frontales, avec la diffusion délibérée de fausses informations. »
P.G. L’OFB n’a pas seulement été attaqué par le premier ministre. Avant cela, plusieurs députés, dont Laurent Wauquiez et Éric Ciotti, ont carrément demandé sa suppression, en prétendant une opposition avec les exploitations agricoles. Quand on voit la propagation de fausses informations se répandre par volonté de détruire des établissements publics qui travaillent sous l’autorité du procureur de la République, c’est de l’ordre de la sédition : cela encourage des attaques contre des lois existantes et contre des établissements et des agents qui protègent le bien commun qu’est la biodiversité.
Christophe Cassou, vous avez récemment pris la parole à Toulouse suite à la décision du tribunal administratif d’annuler l’autorisation environnementale du chantier de l’autoroute A69. Comment les scientifiques ont-ils participé à cette victoire, encore fragile, puisque l’État fait appel et demande la reprise des travaux ?
C.C. Le collectif de scientifiques auquel j’appartiens, l’Atelier d’écologie politique (Atécopol), s’est emparé du cas de l’A69. Ce dernier a été étudié dans toute sa complexité et sa complétude. Or, lorsque ces études ont été portées auprès des politiques, nous avons observé un décalage entre les faits scientifiques et ce que j’appelle « les pensées magiques » qui ne sont souvent fondées sur rien d’autre que sur des perceptions ou des croyances. L’une d’entre elles consistait à répéter que l’autoroute A69 pouvait désenclaver économiquement le territoire entre Castres et Toulouse.

Pourtant, les données de l’Insee, traçables et publiques, ont démontré que c’était faux. Lorsqu’on les confronte aux faits scientifiques, les acteurs politiques se sentent acculés et finissent souvent par attaquer les scientifiques en les présentant comme des militants. On arrive à des situations inquiétantes qui remettent en cause l’État de droit, puisqu’un référé a été demandé pour poursuivre ce projet pourtant déclaré illégal par une décision de justice. L’A69 est un laboratoire miniature qui illustre bien le hiatus entre les faits scientifiques et les décisions politiques.
P.G. Les organismes chargés de conseiller les décideurs politiques au niveau national, comme le Conseil national de la protection de la nature (CNPN) ou l’Autorité environnementale (AE), ont tous émis des avis négatifs sur le projet de l’A69. La décision de lancer ce chantier n’est pas du tout prise en conformité avec les avis des experts.
La prise en compte des connaissances scientifiques dans la décision publique semble insuffisante et aléatoire. Vous avez tous les deux participé à une action visant à former les nouveaux députés sur le climat et la biodiversité en 2022. Quel regard portez-vous sur le rapport du monde politique à la production scientifique ?
C.C. Un des objectifs de cette formation était de rendre la recherche publique française visible et de montrer qu’elle est à la disposition des responsables politiques et des élus. Trente-six chercheurs issus de différents instituts ont collaboré pour servir l’intérêt général et le contrat implicite qui existe entre science et société. L’idée était aussi de responsabiliser les députés, en leur donnant une base de connaissances pour prendre des décisions de manière éclairée. Après cette formation express, ce que nous souhaitions, c’est que les choix contraires aux préconisations scientifiques ne soient plus attribués à une méconnaissance des faits, mais qu’ils soient assumés comme des choix politiques délibérés.
P.C. Cette initiative m’a personnellement permis de comprendre une chose : le statut de la connaissance est fragile dans nos sociétés. Ce n’est pas une grande découverte ; les épistémologues et les sociologues le savent depuis longtemps. Mais, à titre individuel, je l’ai pris en pleine figure. On peut écrire et publier un livre savant ou des travaux qui seront lus par quelques centaines ou milliers de personnes, mais pour que cette connaissance se diffuse dans la société, pour que les citoyens se l’approprient et qu’elle devienne un vrai bien commun, cela nécessite beaucoup de temps et d’efforts.
Aujourd’hui, certains sujets, qui font l’objet d’un consensus scientifique, ne sont jamais remis en question. D’autres, en revanche – pourtant tout aussi avérés et consensuels au sein de la communauté scientifique – sont totalement mis en doute sans que cela ne choque. Si, d’un côté, ces débats relèvent de l’exercice de la démocratie, ils révèlent une appropriation culturelle très médiocre de certaines connaissances scientifiques au sein de la société. Cela souligne le besoin crucial d’améliorer le dialogue science-société, avec plus de partage de connaissances, de formations et de médiations.
En quoi toutes ces mesures qui visent à museler la science sont-elles une menace pour la démocratie ?
C.C. Aux États-Unis, le contrat entre science et démocratie, entre science et décision publique, se fissure. Si s’appuyer sur des fake news devient la norme dans le processus de prise de décisions collectives, la science ne peut plus servir l’intérêt général. Je pense qu’à partir du moment où la liberté académique est attaquée et que la désinformation devient la norme, nous sommes face à une dérive autoritaire qui peut être qualifiée de fascisme.
De plus, ignorer certains faits scientifiques met directement en danger la protection des personnes et des biens : cela accroît d’une plus grande insécurité alimentaire et sanitaire et le risque d’événements extrêmes moins bien anticipés. Sans parler des inégalités environnementales, car les populations les plus vulnérables sont les plus touchées par les effets du changement climatique. En somme, si l’on ne tient pas compte des faits scientifiques, notre système politique ne respecte pas la mission première de l’État de protéger les personnes et les biens.
P.G. Nous sommes dans un tournant de nos sociétés démocratiques, où qu’elles se trouvent. Aujourd’hui, il s’agit surtout de se demander si l’on va finalement réussir à réconcilier l’action politique avec le long terme et la société avec la connaissance en matière d’environnement.
Christophe Cassou
Christophe Cassou est climatologue. Il est directeur de recherche au CNRS au laboratoire de météorologie dynamique de l’ENS, où il étudie les fluctuations climatiques d’origine naturelle et humaine et leur prévisibilité sur plusieurs échelles de temps. Il fait partie des auteurs principaux du 6e rapport du Giec. Il a récemment écrit, avec Valérie Masson-Delmotte, Parlons climat en 30 questions (La Documentation française, 2022 [2023 pour la 2e édition]).
Philippe Grandcolas
Philippe Grandcolas est écologue et étudie l’évolution de la biodiversité. Il est directeur de recherche au CNRS à l’Institut de systématique, évolution, biodiversité à Paris, et directeur adjoint scientifique national de l’écologie et de l’environnement au CNRS. Il a récemment publié Tout comprendre (ou presque) sur la biodiversité (CNRS éditions, 2023) et Biodiversité dans la collection « Fake or not » chez Tana éditions en 2024.
Notes
1. Valérie Masson-Delmotte est paléoclimatologue au Laboratoire des sciences du climat et de l’environnement à Paris-Saclay. Elle a été co-présidente du groupe n°1 du Giec de 2015 à 2023 et depuis 2018, elle est membre du Haut conseil pour le climat.
2. Le groupe n°3 du Giec se concentre sur les actions à entreprendre pour limiter les dégâts du dérèglement climatique.
3. L’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (Ifremer) est un institut de recherche public sur la biodiversité, les ressources et les milieux marins.
4. Action écologie est une association créée en 2020 qui se définit comme « une alternative à l’écologie politique ». Le 15 novembre 2024, elle a organisé un colloque auquel de nombreuses figures du climatoscepticisme ont été invitées, telles que Benoît Rittaud, auteur du Mythe climatique (Seuil, 2010).
5. Un point de bascule désigne un seuil critique au-delà duquel un système climatique subit des changements soudains et souvent irréversibles. Parmi lesquels : la fonte de la calotte glaciaire au Groenland et le dégel du pergélisol.
Soutenez Socialter
Socialter est un média indépendant et engagé qui dépend de ses lecteurs pour continuer à informer, analyser, interroger et à se pencher sur les idées nouvelles qui peinent à émerger dans le débat public. Pour nous soutenir et découvrir nos prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner !
S'abonnerFaire un don