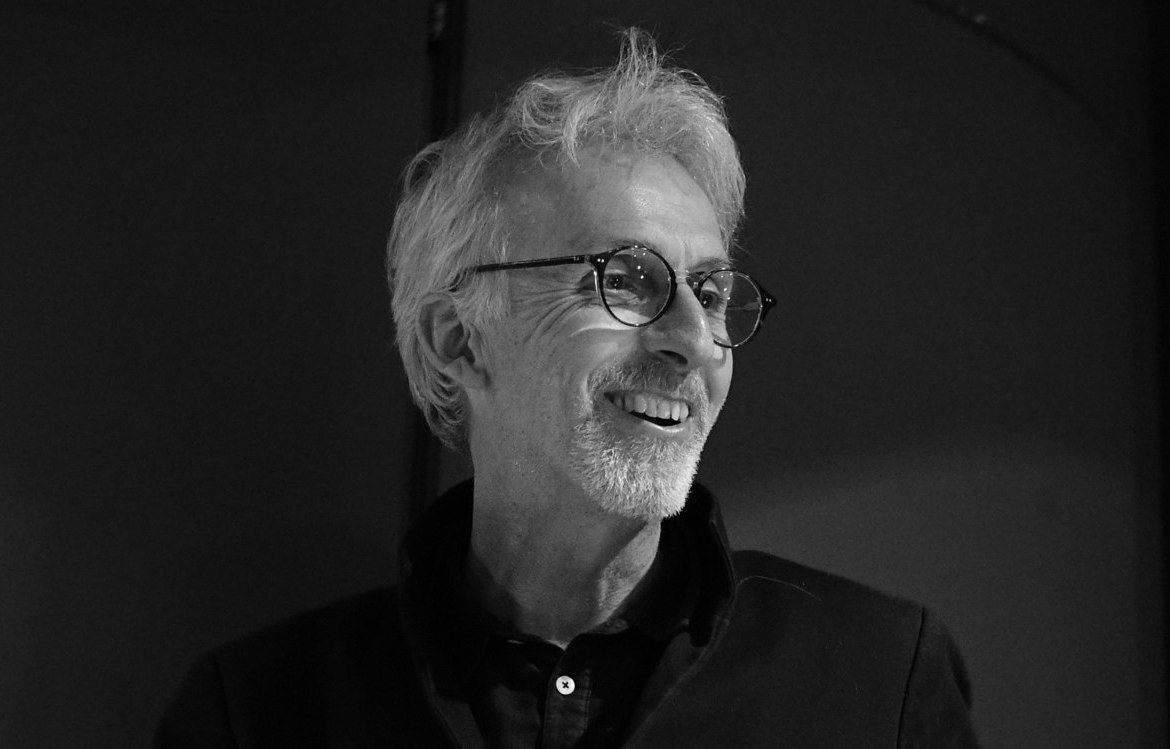Depuis le début du confinement, vous publiez une chronique « Géovirale » sur la chaîne YouTube de l’École Urbaine de Lyon. Dans l’une d’elle, vous affirmez que « le virus est devenu un opérateur spatial puissant, qui connecte les sphères d’activités ». En quoi le virus est-il doté, selon vos mots, d’une grande force géographique ?
Un virus a besoin de passer d’un organisme à un autre pour subsister, donc la diffusion d’un pathogène est un phénomène 100 % spatial. C’est pour cela que la maladie contagieuse, qu’elle soit d’origine virale ou bactérienne, est un phénomène dont le ressort profond est géographique : les conditions d’organisations d’une société sont très importantes pour expliquer sa diffusion.
Le virus a suivi les circuits de la mobilité urbaine mondiale, en empruntant les lignes aériennes, les trains à grande vitesse, les bateaux, et toutes les combinaisons de mobilité que l’on peut utiliser aujourd’hui pour se déplacer. C’est donc logique qu’après s’être manifesté dans une province de Chine, il se soit propulsé à Venise, à Milan, à Seattle, ou à Madrid. En plus de ces circuits, il a trouvé dans ces espaces d’accueil des conditions favorables : un grand match de foot, un carnaval, un rassemblement évangéliste qui ont tous constitué des foyers relais.
François Ascher définit nos sociétés comme hypertextuelles. Vous affirmez qu’elles sont aussi hyperspatiales. Pourquoi ?
L’hyperspatialité représente l’ensemble des connexions que nous pouvons établir, via des transports physiques, entre différents espaces. Un aéroport est un nœud d’hyperspatialité : il connecte un espace avec tous les autres. Le « Monde » a besoin de cette hyperspatialité pour fonctionner comme il existe. Le virus, lui, travaille là où le monde est à la fois le plus efficace et le plus fragile et profite immédiatement de ce système de connectiques généralisé. Il met en évidence l’importance de la connexion dans le fonctionnement mondial et aussi notre dépendance à l’hyperspatialité. C’est ça qui est tout à fait spectaculaire et intéressant. Ce virus est un révélateur presque photographique de l’état du monde contemporain qui en montre à la fois la puissance, l’efficacité et la vulnérabilité.
Pour comprendre cette crise, vous dites qu’il faut d’abord rappeler ce qu’est le Monde avec une majuscule…
J’ai commencé à utiliser la majuscule dans l’Avènement du Monde (Le Seuil, 2013), dans lequel j’ai essayé de montrer que le Monde – pour séparer le concept du mot ordinaire – n’est autre que l’état contemporain de la géographie de la Terre. En d’autres termes, le Monde est ce que nous avons, nous humains, mis en place depuis les années 1950 en raison notamment de l’urbanisation généralisée des sociétés : le Monde est la planète Terre en tant qu’elle est massivement marquée par l’urbanisation.
On comprend donc que ce virus a triomphé facilement parce qu’il a profité des caractéristiques liées à l’urbanisation, comme la mobilité et la connexion. Le virus a aussi voyagé, notamment par le tourisme, qui est devenu une des activités marquantes du monde urbanisé contemporain, avec plus d’un milliard quatre cent millions de touristes internationaux et sans doute plus de trois milliards et demi de touristes au total en 2019. Si l’on comprend ça, on comprend comment le SARS-CoV-2a réussi à nous paralyser – ou peu s’en faut car aujourd’hui, quatre milliards de personnes sont plus ou moins confinées sur sept milliards d’habitants, ce qui est assez spectaculaire.
À quel point le tourisme vient-il renforcer cette hyperspatialité, et par extension la vulnérabilité de nos espaces de vie face au virus ?
Dans un des chapitres d’Hyper-lieux. Les nouvelles géographies politiques de la mondialisation (le Seuil, 2017), j’utilise le principe de « mobilisation générale » des sociétés pour décrire l’état du monde contemporain. La mobilisation générale est le principe selon lequel, dans le monde contemporain, tout et tout le monde (les objets, les matières et les personnes) circulent tout le temps et partout. Le touriste en est l’emblème : il n’y a plus un endroit du monde qui soit aujourd’hui à l’écart du tourisme. L’Everest, l’Amazonie, et même Tchernobyl et Fukushima sont concernés. Le virus a donc fait comme tout le monde : il a circulé partout et tout le temps. Il a révélé la puissance de ce principe de mobilisation générale et a immédiatement révélé notre vulnérabilité et notre exposition à celui-ci.
La ville moderne a-t-elle joué un rôle dans cette pandémie ?
Le problème que nous avons depuis quelques siècles avec la modernité et toutes les ingénieries urbaines qui ont essayé de rendre la ville de plus en plus fonctionnelle et optimale, c’est qu’elles se sont construites sur la négation de la vulnérabilité de la vie humaine. L’être humain est pourtant vulnérable, il est mortel. Même en dehors de sa mortalité, il est fragile : il est très dépendant et sensible aux petites variations. La vie humaine est une vie de vulnérabilité et les espaces géographiques que nous organisons en commun sont tous vulnérables. La seule différence, c’est que depuis quelques décennies nous avons fait semblant de l’oublier. Le virus a cette particularité de nous mettre en face notre vulnérabilité de telle manière que nous ne pouvons plus la fuir : il la rend particulièrement visible. C’est une chance si nous comprenons comment vivre avec cette vulnérabilité individuelle et collective qui caractérise nos existences. Si ça doit aller vers un délire de contrôle – que ce soit un contrôle sanitaire, un traçage des individus, le contrôle technologique – alors ce sera une grande défaite.
En quoi, comme vous l’avancez dans une de vos chroniques, le virus est-il venu perturber le récit de la mondialisation universelle, inéluctable et heureuse ?
Il y a déjà eu toute une série d’événements qui ont écorné cet imaginaire dominant et victorieux de la mondialisation et de la métropolisation. La première anicroche est peut-être le 11 septembre 2001 : c’est la première fois qu’un événement global et traumatique fait de New York une métropole fragile. Mais d’autres événements ont suivi : l’ouragan Katrina de la Nouvelle Orléan, le tsunami de 2004 et puis la crise financière de 2008. La pandémie que nous vivons est l’événement supplémentaire qui vient cristalliser cette critique de la métropolisation.
Et mettre en suspens ce « Système-Monde » …
En 2001, il y a eu un arrêt de quelques jours, puis en 2008 une crise de quelques années, mais nous n’avons jamais vécu un arrêt de plusieurs semaines synchroniques de tous les espaces. Cela ne montre pas que le virus est tout puissant, mais que le monde est totalement interconnecté et qu’il est très sensible à un effet de système, ce que j’appelle « l’effet virus », pour reprendre la fameuse proposition d’Edward Lorenz qui théorise dans les années 1970 l’effet papillon lors d’une conférence intitulée « Le battement d’ailes d’un papillon au Brésil peut-il provoquer une tornade au Texas ? ». Ici, l’accroche des spicules du virus à la muqueuse du patient zéro va aller jusqu’à provoquer l’arrêt du monde.
Aujourd’hui nous comprenons à quel point le care, est fondamental pour la cohésion et la survie de nos sociétés. Existe-t-il un care qui prendrait en compte la géographie, ou du moins une manière d’habiter et de se déplacer ?
Je me suis demandé si l’on pouvait mettre en place un care spatial qui prendrait en compte à la fois « l’attention à », et le « prendre soin » à partir d’une démarche à la fois scientifique, sociale et éthique. La première action, « l’attention à » renvoie à l’attention à nos conditions de vie commune, c’est-à-dire à l’attention collective à la façon dont nous vivons. Et cette pandémie me donne les arguments pour montrer à quel point il est important d’être attentif à la manière dont nous vivons collectivement. Si nous avions été plus attentifs, peut-être aurions-nous pu être mieux préparé à l’arrivée du virus, ou mieux diagnostiqué dès le départ la fragilité de nos dispositifs et de nos espaces, ou peut-être aurions-nous été davantage capables de comprendre ce qui nous menace.
La seconde action, le « prendre soin », renvoie à la manière dont nous pouvons prendre soin de nos espaces de vie communs, mais aussi des plus vulnérables, des non-humains et de l’environnement, dans une sorte généralisation du soin comme le théorise la politologue Joan Tronto. L’idée est de passer de la dépendance à l’interdépendance : si la dépendance peut être considérée comme quelque chose de problématique, l’interdépendance, elle, peut devenir une valeur.
Est-ce pour cela qu’il est important selon vous de prendre en compte dans nos manières d’habiter autant les humains que les non-humains ?
Cette crise est révélatrice de l’interdépendance que nous entretenons avec les vivants et les non-vivants qui composent les systèmes de vie. À force de maltraiter les chauves-souris et les pangolins, à oublier cette interdépendance, nous nous sommes nous-mêmes exposés à une crise que nous aurions pu éviter. Entrer dans une démarche de care spatial, c’est être capable de prendre soin des uns et des autres à travers une attention particulière. Alors peut-être serions-nous plus capables de reconnaître cette vulnérabilité et ce qu’elle nous apporte. Car se reconnaître vulnérables, c’est reconnaître notre dépendance à d’autres tout autant vulnérables, et ça, c’est une grande force. Penser ce care à partir de cette idée d’interdépendance peut nous aider à dessiner des villes complètement différentes de celles qui existent aujourd’hui.
À quoi pourrait ressembler ce care spatial ?
Il reste à inventer collectivement à partir d’expérimentations variées. Par exemple, je milite pour la réouverture des sols, pour que certains trottoirs et certaines rues retrouvent du sol naturel et pour la réouverture d’espaces libres dans les villes. Des espaces (pas forcément verts) qui soient des espaces de respiration, de halte, des espaces où l’on peut se retrouver, se ressourcer ou se mettre à l’écart. Je suis aussi pour le retour du logement coopératif et à la mise en place d’espaces communs gérés en coopérative, mais aussi pour le partage des automobiles et l’échange de services.
Soutenez Socialter
Socialter est un média indépendant et engagé qui dépend de ses lecteurs pour continuer à informer, analyser, interroger et à se pencher sur les idées nouvelles qui peinent à émerger dans le débat public. Pour nous soutenir et découvrir nos prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner !
S'abonnerFaire un don