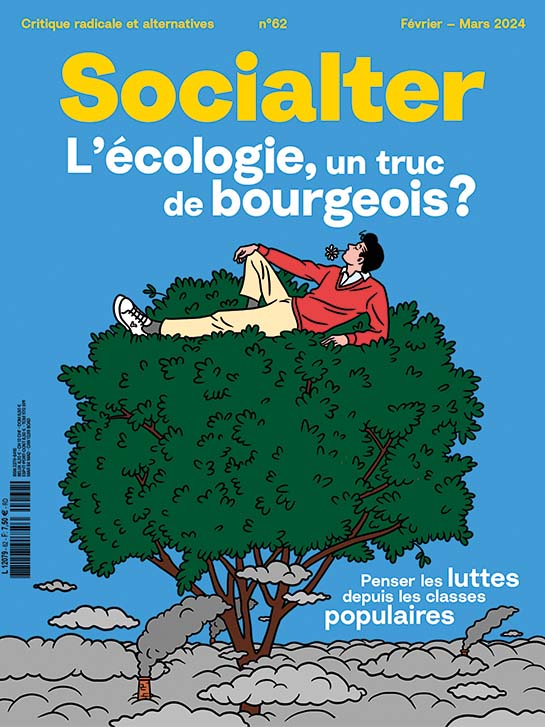La transition énergétique est aujourd’hui un horizon partagé, consensuel, qu’on retrouve partout, notamment dans le dernier accord issu de la COP 28. Mais l’adhésion à cette perspective rassurante de substitution technologique repose, selon vous, sur une vision fausse de l’histoire. Pourquoi la « transition énergétique » vous pose-t-elle problème en tant qu’historien ?
Ce qui m’intéresse, c’est le rôle de l’histoire dans l’acceptation d’un futur – la transition énergétique – qui, quand on y réfléchit sérieusement, pose d’énormes problèmes. Si vous prenez les études actuelles des instituts de prospective, il n’y a pas de transition prévue avant 2050. En gros, l’usage du charbon va stagner ou bien diminuer un peu, les consommations de pétrole et de gaz vont augmenter légèrement. Donc, nous ne sommes vraiment pas dans des trajectoires de basculement d’une énergie à une autre.
Entretien issu de notre numéro 62 « L'écologie, un truc de bourgeois ? »,en librairie et sur notre boutique.
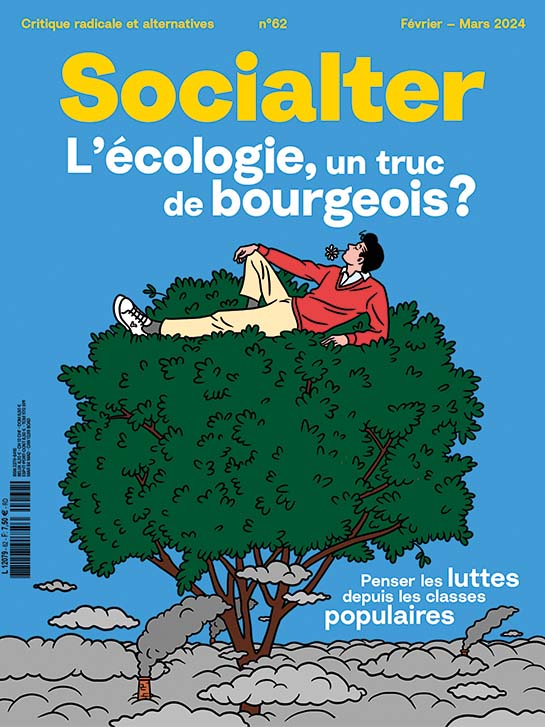
L’apparence de plausibilité d’une « transition énergétique » hors des fossiles en 25 ou 30 ans repose en partie sur une culture historique fausse et « phasiste » de l’énergie. Du collège à l’université, on enseigne que la révolution industrielle, c’est une transition du bois au charbon, suivie au XXe siècle d’une transition du charbon au pétrole. Or, j’explique dans le livre à quel point c’est une vision fausse. D’une part, les énergies ne se remplacent pas mais s’accumulent et, d’autre part, elles sont complètement intriquées les unes dans les autres.
Vous parlez d’histoire « symbiotique ». Pouvez-vous illustrer cette idée de symbiose des énergies ?
On ne comprend pas grand-chose à l’histoire des énergies si on ne montre pas les relations de dépendance qui existent entre elles. Par exemple, l’essor du charbon au XIXe siècle a tiré la consommation de bois. En effet, plus vous avez recours au charbon, plus vous avez besoin de bois dans les mines pour l’extraire, mais aussi pour faire marcher les chemins de fer, pour emballer des marchandises, pour construire des maisons. De même, plus vous avez recours au pétrole, plus vous avez besoin de charbon pour fabriquer les voitures qui vont l’utiliser. Pour produire une voiture dans les années 1930, il fallait autour de sept tonnes de charbon, soit autant en masse que le pétrole brûlé durant toute sa durée d’utilisation. J’ai été frappé de voir l’énorme quantité d’acier, et donc de charbon, que consomme le pétrole. Il faut des tubes pétroliers, de gros réservoirs, des raffineries, et tout ça dépend du charbon. Au début du XXIe siècle, l’industrie pétrolière américaine consomme certaines années plus d’acier que toute l’économie américaine un siècle plus tôt. À cela s’ajoutent les routes qui consomment beaucoup de ciment et donc de charbon… L’utilisation du pétrole est conditionnée par celle du charbon.
Réciproquement, avec le pétrole et les moteurs à explosion, vous avez davantage de charbon. Son coût diminue, car il peut être transporté dans des camions à benne levante, infiniment plus commodes que les chariots et les chevaux d’avant la Première Guerre mondiale. Le camion à benne levante fait partie de ces techniques qui ne paient pas de mine mais qui sont essentielles dans l’histoire de l’énergie. Les énergies ne sont donc pas simplement en superposition, elles sont complètement liées les unes aux autres. Plutôt qu’une succession de phases, ou de grands âges, l’histoire de l’énergie est un embrouillamini de plus en plus compliqué de matières, de techniques et d’énergies.
Le récit habituel de l’histoire de l’énergie, insistant sur une succession de « phases », masque aussi des dynamiques importantes. Ainsi le XIXe siècle, qu’on associe plutôt à l’âge du charbon, connaît un essor des énergies renouvelables. Vous pouvez en dire un mot ?
Le charbon, évidemment, se développe très fortement, notamment à partir de la fin du XIXe siècle. Mais les renouvelables progressent aussi au XIXe siècle. En fait, dans beaucoup de pays industriels, jusqu’aux années 1860, l’énergie hydraulique est dominante. Et il ne s’agit plus de moulins, mais bien souvent de turbines horizontales en fonte, dont la production dépend du charbon. Une fois encore : il ne faut pas opposer les énergies. En France par exemple, la puissance hydraulique sur les cours d’eau est multipliée par trois au XIXe siècle. Aux États-Unis ou dans les pays nordiques, c’est bien davantage. L’éolien progresse également avec l’industrialisation : la marine marchande, jusqu’à la fin du XIXe siècle, dépend du vent. L’éolien fixe aussi se développe fortement. Il y a plusieurs millions d’éoliennes aux États-Unis à la fin du XIXe siècle.
Évidemment, elles n’ont pas grand-chose à voir avec ce qu’on fait maintenant, elles sont plus petites. Mais elles ont un rôle historique énorme puisqu’elles permettent de pomper l’eau des nappes phréatiques dans le Midwest et donc d’irriguer les grandes plaines et d’y développer l’agriculture. C’est un phénomène historique peut-être aussi important que la machine à vapeur, couplée avec le métier textile dans les années 1830 autour de Manchester, sur laquelle les historiens se sont beaucoup focalisés. Enfin, la force musculaire se développe aussi énormément aux XIXe et XXe siècles. Il y a davantage d’humains qui utilisent des outils plus efficaces avec moins de frottements… En fait, le problème en histoire de l’énergie, commun avec l’histoire des techniques et parfaitement souligné par David Edgerton, est que les historiens se sont focalisés sur la nouveauté à chaque époque. D’où une histoire de l’énergie « phasiste », qui nous a acculturés à cette idée de transition.
La transition énergétique n’a donc rien d’une description réaliste de notre passé technique. En réalité, vous l’expliquez, c’est à l’origine une utopie technologique, née dans les années 1950, au sein d’un groupe que vous appelez les « malthusiens atomiques ». Qui sont ces scientifiques et quel est leur projet ?
Les malthusiens atomiques sont des scientifiques qui ont travaillé au projet Manhattan, plutôt de gauche, et favorables au désarmement nucléaire. Ils sont un peu horrifiés a posteriori par ce qui s’est passé à Hiroshima et Nagasaki. Et ils essaient de montrer que ce qu’ils ont découvert avec le nucléaire n’est pas simplement un effroyable engin de mort, mais aussi quelque chose qui va permettre de sauver l’humanité du piège de la raréfaction des ressources. À ce moment, il y a deux imaginaires qui se rencontrent : d’une part, l’imaginaire technophile de l’atome et, d’autre part, l’imaginaire néo-malthusien de l’épuisement des fossiles. C’est à l’intersection des deux que naît la transition énergétique. L’expression « transition énergétique » est d’ailleurs au départ un terme de physique nucléaire, désignant un électron qui change d’état autour de son noyau.
Mais, et c’est un point important, à cette époque, ils n’envisagent pas de transition rapide. Pour ces savants atomistes malthusiens, la transition, c’est une perspective lointaine. Si la fin du pétrole aux États-Unis est proche, la fin des fossiles dans le monde n’aura pas lieu avant le 23e ou 24e siècle. Mais ils considèrent qu’il faut s’y préparer et donc investir dès maintenant pour développer le nucléaire. À leurs yeux, la transition aura lieu du fait du renchérissement des fossiles, qui poussera inéluctablement à développer d’autres technologies. Par ailleurs, leur vision concerne surtout les pays riches. Le problème est qu’on a transféré ce modèle de transition, pensé comme une réponse à la raréfaction à long terme des fossiles, sur la question du changement climatique, qui n’a absolument rien à voir.
Projet Manhattan
Le projet Manhattan désigne le projet de recherche anglo-américain visant à fabriquer des armes nucléaires pendant la Seconde Guerre mondiale. Mené dans le plus grand secret à Los Alamos au Nouveau-Mexique, il a croisé expertise scientifique, production industrielle et coordination militaire pour créer une forme d’armement entièrement nouvelle en un temps record. De nombreux scientifiques internationaux renommés ont participé aux recherches sous la direction du physicien J. Robert Oppenheimer.
Néomalthusianisme
Courant de pensée selon lequel la planète Terre est un système fini aux ressources naturelles limitées dont l’équilibre est principalement menacé par la croissance démographique. Ce nom fait référence à l’économiste conservateur Thomas Malthus (1766-1834) pour qui la croissance de la population risque d’engendrer famines, récessions et guerres. Ses idées connaissent une résurgence dans les années 1960 comme chez le biologiste Paul Ehrlich, favorable au contrôle des naissances, qui publie en 1968 La Bombe P (The Population bomb).
Dans les années 1970, avec les chocs pétroliers, l’idée d’une crise énergétique, c’est-à-dire d’une raréfaction inéluctable et prochaine des hydrocarbures, s’impose dans le débat public, notamment aux États-Unis. La notion de « transition énergétique » devient alors mainstream.
Oui, c’est une décennie clé. L’idée de transition se diffuse dans le sillage d’une autre notion, qui provient également de l’atome, celle de crise énergétique. Dès 1969, cette idée est poussée par l’Atomic Energy Commission (AEC), l’agence à l’énergie atomique américaine, pour défendre l’hypothèse du surgénérateur. L’idée de crise énergétique sert aussi un lobbying auprès de la presse américaine pour contrer les discours antinucléaire. Évidemment, de ce point de vue, le choc pétrolier de 1973, avec le renchérissement du coût du pétrole, c’est un peu la divine surprise. À partir de ce moment-là, tout le monde se met à parler de crise énergétique et de transition énergétique.
Surgénérateur
La surgénération est le fait de fabriquer des combustibles nucléaires à partir d’autres éléments que l’Uranium 235, majoritairement utilisé dans les réacteurs nucléaires. Un réacteur nucléaire est un surgénérateur lorsqu’il permet de récupérer les matériaux fissiles produits en réacteur afin d’en faire du combustible neuf. Dans les années 1970 et 1980, la prévision d’épuisement des ressources d’Uranium 235 a rendu cette technologie attrayante, malgré son coût et ses risques importants.
Y compris dans les milieux écologistes qui se réapproprient cette thématique…
Oui, il s’agit là probablement d’un échec important. Une partie du mouvement écolo américain, critique de l’atome, reprend une vision simpliste des systèmes énergétiques et défend l’idée d’un grand basculement vers le solaire en quelques décennies. C’est le cas, en particulier, d’Amory Lovins. Aujourd’hui, il est présenté comme le grand gourou du solaire et des renouvelables, qui avait raison avant tout le monde. Sauf qu’en fait, il s’est surtout trompé avant tout le monde. En 1976, il affirmait qu’en trente ans, les États-Unis pouvaient entièrement sortir des fossiles, avec un argumentaire très libéral. Il fallait laisser le marché faire, les renouvelables allaient se bricoler dans les garages et ça irait très vite. C’est à ce moment que le mouvement environnementaliste commence à naturaliser la transition énergétique. On pense que, quoiqu’il arrive, il y aura une substitution énergétique du fait de l’épuisement du pétrole. Mais avec beaucoup de capitaux et d’innovation, on se rend compte que les limites des ressources fossiles peuvent encore être repoussées. C’est bien ça le problème.

La fin de votre livre apporte un éclairage très intéressant sur la naissance du GIEC, créé en 1988 pour contrer, dites-vous, l’activisme climatique de scientifiques menés par un biologiste égyptien, Mostafa Tolba. Pouvez-vous revenir sur cette genèse ?
Mostafa Tolba est le directeur du Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE). En 1987, il remporte un succès important : la signature du protocole de Montréal, qui prévoit la fin de l’usage des CFC, pour arrêter la destruction de la couche d’ozone. Or, depuis une dizaine d’années, on commence à l’époque à parler de changement climatique. En 1970 il y a eu une conférence à Stockholm, puis en 1979 à Genève. La question est déjà en partie dans le circuit onusien. Mostafa Tolba veut faire sur les fossiles la même chose que pour la couche d’ozone. Il crée un petit groupe de chercheurs, l’Advisory Group on Greenhouse Gases, dans lequel on compte notamment le Suédois Bert Bolin, une figure majeure de l’expertise climatique, qui suit ces questions depuis les années 1960. Une fois encore, il ne faut surtout pas penser qu’il y aurait une sorte de découverte soudaine du changement climatique. C’est un vieux problème. Les conseillers de la Maison blanche sur les questions scientifiques en parlent depuis le milieu des années 1960.
Protocole de Montréal
Le protocole de Montréal fait suite aux alertes lancées dans les années 1970 par des scientifiques sur la menace que font peser sur la couche d’ozone des composés produits par l’industrie chimique, les chlorofluorocarbures (CFC), présents dans de nombreux objets du quotidien. Signé en 1987 par de nombreux pays, il doit son succès à la découverte rapide de substituts aux CFC, permettant aux industries de conserver en partie leurs procédés habituels, ainsi qu’à la création en 1991 d’un fonds multilatéral pour accompagner les pays les moins riches dans leur transition.
« On ne comprend pas grand-chose à l’histoire des énergies si on ne montre pas les relations de dépendance qui existent entre elles. Par exemple, l’essor du charbon au XIXe siècle a tiré la consommation de bois. »
Pour en revenir à Mostafa Tolba, il faut souligner ses discours assez véhéments, en décalage même avec les climatologues de l’époque. Pour lui le problème est très grave, il faut agir immédiatement. Lors d’une conférence internationale à Villach en Autriche en 1985, il appelle à réduire de 60 % les émissions de CO2 avant l’an 2000. Quand l’administration Reagan entend cela, elle s’étrangle. Les États-Unis vont donc pousser à la création d’un autre groupe d’experts, qui ne seront pas cette fois des experts internationaux, comme à l’ONU, mais des experts intergouvernementaux.
C’est le « i » de GIEC qui est important : ces experts sont nommés par les gouvernements. Dans les archives de la présidence Reagan, on voit qu’il est clairement préconisé que le GIEC compte des représentants, non pas seulement des ministères de l’Environnement et de la Recherche, mais aussi de l’Agriculture, de l’Industrie, de l’Énergie. On peut tout à fait lire la création du GIEC comme une manière pour les gouvernements, celui des États-Unis au premier chef, de reprendre la main sur l’expertise climatique. Le processus s’accélère en 1988, parce qu’il y a une canicule, et même une sécheresse importante aux États-Unis. Et il y a, le même été, une conférence internationale au Canada qui reçoit une bonne couverture médiatique. C’est à ce moment-là que les États-Unis poussent pour créer le GIEC.
Vous vous penchez en particulier dans votre livre sur l’origine du groupe III du GIEC, chargé d’établir des scénarios d’atténuation des émissions de gaz à effet de serre. À ses débuts, racontez-vous, ce groupe est présidé par des scientifiques étasuniens partisans du laisser-faire, voire carrément climatosceptiques…
Depuis 1979, il y a déjà des rapports clairs et qui font consensus sur le changement climatique. Pour les experts, la question n’est plus tant de savoir s’il y a de l’effet de serre et du réchauffement, mais à quel rythme et avec quels effets. J’insiste là-dessus parce qu’on a souvent l’impression que c’est seulement dans les années 1990 que le consensus scientifique s’est fait.
Peu après la création du GIEC, en 1991, les États-Unis nomment un climatosceptique à la tête du groupe III : Robert Reinstein. Les États-Unis sont à l’époque, de loin, les premiers émetteurs mondiaux. Et en amont de la conférence de Rio de 1992, le chef de cabinet du président George Bush, John Sununu, donne une consigne claire à Robert Reinstein : « No target, no money. » Pas de cible : on ne va pas se fixer d’objectifs d’émissions. Pas d’argent : jamais les États-Unis ne donneront de l’argent pour dédommager les dégâts du réchauffement. Il reste donc une option : « Play the technology card », jouer la carte technologique. La transition énergétique apparaît donc nettement, à ce moment-là, comme un argument dilatoire des États-Unis dans les négociations internationales.
Robert Reinstein est aussi en contact avec William Nordhaus, une figure majeure de l’économie climatique à ses débuts – qui obtiendra même le prix Nobel en 2018. Ses modèles expliquent qu’il est urgent de ne rien faire et que la transition sera plus facile plus tard. On retrouve ces idées dans le deuxième rapport du groupe III par exemple. C’est ainsi que l’expertise intergouvernementale va être façonnée, au moins à ses débuts, par les impératifs politiques américains.
Conférence de Rio en 1992
Considérée comme l’apogée de la coopération environnementale, la conférence de Rio, aussi appelée Sommet de la Terre, a mené à l’adoption de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et de celle sur la diversité biologique. Elle a également affirmé le concept de développement durable dans la protection de l’environnement, entérinant une association libérale entre des objectifs de croissance économique et de protection de l’environnement.
Le fait que la transition énergétique soit devenue l’horizon de la lutte contre le changement climatique constitue à vos yeux « un scandale scientifique et politique ». En quoi ce paradigme est-il complètement inadapté ?
Dans certains domaines, la transition est envisageable. Pour l’électricité, qui représente 40 % des émissions mondiales, il faut faire des renouvelables. Même s’il ne faut pas croire qu’il va être si facile de décarboner la production électrique à l’échelle mondiale. En revanche, imaginer qu’on va entièrement sortir des fossiles en trente ans, c’est une vue de l’esprit. Il y a plein de technologies qu’on ne sait pas décarboner. L’aviation est la plus connue, mais il y en a d’autres. Pour le ciment, ça va être très compliqué, tout comme pour l’acier, le plastique, les engrais… Dire « on va trouver de nouvelles technologies pour tous les secteurs et les diffuser à l’échelle globale, y compris dans les pays pauvres, et tout ça en trente ans », ce n’est pas vrai. Le problème est que pendant qu’on fait miroiter des avions à hydrogène et une économie décarbonée grâce à une troisième révolution industrielle, on ne parle pas du niveau de production et on ne parle pas de la répartition des émissions. L’un des effets du discours de la transition énergétique, c’est qu’on ne pose pas les questions de la sobriété, de la décroissance et de la répartition.
C’est pour ça que je conclus en disant que la transition énergétique est l’idéologie du capital au XXIe siècle. Quand on parle de transition, on parle d’innovation, d’investissements. Autrement dit : c’est le capital qui va nous sauver. On voit bien le rôle politique que joue cette histoire de transition. Ça évite de poser des questions qui fâchent, par exemple celle de la régulation de la consommation des plus riches…
L’idée de transition énergétique laisse dans l’ombre d’autres solutions. Vous donnez l’exemple du dernier rapport du groupe III du GIEC où le thème de la sobriété (sufficiency) apparaît timidement pour la première fois. La décroissance est à peine évoquée, alors que la « transition » est martelée 4 000 fois… Comment faire pour que des scénarios basés sur la sobriété et la décroissance des flux matériels fassent l’objet d’une expertise sérieuse ?
J’espère que mon livre sera compris comme un appel à réfléchir bien plus sérieusement à ces questions. Les économistes ont laissé dans un état de friche intellectuelle la question de la décroissance. Toujours dans le dernier rapport du groupe III, il est écrit noir sur blanc qu’aucun des 3 000 scénarios n’explore, ne serait-ce qu’à titre d’hypothèse, la question de la décroissance.
Beaucoup par contre incluent des quantités scandaleusement élevées d’émissions négatives. C’est vraiment étrange. Pour ne pas dépasser les +2 °C, ils prévoient de stocker entre 170 et 900 gigatonnes de CO2 d’ici 2100. Or, pour donner un ordre de grandeur, l’ensemble de la production mondiale de bois représente quatre gigatonnes. Il faudrait stocker plusieurs fois la production mondiale de bois sous terre chaque année. C’est quand même un peu n’importe quoi.
« Imaginer qu’on va entièrement sortir des fossiles en trente ans, c’est une vue de l’esprit. Il y a plein de technologies qu’on ne sait pas décarboner. »
Pendant ce temps-là, effectivement, on ne questionne pas la croissance économique, ni le consumérisme. Mais ces thèmes vont s’imposer d’eux-mêmes. De plus en plus. Parce que quand on voit les courbes de baisse des émissions qu’il faudrait suivre, on est face au mur.
Y a-t-il, à vos yeux, des expériences historiques de décroissance énergétique susceptibles de nous apporter des leçons ?
Non, objectivement. Ce qu’on doit faire est inédit, il n’y aucune analogie avec un autre moment de l’histoire. Évidemment, il y a eu des moments où certains pays ont baissé radicalement leur consommation, à la suite de guerres, de crises, de blocus. Mais aujourd’hui, même les plus gros événements historiques ne font que de toutes petites encoches sur la courbe des émissions de CO2. L’exemple le plus criant, c’est le Covid : pas loin de 4 milliards de personnes confinées et seulement 5 % de moins pendant un an et puis c’est reparti de plus belle. Maintenant que la croissance est globalisée, l’histoire ne se voit plus dans les courbes des émissions.
Si la transition est à vos yeux une forme de climato-rassurisme, justifiant l’inaction climatique, le véritable agenda de nos dirigeants et des milieux économiques, c’est l’adaptation ?
Actuellement je ne sais pas. Par contre, j’ai trouvé des archives intéressantes sur les années 1970-80 aux États-Unis et en Angleterre. Des rapports font le constat dès 1979 que la Chine va bientôt émettre beaucoup plus que les États-Unis et l’Europe réunis. Donc ils ont bien conscience que c’est inexorable : le changement climatique va avoir lieu. À leurs yeux, la question clé, c’est l’adaptation. Et il y a une très forte confiance sur la capacité des États-Unis à vivre et prospérer dans un monde à +3 °C. Ils estiment préférable et moins cher de vivre dans un monde à +3 °C, plutôt que de se serrer la ceinture pour éviter la catastrophe climatique. Je ne sais pas si cette vision est toujours d’actualité. On trouve le même discours au Royaume-Uni sous Margaret Thatcher. En France, ça y est, Christophe Béchu a dit qu’il fallait se préparer à +4 °C. Donc, je pense effectivement que l’agenda qui domine maintenant et qui a toujours dominé, en fait, c’est une forme de résignation et une confiance dans la capacité des pays riches à s’adapter.
Jean-Baptiste Fressoz
Historien des sciences, des techniques et de l’environnement, Jean-Baptiste Fressoz est chercheur au CNRS et enseigne à l’EHESS et à l’École des ponts et chaussées. Ses travaux portent sur l’histoire politique des destructions environnementales et la désinhibition progressive des sociétés modernes à l’égard des risques industriels. Il a mis en lumière dans L’Apocalypse joyeuse (Seuil, 2012) et Les Révoltes du ciel (Seuil, 2020, avec Fabien Locher) l’ancienneté des controverses et des inquiétudes suscitées par la révolution technoscientifique des années 1800 et les transformations massives de l’environnement. Il est également l’auteur avec Christophe Bonneuil de L’Événement Anthropocène (Seuil, 2013).
Sans transition. Une nouvelle histoire de l'énergie Jean-Baptiste Fressoz Éditions du Seuil, 2024 416 pages, 24 €
Soutenez Socialter
Socialter est un média indépendant et engagé qui dépend de ses lecteurs pour continuer à informer, analyser, interroger et à se pencher sur les idées nouvelles qui peinent à émerger dans le débat public. Pour nous soutenir et découvrir nos prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner !
S'abonnerFaire un don