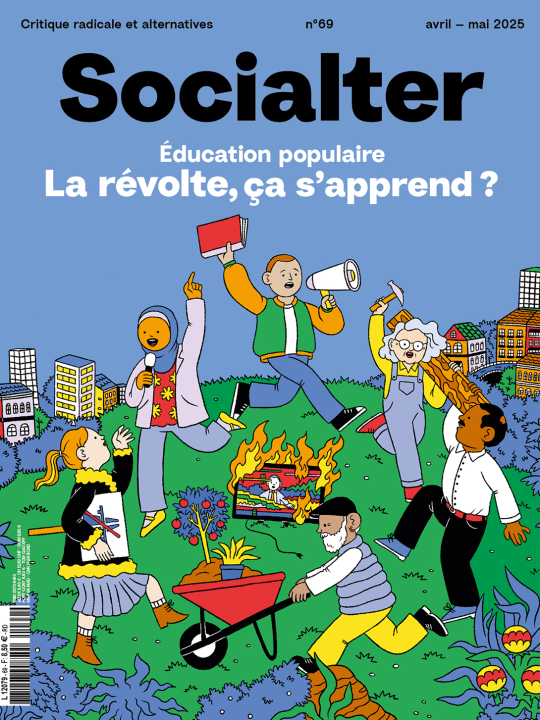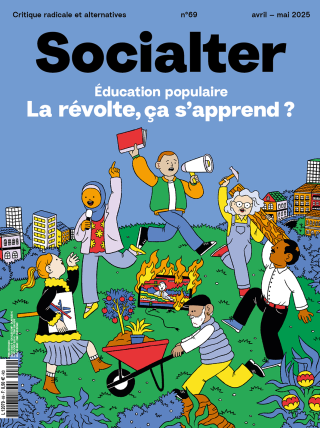Depuis les décennies 1990-2000, les conteurs de la résilience nous endorment de récits de rescapés dont ils font d’exemplaires histoires de reconstruction de ce qui a été anéanti. Illustration sémantique avec le Centre ressource du développement durable (CERDD) qui résume la stratégie de résilience à l’attention de décideurs locaux et d’acteurs de terrain : « Des deuils, des ruptures, des événements traumatisants… on en vit tous, ils nous affectent, parfois nous déstabilisent, souvent nous poussent à [nous] reconstruire. Il en va de ces épreuves individuelles comme des territoires : ces perturbations peuvent être des catastrophes naturelles (sécheresse, feu, inondation, canicule, pollution), des crises économiques (revirement industriel d’un territoire, fermeture massive d’entreprises), des risques technologiques (nucléaires, chimiques…), mais aussi des phénomènes plus lents, comme le changement climatique. » Outre que, personnellement, je ne suis pas un territoire, on notera que les « catastrophes » sont ici dites « naturelles », même lorsqu’elles résultent d’un technocapitalisme débridé, et qu’elles deviennent des « crises » ou des « risques » alors même qu’elles sont des catastrophes déjà en cours. « La résilience territoriale s’impose alors comme le moyen de dépasser les situations de crise et d’engager les territoires dans une vision à plus long terme qui intègre le...